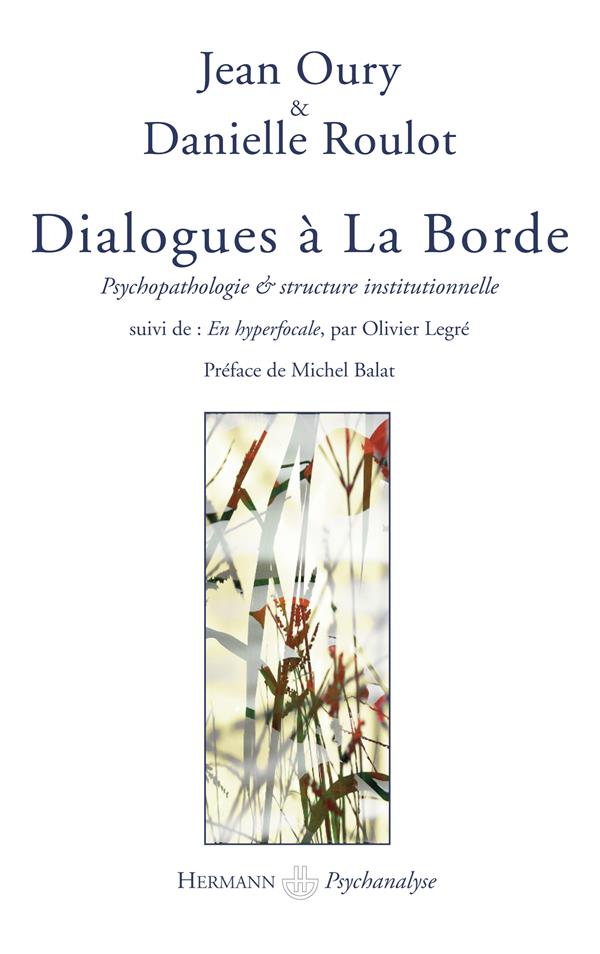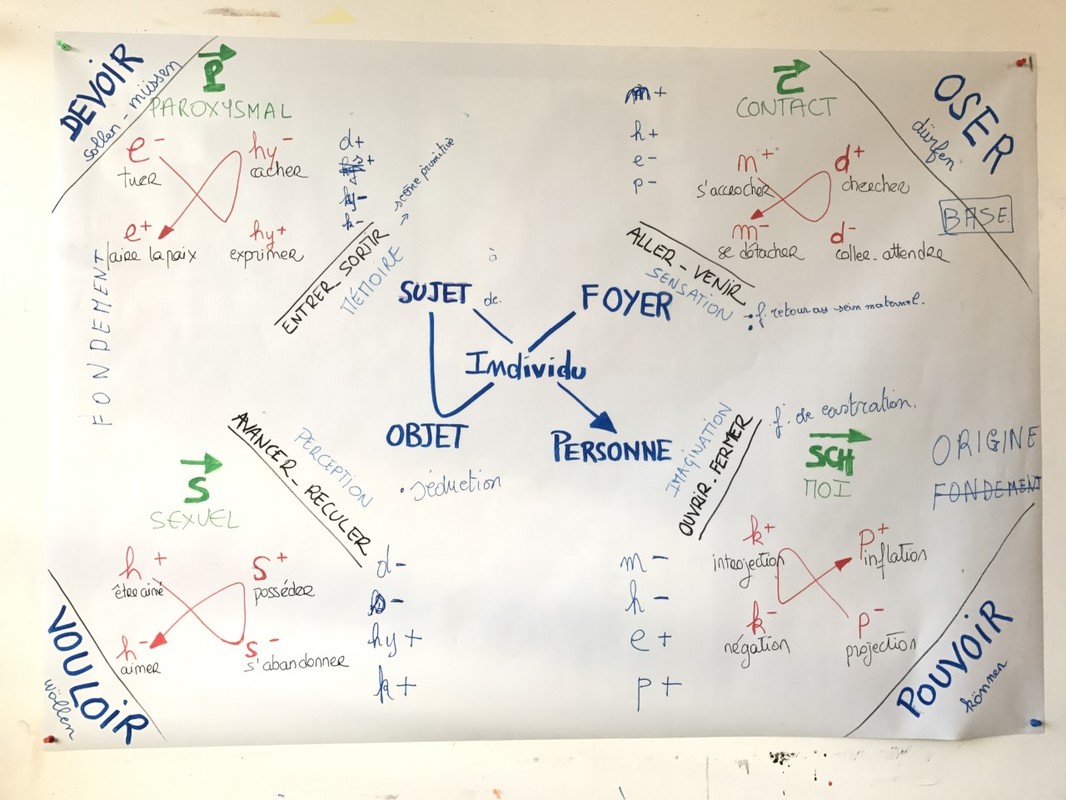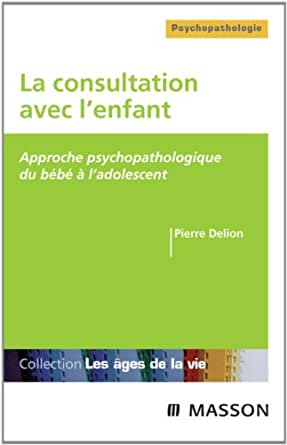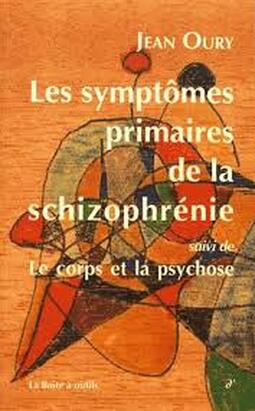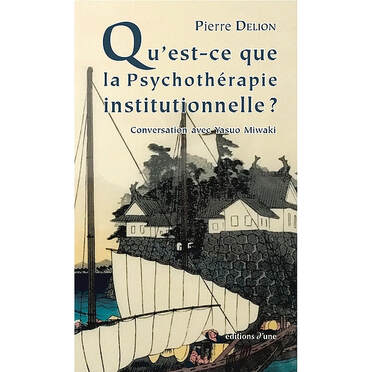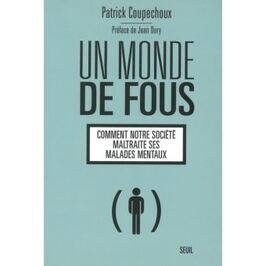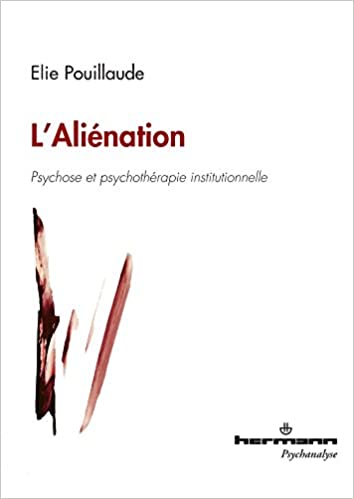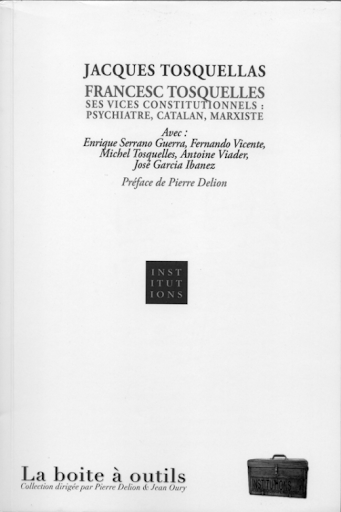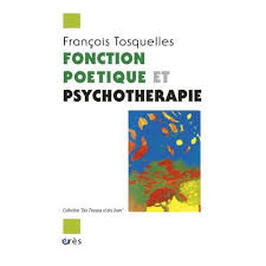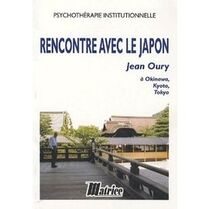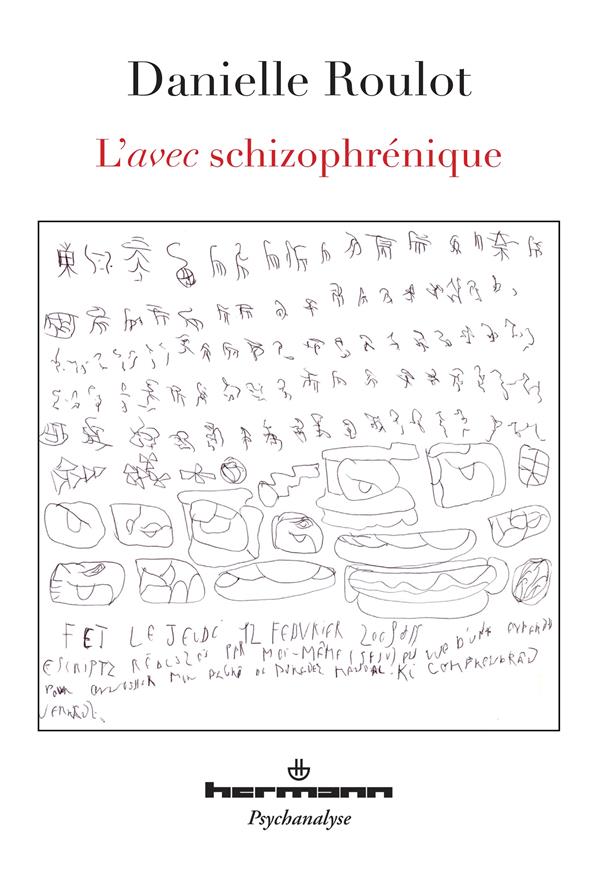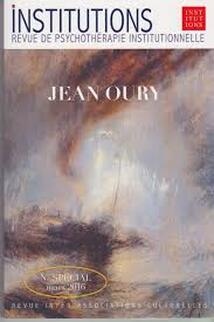|
DIPLÔME UNIVERSITAIRE PARIS 8 AVRIL DÉCEMBRE 2024 ANIMATEUR D’ATELIERS À SENSIBILITÉ ART THÉRAPEUTIQUE DEMANDE D’INSCRIPTION PAR MAIL
À PARTIR DU 15 DÉCEMBRE 2023. DEMANDE DE DOSSIER SMS 0680413869 Mail: [email protected] |
|
LES DIFFÉRENTS CURSUS DE FORMATION
IAT demi journée un atelier / CAAT (3 ateliers par mois) / CATI / CATE / REPRISE / SÉMIOTIQUE
IAT demi journée un atelier / CAAT (3 ateliers par mois) / CATI / CATE / REPRISE / SÉMIOTIQUE
Formation continue et recherche dans les domaines de l'accompagnement thérapeutique et artistique.
Nous vous proposons de venir à notre rencontre pour repenser le travail au quotidien dans chacune de vos pratiques, Comment réinventer au quotidien dans le travail? Quelle est la singularité de l'accueil? Comment repenser le possible?
Nous vous proposons de venir à notre rencontre pour repenser le travail au quotidien dans chacune de vos pratiques, Comment réinventer au quotidien dans le travail? Quelle est la singularité de l'accueil? Comment repenser le possible?
FORMATIONS CONTINUES ANNUELLESFORMATIONS EN ART THÉRAPIE
Notre équipe vous proposera des outils de création allant des médiations plastiques, en passant par les médiations corporelles aux concepts théoriques qui permettent d’interroger quotidiennement notre pratique). DIPLÔME UNIVERSITAIRE ANIMATEUR D’ATELIERS À SENSIBILITÉ ART THÉRAPEUTIQUE CERTIFICATIONS EN ART THÉRAPIE INSTITUTIONNELLE ET ART THÉRAPEUTE CURSUS SUR TERRAIN mention AVI & PP FORMATION À L'OBSERVATION DU NOURISSON SELON ESTHER BICK |
FORMATIONS PONCTUELLES"LES JOURNÉES AVEC"
Michel Balat (Sémioticien, Dr és lettres) et pierre Johan Laffitte invitent un Professionnel à partager une journée autour de ses questionnements et de sa pratique. en savoir plus dans la rubrique "évenements". Budget à la journée de 100 euros LES STAGES SPÉCIFIQUES différents médiums dans le processus art Thérapeutique que vus souhaitez approfondir |
FORMATIONS CONTINUES NON CERTIFIANTES
|
IAT
Initiation Art thérapie MODALITÉ D'ENTRÉE: OUVERT À TOUS
FORMATEUR: FLORENCE FABRE L'Objectif est de découvrir le cheminement art thérapeutique, les mouvements engendrés par le processus de création. Module expérientiel, à l'Issu duquel un temps sera pris pour repenser ce cheminement éclairé théoriquement afin de pouvoir être pensé sur son espace professionnel. Ce module n'est pas certifiant mais s'inscrit dans une démarche de découverte de la profession et de développement de compétences pour les personnes étant dans l'accompagnement soignant, éducatif ... Les personnes souhaitant poursuivre sur le cursus de Formation en Art thérapie bénéficieront d'un allègement du niveau CAAT. Le rythme: Un Atelier mensuel avec possibilité de stages regroupés une à deux fois par ans. Il vous serea demandé d'apporter votre matériel. Atelier prise échange individuelle 100 euros L’Atelier engagement annuel 720 euros (8 ateliers de 90 euros octobre mai) Ateliers prise en charge par un organisme: 2 cursus:
|
BALADE EN TERRE D'ART THÉRAPIE INSTITUTIONNELLE PROCHAINS RENDEZ VOUS 7 ET 8 JUIN ET 20 SEPTEMBRE Au profit de l’association L’accueillette Matinées rencontres de pédagogie institutionnelle rencontres de psychothérapie institutionnelle le processus de création dans le soin psychanalyse et sémiotique Rencontres de formations interprofessionnelles Après midi Balade en terre d’artistes les après midi au cœur de l’Atelier Art &motion lieu d’accompagnement art thérapeutique. Vous y découvrirez des expositions de graines d’artistes , de graines d’artisans d’art mais aussi des Artistes soutenant notre projet.
|
CERTIFICATIONS ET DIPLÔMES UNIVERSITAIRE EN ART THÉRAPIE INSTITUTIONNELLE
|
NIVEAU 1
DIPLÔME UNIVERSITAIRE PARIS 8 ANIMATEUR D’ATELIERS À SENSIBILITÉ ART THÉRAPEUTIQUE INSCRIPTION EN COURS AVRIL DÉCEMBRE 2024 CAAT
Certificat le processus de creation à l'œuvre dans les metiers du soin de l'education de la reeducation etc MODALITÉ D'ENTRÉE: OUVERT À TOUS FORMATEURS: ÉQUIPE L'Objectif est de découvrir par le cheminement art thérapeutique, les mouvements engendrés par le processus de création. Module expérientiel, à l'Issu duquel un temps sera pris pour repenser ce cheminement éclairé théoriquement afin de pouvoir être pensé sur son espace professionnel. Ce module s'inscrit dans une démarche de développement de compétences pour les personnes étant dans l'accompagnement soignant, éducatif ... Il vous serea demandé d'apporter votre matériel. Formation de niveau 4 cursus long - 4 ans 200 heures de formation 200 heures de stage 1200 euros l'année |
NIVEAU 2
CATI Certificat Art thérapie institutionelle MODALITÉ D'ENTRÉE: être certifié du CAAT OU DU ANIMATEUR D’ATELIERS À SENSIBILITÉ ART THÉRAPEUTIQUE et validation de l'équipe pédagogique.
FORMATEURS ÉQUIPE La durée de la formation sera déterminée en fonction du statut professionnel du stagiaire de la formation et de ses expériences professionnelles. L'Art thérapeute certifié CATI pourra mettre en place des ateliers-institutions au sens de la psychothérapie institutionnelle au sein des établissements et /ou structures de soin ou d'accompagnement. L'Art thérapeute travaillera au sein d'un collectif de professionnel référé à un psychologue, pédopsychiatre ou psychiâtre de l'établissement. Formation de niveau 3
|
NIVEAU 3
CATE Certificat Art thérapeute expert Module Art thérapeute suivis thérapeutiques individuels et de groupe Prérequis: CATI + stages en établissement ou en poste d'Art thérapie 36 à 48 sessions de 6h Ateliers et analyse de pratique L'art thérapeute pourra exercer son activité professionnelle salariée ou indépendante, impliquant la maîtrise des fondements scientifiques de sa profession, conduisant à une autonomie professionnelle, une éthique de travail ainsi qu'une démarche de recherche. CATE sera présenté à sa certification devant le COMITÉ SCIENTIFIQUE. 60 heures de formation par an 1200 euros l'année formation financement personnel 2000 euros formation prise en charge par un oragnisme (soit 200 euros la session de 6h) niveau 2 ou 1 suivant mention du jury |
CURSUS SUR TERRAIN mention AVI & PP
en partenariat avec l'ASSOCIATION CULTURELLE L'ACCUEILLETTEdont L’objet de l'ASSOCIATION CULTURELLE L'ACCUEILLETTE est d'améliorer l'accompagnement des personnes en difficultés physique et/ou Psychique. L’association propose un espace de « comodélisation et de cosensorialité » associant prévention, accompagnement thérapeutique et recherche.
|
FORMATION mention PP Mise en pratique professionnelle ateliers MODALITÉ D'ENTRÉE:
OUVERT au CAAT et au CATI FORMATEURS: ÉQUIPE L'Objectif est de découvrir et d'être en immersion dans l'espace art thérapeutique. D'être accompagné dans sa pratique. Il vous serea demandé d'apporter votre matériel. Cursus intensif - 1an* plusieurs possibilités
|
FORMATION mention AVI Animateur institutionnel vie quotidienne MODALITÉ D'ENTRÉE:
OUVERT au CAAT et au CATI FORMATEURS: ÉQUIPE L'Objectif est de découvrir le cheminement institutionnel de l'espace art thérapeutique, les mouvements engendrés par le processus de création. Module expérientiel, à l'Issu duquel un temps sera pris pour repenser ce cheminement éclairé théoriquement afin de pouvoir être pensé sur son espace professionnel. Ce module s'inscrit dans une démarche de découverte de la profession et de développement de compétences pour les personnes étant dans l'accompagnement soignant, éducatif ... Il vous serea demandé d'apporter votre matériel. Formation de niveau 4 cursus intensif - 1an*
|
CONTENU PÉDAGOGIQUE FORMATIONS
Le centre La Tuché se veut une structure de formation complète en art-thérapie, en proposant des parcours flexibles en termes de dominantes, de nombres de modules et de durées.
Le parcours de formation complet se déroule sur deux à quatre années, composées de modules théorico pratique et de stages. Ce parcours est jalonné de la rédaction ou réalisation de divers documents, écrits ou produits dans d’autres media langagiers, dont des comptes-rendus de stages un document final, de type mémoire ; il débouche sur l’obtention d’un certificat d’art-thérapie CAAT ou CATI ou CATE suivant le niveau présenté .
D’une certaine conception de l’art-thérapie…
La spécificité de cette formation consiste dans le degré de complexité auquel est théorisée et mise en pratique l’art-thérapie, ainsi que dans la multiréférentialité des approches qui sont concrètement proposées au public de formation. Cette approche seule peut correspondre à la conception plurifactorielle de notre clinique, et qui demande que soient prises en compte les différentes dimensions des pathologies accueillies, des pratiques soignantes, des vecteurs sémiotiques convoqués, et finalement de la psyché humaine et des lieux de vie qui intègrent et font communiquer entre elles ces différentes dimensions.
Notre conception de l’art-thérapie s’appuie sur les trois piliers suivants :
… à une certaine conception de sa transmission
Notre formation se doit, à son tour, d’épouser indissociablement une telle rigueur, dans son passage par de nécessaires repères théoriques et techniques, et un telessai, au sens montaignien, de la voie de l’existence et de la parole singulières. Il est impossible d’accueillir thérapeutiquement le sujet, dans ses plus profondes détériorations psychiques et physiques, et de l’étayer dans le cheminement de sa reconstruction existentielle, sans faire soi-même le passage par une telle méthode.
De là, quelques conséquences en termes d’organisation de notre formation.
La formation en art-thérapie se doit d’être complète sur le plan de la pratique, de la théorie et de l’élaboration intime du rapport du futur thérapeute à son processus créatif. Cette élaboration psychique est la condition sine qua non pour que la formation ne se limite pas en une suite de techniques, aussi sophistiquées soient-elles, mais acquière la profondeur d’une méthode. Qui plus est, la dimension créatrice étant au cœur du processus art-thérapeutique, il est indispensable que le tâtonnement, étayé par le groupe, soit permis sur le temps long, afin qu’une dynamique oriente l’ensemble de la formation, par-delà la spécificité de ses différents moments (théoriques, pratiques, créatifs).
Par ailleurs, la coprésence est une dimension essentielle pour la dynamique créatrice du groupe, et le corps engagé dans une pratique concrète est une condition évidente à une véritable élaboration psychique du thérapeute. Pour cette raison, la formation se fera en présentiel, et ne proposera pas de dispositif en EAD (éducation à distance).
Enfin, la nature du savoir et de son mode de transmission doit être réaffirmée dans sa dimension singulière, et non générale. On entend par là que ce parcours de formation ne consistera pas en un couplage extérieur entre un corpus abstrait et une suite d’ « applications ». Une théorie est avant tout un outil dont l’efficacité et la pertinence s’éprouvent, dans l’immédiate épreuve du corps, de la pratique et de la parole. C’est pourquoi le mode d’enseignement suivra la forme d’atelier autant que de séminaire, et déterminera une relation de transmission, au sens le moins formatant du terme. De tout cela, naît non pas un savoir de l’ordre de la logique générale — d’où l’impossibilité de « cours à distance » réduits à du pur contenu, mais élaboration singulière d’un savoir personnel, dans une confrontation permanente entre questionnement des théories et concepts apportés par les différents intervenants et travail de création et d’élaboration analytique intime. Ce savoir singulier ne se construit cependant pas dans un isolement calamiteux, tant pour la personne en formation que pour ses futurs patients : il se construit au sein de l’espace commun où le partage des expériences et des élaborations forme un filet d’analyse, d’accueil respectueux, d’écoute et de réponse.
Comment avec cette palette de couleurs, trouver un processus propre ? Non pas une exigence en termes de « niveaux » auxquels accéder, mais une fibre, de l’ordre de l’art, à déployer, une palette artistique intérieure.
Art, thérapie, clinique, épreuve de soi et du monde : trois parcours
Trois grands parcours sont proposés : un parcours fondamental en art-thérapie, un parcours artistique, un parcours théorique ; transversales, seront menées les voies d’une pratique de stages et d’une pratique d’écriture. Le champ de la « recherche-action » est le terme qui résume le mieux l’inspiration de ce parcours profond à travers les différents media artistiques, que chaque module sera amené à traverser : telle est la transversalité constitutive d’un savoir, par opposition à une somme de connaissances.
Le parcours fondamental en art-thérapie scande la formation par des modules qui allient abord théorique des grands champs notionnels, constitution d’une culture historique des grands courants et moments du développement de l’art-thérapie, mais avant tout expérimentation concrète des processus structurant l’accueil et l’abord art-thérapeutiques de la création humaine et des pathologies accueillies. Ce moment vise en particulier à resituer le désir du praticien par rapport à son propre monde créatif, mais tout en construisant la nécessaire distinction entre processus créatif artistique personnel et processus créatif en tant que thérapeute. Sur le plan épistémologique, cet abord se situe dans la lignée de l’œuvre, séminale, de Laura Grignoli, sur laquelle se greffe une analyse d’inspiration amplement freudienne et postfreudienne.
Le parcours artistique propose un décalage de la problématique proprement thérapeutique vers la rencontre, trois fois dans l’année, avec un créateur et son univers. Ces moments de rencontre consistent en une immersion dans une ambiance (au sens phénoménologique du terme), une problématique à la fois langagière et existentielle, d’un sujet singulier : c’est la construction d’une poiesis, création libre et emportant le sort de tout l’être jusqu’à l’expression d’une forme vive, transmissible, ouvrant à son tour un espace de partage dans lequel les sujets récepteurs s’expérimentent eux-mêmes comme créateurs, concernés dans leurs propres corps et psyché.
Le parcours théorique constitue un décalage en contrepoint, vers d’autres dimensions fondamentales pour fonder une pratique de l’art-thérapie qui ne tombe pas dans un abord ni protocolaire, ni comportementaliste, du rapport au sujet en souffrance. Cette partie de la formation ne constitue pas une information, mais un véritable passage par des corpus théoriques et cliniques proches de l’art-thérapie :
Effet en retour : une ouverture épistémologique au cœur de l’art-thérapie et de sa transmission
En termes de champs épistémologiques, ces trois corpus constituent le volet clinique et théorique sans doute l’apport le plus inédit de cette formation dans le champ de l’art-thérapie. Cet apport se fonde sur plus de dix ans de pratique quotidienne, dans plusieurs cadres d’intervention, en équipes ou individuellement, par des thérapeutes, sémioticiens et artistes qui constitueront les principaux intervenants dans cette formation.
Cet apport, issu du dialogue constant avec les différentes praxis thérapeutiques, artistiques et autres évoquées ci-dessus, agit sur le champ de l’art-thérapie à un triple niveau :
De l’expérience partagée des stages…
Enfin, une pratique de stages achèvera de construire un parcours dans lequel la personne aura traversé tous les champs nécessaires à ce que le savoir, théorique et pratique, ait été non seulement intégré, mais transformé dans son expérience intime, psychique, corporelle et pratique. Cette pratique de stages, à son tour, doit être pensée comme une source de savoir : savoir transmis et découvert, certes, sur le terrain, mais savoir forgé, au travers d’écrits ou, plus largement, de productions langagières porteuses d’une théorie, aussi variées qu’en soient les formes sémiotiques de leur expression.
… à l’épreuve intime de l’écriture
Cette question concerne, essentiellement, la place de l’écriture et de l’inscription d’un savoir, dans le cadre de cette transmission. Plusieurs types d’écriture sont exigés comme autant de passages nécessaires, afin que le sujet affronte l’épreuve, souvent angoissante, d’inscrire et de porter à l’échange avec le groupe une pensée qu’il signera en propre. Cette écriture ne doit évidemment pas être comprise dans le seul sens, réducteur, d’une production linguistique. Celle-ci reste centrale, à titre de lieu privilégié d’une analyse et d’une parole-carrefour entre les différentes aires sémiotiques de la formation ; ainsi, un journal devra être tenu, au fur et à mesure des deux années.
L’écriture prendra également sa place dans le cadre de la production exigée au terme de ces deux années : ce qu’on appelle souvent un « mémoire », mais auquel nous souhaitons conserver plutôt le statut de « texte libre », au sens où l’entendait le pédagogue Célestin Freinet, et tel que nous souhaitons en faire une forme-sens dont tous pourront s’emparer, librement, poiétiquement, afin de forger l’agencement singulier le plus adéquat entre désir et parole — de quoi porter une éthique en langage, et la porter à l’échange où l’Autre se rencontre, s’éprouve et se respecte, tout autant que dans le quotidien de la praxis, qu’elle soit thérapeutique ou autre. « Texte » et « libre » doivent s’entendre dans l’extension maximale de ces termes : tissage entre plusieurs fils dont l’hétérogénéité et la diversité de matière ne sont pas a priori limitées, mais dont l’ampleur exigera d’autant plus d’attention à l’art et à la puissance du tissage. Loin de se réduire à ce qui souvent se réduit à une rhétorique « universitaire », de tels textes peuvent être pensés dans une perspective monographique, mais également narrative, poétique, etc. Ce pourra être, plus généralement, une création artistique ou intellectuelle ; plus généralement encore, cette production pourra prendre la forme d’une enquête. Dans tous les cas, c’est la rencontre entre angoisse — et donc désir — et une articulation langagière, qu’elle soit création ou analyse, qui constitue le critère fondamental : avoir réussi, en acceptant une position « d’embarras » (Lacan), de prendre le risque d’une parole singulière où l’autre n’est pas absent. Aussi, et c’est le point le plus loin que nous semble pouvoir être tenu cette liberté, ce « texte libre » doit pouvoir accepter tout type de sémiose, tout type de langage — pas seulement linguistique (graphique, musicale ou sonore, massive, etc.), pas seulement inscrite sous une forme fixable (performance, etc.), etc. L’important est qu’une telle parole, par-delà ses choix d’articulation et d’inscription, comporte une part d’analyse partageable, et pouvant être léguée aux générations suivantes des personnes à qui cela se transmettra. L’inscription, dans le dispositif que nous mettons en place, doit se faire dans tous les sens : dépôt d’un savoir commun dans des expériences singulières, plus ou moins novices, et dépôts des arabesques dont sont porteuses ces expériences dans le trésor commun d’une culture de transmission.
Ce dispositif, on l’aura compris, a pour but de demeurer dans la pleine adéquation entre la théorie dont est porteur l’art-thérapie, et la forme à travers laquelle cette pensée-art est portée, transformée et assumée par ses sujets. C’est pour cela que nous avons insisté dans ce document de présentation sur la notion de transmission, terme souvent employé en lieu et place de « formation ». Sans renier l’exigence pédagogique, scientifique et pratique d’un souci de former, nous nous méfions de l’inévitable tendance de toute formation soit à se durcir en une conformation de son public, effet de défense d’une discipline sur un certain marché de la… formation (professionnelle ou autre), soit à se dissoudre en une (suite d’) information(s). Double écueil dont nul ne peut se prétendre protégé d’avance, mais face auquel notre dispositif propose un ensemble de pratiques corporelles, psychiques et théoriques que nous espérons à la fois vertébré, et ouvert.
C’est à cette fin, en particulier, qu’un conseil scientifique, composé de personnes référentes reconnues dans leurs domaines respectifs, assurera à La Tuché un permanent regard d’analyse et de régulation en ce qui concerne autant le contenu, que la forme et que les résultats de son dispositif de formation.
Pierre Johan Laffitte.
Le parcours de formation complet se déroule sur deux à quatre années, composées de modules théorico pratique et de stages. Ce parcours est jalonné de la rédaction ou réalisation de divers documents, écrits ou produits dans d’autres media langagiers, dont des comptes-rendus de stages un document final, de type mémoire ; il débouche sur l’obtention d’un certificat d’art-thérapie CAAT ou CATI ou CATE suivant le niveau présenté .
D’une certaine conception de l’art-thérapie…
La spécificité de cette formation consiste dans le degré de complexité auquel est théorisée et mise en pratique l’art-thérapie, ainsi que dans la multiréférentialité des approches qui sont concrètement proposées au public de formation. Cette approche seule peut correspondre à la conception plurifactorielle de notre clinique, et qui demande que soient prises en compte les différentes dimensions des pathologies accueillies, des pratiques soignantes, des vecteurs sémiotiques convoqués, et finalement de la psyché humaine et des lieux de vie qui intègrent et font communiquer entre elles ces différentes dimensions.
Notre conception de l’art-thérapie s’appuie sur les trois piliers suivants :
- Une pratique de l’art-thérapie dans la lignée de Laura Grignoli ;
- Une clinique transférentielle inspirée de la psychothérapie institutionnelle et de sa prise en compte de la logique pulsionnelle et de la phénoménologie psychiatrique, mais également présente dans l’éveil de coma et dans la pédagogie coopérative (pédagogie institutionnelle) ;
- Un abord des langages, artistiques, linguistiques et corporels, inspiré de la sémiotique peircienne telle qu’elle structure le travail avec des pathologies lourdes et des détériorations profondes du rapport du sujet à son corps parlant et à sa parole vive.
… à une certaine conception de sa transmission
Notre formation se doit, à son tour, d’épouser indissociablement une telle rigueur, dans son passage par de nécessaires repères théoriques et techniques, et un telessai, au sens montaignien, de la voie de l’existence et de la parole singulières. Il est impossible d’accueillir thérapeutiquement le sujet, dans ses plus profondes détériorations psychiques et physiques, et de l’étayer dans le cheminement de sa reconstruction existentielle, sans faire soi-même le passage par une telle méthode.
De là, quelques conséquences en termes d’organisation de notre formation.
La formation en art-thérapie se doit d’être complète sur le plan de la pratique, de la théorie et de l’élaboration intime du rapport du futur thérapeute à son processus créatif. Cette élaboration psychique est la condition sine qua non pour que la formation ne se limite pas en une suite de techniques, aussi sophistiquées soient-elles, mais acquière la profondeur d’une méthode. Qui plus est, la dimension créatrice étant au cœur du processus art-thérapeutique, il est indispensable que le tâtonnement, étayé par le groupe, soit permis sur le temps long, afin qu’une dynamique oriente l’ensemble de la formation, par-delà la spécificité de ses différents moments (théoriques, pratiques, créatifs).
Par ailleurs, la coprésence est une dimension essentielle pour la dynamique créatrice du groupe, et le corps engagé dans une pratique concrète est une condition évidente à une véritable élaboration psychique du thérapeute. Pour cette raison, la formation se fera en présentiel, et ne proposera pas de dispositif en EAD (éducation à distance).
Enfin, la nature du savoir et de son mode de transmission doit être réaffirmée dans sa dimension singulière, et non générale. On entend par là que ce parcours de formation ne consistera pas en un couplage extérieur entre un corpus abstrait et une suite d’ « applications ». Une théorie est avant tout un outil dont l’efficacité et la pertinence s’éprouvent, dans l’immédiate épreuve du corps, de la pratique et de la parole. C’est pourquoi le mode d’enseignement suivra la forme d’atelier autant que de séminaire, et déterminera une relation de transmission, au sens le moins formatant du terme. De tout cela, naît non pas un savoir de l’ordre de la logique générale — d’où l’impossibilité de « cours à distance » réduits à du pur contenu, mais élaboration singulière d’un savoir personnel, dans une confrontation permanente entre questionnement des théories et concepts apportés par les différents intervenants et travail de création et d’élaboration analytique intime. Ce savoir singulier ne se construit cependant pas dans un isolement calamiteux, tant pour la personne en formation que pour ses futurs patients : il se construit au sein de l’espace commun où le partage des expériences et des élaborations forme un filet d’analyse, d’accueil respectueux, d’écoute et de réponse.
Comment avec cette palette de couleurs, trouver un processus propre ? Non pas une exigence en termes de « niveaux » auxquels accéder, mais une fibre, de l’ordre de l’art, à déployer, une palette artistique intérieure.
Art, thérapie, clinique, épreuve de soi et du monde : trois parcours
Trois grands parcours sont proposés : un parcours fondamental en art-thérapie, un parcours artistique, un parcours théorique ; transversales, seront menées les voies d’une pratique de stages et d’une pratique d’écriture. Le champ de la « recherche-action » est le terme qui résume le mieux l’inspiration de ce parcours profond à travers les différents media artistiques, que chaque module sera amené à traverser : telle est la transversalité constitutive d’un savoir, par opposition à une somme de connaissances.
Le parcours fondamental en art-thérapie scande la formation par des modules qui allient abord théorique des grands champs notionnels, constitution d’une culture historique des grands courants et moments du développement de l’art-thérapie, mais avant tout expérimentation concrète des processus structurant l’accueil et l’abord art-thérapeutiques de la création humaine et des pathologies accueillies. Ce moment vise en particulier à resituer le désir du praticien par rapport à son propre monde créatif, mais tout en construisant la nécessaire distinction entre processus créatif artistique personnel et processus créatif en tant que thérapeute. Sur le plan épistémologique, cet abord se situe dans la lignée de l’œuvre, séminale, de Laura Grignoli, sur laquelle se greffe une analyse d’inspiration amplement freudienne et postfreudienne.
Le parcours artistique propose un décalage de la problématique proprement thérapeutique vers la rencontre, trois fois dans l’année, avec un créateur et son univers. Ces moments de rencontre consistent en une immersion dans une ambiance (au sens phénoménologique du terme), une problématique à la fois langagière et existentielle, d’un sujet singulier : c’est la construction d’une poiesis, création libre et emportant le sort de tout l’être jusqu’à l’expression d’une forme vive, transmissible, ouvrant à son tour un espace de partage dans lequel les sujets récepteurs s’expérimentent eux-mêmes comme créateurs, concernés dans leurs propres corps et psyché.
Le parcours théorique constitue un décalage en contrepoint, vers d’autres dimensions fondamentales pour fonder une pratique de l’art-thérapie qui ne tombe pas dans un abord ni protocolaire, ni comportementaliste, du rapport au sujet en souffrance. Cette partie de la formation ne constitue pas une information, mais un véritable passage par des corpus théoriques et cliniques proches de l’art-thérapie :
- Clinique institutionnelle (psychothérapie et de pédagogie institutionnelles, éveil de coma),
- Phénoménologie psychiatrique et analyse des pulsions (dans la perspective de l’anthropo-psychiatrie
- sémiotique peircienne (articulées avec le champ des cliniques citées ci-dessus et la psychanalyse).
Effet en retour : une ouverture épistémologique au cœur de l’art-thérapie et de sa transmission
En termes de champs épistémologiques, ces trois corpus constituent le volet clinique et théorique sans doute l’apport le plus inédit de cette formation dans le champ de l’art-thérapie. Cet apport se fonde sur plus de dix ans de pratique quotidienne, dans plusieurs cadres d’intervention, en équipes ou individuellement, par des thérapeutes, sémioticiens et artistes qui constitueront les principaux intervenants dans cette formation.
Cet apport, issu du dialogue constant avec les différentes praxis thérapeutiques, artistiques et autres évoquées ci-dessus, agit sur le champ de l’art-thérapie à un triple niveau :
- Il l’ouvre sur des pratiques connexes (psychothérapie institutionnelle de la psychose, de la schizophrénie et de l’autisme ; éveil de coma, réanimation, rééducation ; champ de la pédiatrie et de la gériatrie) qui recourent à ses techniques, mais qu’en retour elles fécondent : elles questionnent sans cesse les ça-va-de-soi théoriques et cliniques que ne peut manquer de fomenter, de la part d’un courant thérapeutique comme le nôtre, la (légitime) volonté de reconnaissance et de distinction disciplinaires par rapport à d’autres types de thérapies peut encourager des affirmations parfois trop rigoristes et dogmatiques.
- Il le fonde d’un point de vue métapsychologique, en se donnant des outils pour questionner l’intégralité de la vie humaine, dans ses profondeurs pulsionnelles (inspiration de L. Szondi et de la phénoménologie psychiatrique : Von Weizsäcker, L. Binswanger, H. Maldiney, J. Schotte) : seul un tel abord « anthropo-psychiatrique » (Schotte) du contact entre corps désirant et monde, permet de sortir des limites du seul paradigme positiviste, aujourd’hui dominant, dont le réductionnisme régit tant l’approche purement physiologiste de l’organisme, que l’abord neuro-cognitiviste et socio-comportemental du lien psyché-corps et organisme-environnement.
- Enfin il le fonde à un niveau sémiotique, ou logique, propre à l’homme-signe (Peirce), à l’être de paroles (Hagège), au parlêtre (Lacan), à l’être porteur d’unepoiesis (Aristote) : d’où une pensée systémique à hauteur de langage et de parole, modélisant autant les fondements créateurs de l’existence (rythme, ton, traces) et ses ruptures pathologiques, que les media artistiques et théoriques par lesquels se pose et se réfléchit, dans un même mouvement, la singularité de l’existence, de ses failles et du savoir relatif à toutes deux, savoir intime, partageable, retrouvable. Là encore, est promu un abord du langage fondé sur la singularité de la parole et non sur la prééminence du code social et sur la (ré-)adaptation du comportement (langagier et corporel) comme visée thérapeutique supposée.
De l’expérience partagée des stages…
Enfin, une pratique de stages achèvera de construire un parcours dans lequel la personne aura traversé tous les champs nécessaires à ce que le savoir, théorique et pratique, ait été non seulement intégré, mais transformé dans son expérience intime, psychique, corporelle et pratique. Cette pratique de stages, à son tour, doit être pensée comme une source de savoir : savoir transmis et découvert, certes, sur le terrain, mais savoir forgé, au travers d’écrits ou, plus largement, de productions langagières porteuses d’une théorie, aussi variées qu’en soient les formes sémiotiques de leur expression.
… à l’épreuve intime de l’écriture
Cette question concerne, essentiellement, la place de l’écriture et de l’inscription d’un savoir, dans le cadre de cette transmission. Plusieurs types d’écriture sont exigés comme autant de passages nécessaires, afin que le sujet affronte l’épreuve, souvent angoissante, d’inscrire et de porter à l’échange avec le groupe une pensée qu’il signera en propre. Cette écriture ne doit évidemment pas être comprise dans le seul sens, réducteur, d’une production linguistique. Celle-ci reste centrale, à titre de lieu privilégié d’une analyse et d’une parole-carrefour entre les différentes aires sémiotiques de la formation ; ainsi, un journal devra être tenu, au fur et à mesure des deux années.
L’écriture prendra également sa place dans le cadre de la production exigée au terme de ces deux années : ce qu’on appelle souvent un « mémoire », mais auquel nous souhaitons conserver plutôt le statut de « texte libre », au sens où l’entendait le pédagogue Célestin Freinet, et tel que nous souhaitons en faire une forme-sens dont tous pourront s’emparer, librement, poiétiquement, afin de forger l’agencement singulier le plus adéquat entre désir et parole — de quoi porter une éthique en langage, et la porter à l’échange où l’Autre se rencontre, s’éprouve et se respecte, tout autant que dans le quotidien de la praxis, qu’elle soit thérapeutique ou autre. « Texte » et « libre » doivent s’entendre dans l’extension maximale de ces termes : tissage entre plusieurs fils dont l’hétérogénéité et la diversité de matière ne sont pas a priori limitées, mais dont l’ampleur exigera d’autant plus d’attention à l’art et à la puissance du tissage. Loin de se réduire à ce qui souvent se réduit à une rhétorique « universitaire », de tels textes peuvent être pensés dans une perspective monographique, mais également narrative, poétique, etc. Ce pourra être, plus généralement, une création artistique ou intellectuelle ; plus généralement encore, cette production pourra prendre la forme d’une enquête. Dans tous les cas, c’est la rencontre entre angoisse — et donc désir — et une articulation langagière, qu’elle soit création ou analyse, qui constitue le critère fondamental : avoir réussi, en acceptant une position « d’embarras » (Lacan), de prendre le risque d’une parole singulière où l’autre n’est pas absent. Aussi, et c’est le point le plus loin que nous semble pouvoir être tenu cette liberté, ce « texte libre » doit pouvoir accepter tout type de sémiose, tout type de langage — pas seulement linguistique (graphique, musicale ou sonore, massive, etc.), pas seulement inscrite sous une forme fixable (performance, etc.), etc. L’important est qu’une telle parole, par-delà ses choix d’articulation et d’inscription, comporte une part d’analyse partageable, et pouvant être léguée aux générations suivantes des personnes à qui cela se transmettra. L’inscription, dans le dispositif que nous mettons en place, doit se faire dans tous les sens : dépôt d’un savoir commun dans des expériences singulières, plus ou moins novices, et dépôts des arabesques dont sont porteuses ces expériences dans le trésor commun d’une culture de transmission.
Ce dispositif, on l’aura compris, a pour but de demeurer dans la pleine adéquation entre la théorie dont est porteur l’art-thérapie, et la forme à travers laquelle cette pensée-art est portée, transformée et assumée par ses sujets. C’est pour cela que nous avons insisté dans ce document de présentation sur la notion de transmission, terme souvent employé en lieu et place de « formation ». Sans renier l’exigence pédagogique, scientifique et pratique d’un souci de former, nous nous méfions de l’inévitable tendance de toute formation soit à se durcir en une conformation de son public, effet de défense d’une discipline sur un certain marché de la… formation (professionnelle ou autre), soit à se dissoudre en une (suite d’) information(s). Double écueil dont nul ne peut se prétendre protégé d’avance, mais face auquel notre dispositif propose un ensemble de pratiques corporelles, psychiques et théoriques que nous espérons à la fois vertébré, et ouvert.
C’est à cette fin, en particulier, qu’un conseil scientifique, composé de personnes référentes reconnues dans leurs domaines respectifs, assurera à La Tuché un permanent regard d’analyse et de régulation en ce qui concerne autant le contenu, que la forme et que les résultats de son dispositif de formation.
Pierre Johan Laffitte.
|
FORMATION OBSERVATION DU NOURRISSON SELON ESTHER BICK
LES FORMATEURS
MARTINE TROUILLAS PASCAL Pédopsychiatre GEORGE PEREZ Psychologue RENDEZ VOUS Tous les mardis de 18h à 20h durée deux ans, 80h/an Démarrage de la formation le Mardi 09 Janvier 2018 à 18h |
TARIFS PUBLIC Cette formation intéresse des publics divers : les personnes travaillant sur l’autisme et la psychose ; néonatalogie ; P. M. I. ; crèches ; écoles maternelles ; I. T. E. P. ; Maisons d’Accueil Spécialisées ; etc. Cliquez ici pour modifier.
|
L’observation directe du nourrisson selon la méthode Esther Bick (Infant observation), consiste pour les observateurs à pouvoir assister aux deux premières années du développement du bébé « in situ », dans sa famille. PROGRAMME ET METHODOLOGIE
Les visites de l’observateur sont régulières et se déroulent une fois par semaine au domicile de la famille selon un horaire qui convient aux parents. Chaque observation dure environ une heure. Le (ou les) observateur(s) se retrouve(nt) dans un séminaire hebdomadaire constitué d’une douzaine de membres environ. Le groupe participe à la lecture de l’observation, à la réflexion et à la perlaboration, aidé par un psychanalyste et un formateur initié à cette méthode. Des synthèses sont produites pour chaque observation par le ou les deux secrétaire(s) du groupe. Les mouvements psychiques groupaux sont intéressants à étudier dans la mesure où ils donnent des indications sur la relation entre l’observateur et le bébé avec ses parents. L’une des visées de la méthode est d’aider tous les participants à cette formation à concevoir de manière vivante, d’abord le développement normal d’un enfant entre 0 et 2 ans, puis, par là-même d’avoir un aperçu du vécu infantile des personnes dont ils ont à prendre soin dans leurs pratiques respectives. La méthode figure de façon propédeutique la mise au travail d’une équipe pluridisciplinaire dans la rencontre avec une personne, à la fois dans ses aspects interactifs, comportementaux et fantasmatiques. |
|
JOURNÉES AVEC
|
LES FORMATEURS MICHEL BALAT ET PIERRE JOHAN LAFFITTE + INVITÉS Vidéo pour les échanges Artelieu /Art&motion - Avril Mai 2019
|
PARCOURS THÉORIQUE: "LES JOURNÉES AVEC"
|
|
|
Cette année, le premier jour du printemps verra revenir parmi nous un oiseau de bon augure et à l’envergure peu banale : Pierre Delion, pédopsychiatre dont la réflexion, à partir de la sémiotique de Peirce, a profondément réarmé la clinique de l’autisme, mais plus largement le champ de la psychothérapie institutionnelle et celui de la psychiatrie engagée dans la cité. C’est de tout cela qu’il viendra nous parler. Il renouera avec sa déjà longue tradition d’escales catalanes, en particulier les « Journées avec… » jadis tenues par son complice Michel Balat à Canet-en-Roussillon, et maintenant revenues dans les locaux de l’Accueillette, le mas accueillant de Florence Fabre que beaucoup d’entre vous connaissent bien. C’est un lieu qui, de plus en plus, devient l’une des îles où se retrouvent les migrateurs et migratrices des métiers de l’humain, et pour qui la psychothérapie institutionnelle constitue l’une des boussoles les moins frelatées pour ne pas perdre le Nord (ou le sud…) dans un paysage contemporain de plus en plus abîmé et érodé. Cette journée entière d’échanges comprendra également un moment de reprise, le samedi en fin d’après-midi ou le dimanche matin. Enfin, en vous invitant, nous ne pouvons pas ne pas partager avec vous le silence soudain et le très grand vide qu’a causé en nous la mort de Danielle Roulot, un autre grand nom de la psychothérapie institutionnelle. Sa toute dernière intervention en public, qui jusqu’au bout a témoigné de sa place majeure dans la discussion théorique et clinique contemporaine, c’est à Elne qu’elle l’aura partagée. En décembre, lors de notre précédente « Journée avec » qui accueillit également son autre complice labordien, Michel Lecarpentier, un autre habitué d’Elne. Ce fut pas même quinze jours avant qu’elle ne nous quitte, à La Borde. Danielle Roulot est un repère dont les écrits restent grandement porteurs et demandent encore à être médités, longtemps. Danielle fut une amie, dont la présence demeure, dans le manque. Bien amicalement, Florence Fabre, Michel Balat, Pierre Johan Laffitte |
programmation en cours
programmation en cours
15 -16 SEPT 2017 AUTISME EVEIL DE COMA 20 ANS APRÈS AVEC PIERRE DELION ET MICHEL BALAT
15 SEPTEMBRE 2017
Argument
Il y a juste 20 ans se tenait à Canet en Roussillon ce colloque dont nous étions amenés à dire ceci :
« Le choix du thème était hardi, sans doute même est-ce la première fois qu'une telle confrontation était organisée. Pourtant il nous était rapidement apparu, lors de sa conception et de sa préparation, qu'un trait venait en quelque sorte unir les termes en présence : celui de la rareté des signes institués. Nous disons bien les signes« institués» afin de faire la différence avec ces signes, souvent corporels, parfois en actes, qui abondent aussi bien chez les autistes que dans l'éveil de coma. Bien entendu nous ne comptions pas faire de cette rareté le signe, à son tour, d'une proximité étiologique ou simplement descriptive.
Car, du vécu que l'on peut avoir auprès des autistes à celui des personnes en éveil de coma, la différence est suffisamment importante,
leurs présences respectives sont d'une qualité si distincte, que l'on ne saurait exagérer les rapports de ces deux symptomatologies. La
question tournait préalablement bien plutôt autour de celle-ci : quelles sont les conditions institutionnelles que l'on peut favoriser ou établir pour permettre le travail des équipes confrontées à cette rareté, voire cette absence de paroles. Mais en fait n'étions nous pas un peu à côté ?
Sans doute est-ce l'intervention de Jean Oury qui le montre le mieux en situant la question autour de l'émergence. Car évoquer l'émergence, c'est en même temps demander les conditions institutionnelles pour qu'elle soit possible, pour qu'elle soit recueillie et accueillie. Ainsi n'était-ce point la rareté des signes qui pose problème, mais la nécessité d'être là pour rencontrer ce d'où ils émergent.
Nous avions convié, dans cette salle de congrès, des amis. Mais des amis non au sens habituel de ce terme (quoique), mais au sens quasi étymologique de la philia, celui qui qualifie la relation contractuelle réciproque de l'hospitalité, de l'accueil et des obligations de l'« hospitant » (tel est le mot d'Emile Benveniste pour qualifier l'hôte qui reçoit) et du xénos, de l'étranger, de l'hôte reçu. Non des amis dans un cercle qui ferme, mais une amitié prête à accepter le dissemblable, ce type d'amitié que l'on doit s'attendre à trouver dans l'accueil fait à un pensionnaire, un client, un malade, un blessé, autant de noms pour une même réalité humaine.
Les interventions et les débats porteront témoignage qu'il n'en était aucun qui n'eût des lueurs ou des connaissances approfondies sur les champs des autres. C'est ainsi que pourront se tresser des bouts de cordes robustes avec des brins de psychothérapie institutionnelle, de sémiotique, de théorie du coma, du cerveau, de l'autisme.
La première matinée y était consacrée à la fois à la présentation du terrain clinique et aux premières élaborations qui en permettent l'observation, voire parfois la constitution. Les interventions d'Edwige Richer et de Pierre Delion montreront à l'évidence qu'en faisant du jeune autiste ou du blessé en éveil de coma le centre de gravité institutionnel de l'établissement de soin, on retrouve des préoccupations et des réponses étonnamment semblables. Il faut dire que c'est en nous apercevant, il y a quelques années, de cette similitude des réponses que nous avions songé à cette rencontre. La présence des équipes et leur prise de parole durant les deux après-midi venaient alors préciser, ouvrir, vivifier ce que la nécessaire structure des exposés aurait pu massifier. »
Que dire de plus sinon les changements qui ont eu lieu dans la prise en charge des enfants autiste, modifiant l’approche de cette pathologie qui, d’ailleurs, a connu au cours de ces 20 dernières années une transformation considérable. Pour parodier Marx : Un spectre hante le monde : le spectre de l’autisme. L’autisme est quasiment devenu la maladie du siècle et on peut dire que les autistes n’en ont guère été mieux soignés. Ce sera à coup sûr l’un des thèmes de ce nouveau colloque anniversaire.
Argument
Il y a juste 20 ans se tenait à Canet en Roussillon ce colloque dont nous étions amenés à dire ceci :
« Le choix du thème était hardi, sans doute même est-ce la première fois qu'une telle confrontation était organisée. Pourtant il nous était rapidement apparu, lors de sa conception et de sa préparation, qu'un trait venait en quelque sorte unir les termes en présence : celui de la rareté des signes institués. Nous disons bien les signes« institués» afin de faire la différence avec ces signes, souvent corporels, parfois en actes, qui abondent aussi bien chez les autistes que dans l'éveil de coma. Bien entendu nous ne comptions pas faire de cette rareté le signe, à son tour, d'une proximité étiologique ou simplement descriptive.
Car, du vécu que l'on peut avoir auprès des autistes à celui des personnes en éveil de coma, la différence est suffisamment importante,
leurs présences respectives sont d'une qualité si distincte, que l'on ne saurait exagérer les rapports de ces deux symptomatologies. La
question tournait préalablement bien plutôt autour de celle-ci : quelles sont les conditions institutionnelles que l'on peut favoriser ou établir pour permettre le travail des équipes confrontées à cette rareté, voire cette absence de paroles. Mais en fait n'étions nous pas un peu à côté ?
Sans doute est-ce l'intervention de Jean Oury qui le montre le mieux en situant la question autour de l'émergence. Car évoquer l'émergence, c'est en même temps demander les conditions institutionnelles pour qu'elle soit possible, pour qu'elle soit recueillie et accueillie. Ainsi n'était-ce point la rareté des signes qui pose problème, mais la nécessité d'être là pour rencontrer ce d'où ils émergent.
Nous avions convié, dans cette salle de congrès, des amis. Mais des amis non au sens habituel de ce terme (quoique), mais au sens quasi étymologique de la philia, celui qui qualifie la relation contractuelle réciproque de l'hospitalité, de l'accueil et des obligations de l'« hospitant » (tel est le mot d'Emile Benveniste pour qualifier l'hôte qui reçoit) et du xénos, de l'étranger, de l'hôte reçu. Non des amis dans un cercle qui ferme, mais une amitié prête à accepter le dissemblable, ce type d'amitié que l'on doit s'attendre à trouver dans l'accueil fait à un pensionnaire, un client, un malade, un blessé, autant de noms pour une même réalité humaine.
Les interventions et les débats porteront témoignage qu'il n'en était aucun qui n'eût des lueurs ou des connaissances approfondies sur les champs des autres. C'est ainsi que pourront se tresser des bouts de cordes robustes avec des brins de psychothérapie institutionnelle, de sémiotique, de théorie du coma, du cerveau, de l'autisme.
La première matinée y était consacrée à la fois à la présentation du terrain clinique et aux premières élaborations qui en permettent l'observation, voire parfois la constitution. Les interventions d'Edwige Richer et de Pierre Delion montreront à l'évidence qu'en faisant du jeune autiste ou du blessé en éveil de coma le centre de gravité institutionnel de l'établissement de soin, on retrouve des préoccupations et des réponses étonnamment semblables. Il faut dire que c'est en nous apercevant, il y a quelques années, de cette similitude des réponses que nous avions songé à cette rencontre. La présence des équipes et leur prise de parole durant les deux après-midi venaient alors préciser, ouvrir, vivifier ce que la nécessaire structure des exposés aurait pu massifier. »
Que dire de plus sinon les changements qui ont eu lieu dans la prise en charge des enfants autiste, modifiant l’approche de cette pathologie qui, d’ailleurs, a connu au cours de ces 20 dernières années une transformation considérable. Pour parodier Marx : Un spectre hante le monde : le spectre de l’autisme. L’autisme est quasiment devenu la maladie du siècle et on peut dire que les autistes n’en ont guère été mieux soignés. Ce sera à coup sûr l’un des thèmes de ce nouveau colloque anniversaire.
16 MARS 2019 Invités MARIE FRANCE ET RAYMOND NEGREL
Psychopathologie des soins quotidiens – Une boussole pour soignant désorienté
Mission Sans-Abri de Médecins du Monde
Texte présenté aux XXXIè Journées de Psychothérapie Institutionnelle
12-13 Octobre 2017
Le texte que nous vous présentons aujourd'hui a été élaboré, pensé et rédigé en équipe afin
de vous témoigner de notre travail auprès des personnes sans abri ainsi qu'au sein de notre collectif.
Notre démarche est celle d'aller-vers les personnes de la rue, au rythme de trois ou quatre
maraudes par semaine, de jour ou en soirée, à pied, en civil, régulièrement dans le même périmètre
et toujours en binôme car il est essentiel de ne pas s’engager seul dans la rue. Parce qu’« un homme
seul n'est pas un homme » disait Lacan, nous visons à créer du lien, des liens, afin d'amarrer le sujet
en errance, relever et mettre en mouvement le sujet coulé dans l’asphalte du trottoir. Créer un lien
pour lui permettre d’exister et de s’inscrire dans des soins somatiques ou des prises en charge
sociales. Si le sens de notre action prend racines dans la rue, celle-ci acquiert toute sa signification
au cours et grâce aux réunions hebdomadaires d’échanges et de travail, lieu de récits certes, mais
surtout invitation à la parole avec nos inquiétudes, nos doutes et nos interrogations. Pour nous, une
remise en cause permanente de nos certitudes est plus qu'obligatoire, nous ne pouvons pas y
échapper. Portés par les valeurs de Médecins du Monde, « Soigner et témoigner », toute notre action
s’accompagne d’une attention à l’autre, sans-abri ou Maraudeur, car la précarité n’est pas réservée
aux gens de la rue : elle traverse également le vécu des habitants de la ville, des institutions, des
travailleurs sociaux avec lesquels se tissent des liens invisibles.
La préparation de cette présentation a été l'occasion de nombreux échanges. Écrire pour
s'exposer dans sa parole est toujours une prise de risque, produit des effets inattendus et souvent
féconds ; ici aussi, la mise au travail est venue révéler la tension dialectique qui s’exerce en nous et
entre nous dans la réalisation de « notre mission ».
« Psychopathologie des soins quotidiens, une boussole pour soignant désorienté »… De
prime abord, ce sujet était fait pour nous car parler de désorientation et de boussole à des
maraudeurs, forcément, ça matche ! Les « soins quotidiens » cela semblait bien être notre « job » …
car ce que nous prétendons, c’est prendre soin de la personne sans abri dans une présence aussi
quotidienne que possible. Mais peut-on qualifier notre action de « soins quotidiens » alors que nous
faisons irruption dans la vie des SDF ? Et sommes-nous des soignants ? Psychopathologie des soins
quotidiens, qu’est-ce que cela veut dire ? Avec sa psychopathologie de la vie quotidienne, Freud
révèle l’inconscient qui nous gouverne. Avec cette « psychopathologie des soins quotidiens »,
sommes-nous invités par l’AMPI à nous intéresser à cet inconscient qui se dévoile dans nos
1
errements ? Et de quel inconscient parlons-nous ? Celui des personnes vers lesquelles nous allons
ou le nôtre ? Ainsi, nous avons donc recherché nos impasses, nos dissonances, nos refuges pour
tenter d’entendre quelque chose…
Tel un autre maternel suffisamment bon, notre démarche est d’abord celle d'aller à la
rencontre de cet autre, de ces autres en rupture avec le social, assis sur le macadam une main
tendue, une casquette devant eux. C'est ainsi que nous décidons, au gré de nos pérégrinations, de
nous arrêter sur les bords du chemin et d'adresser un regard, une salutation, au creux du quotidien
de ces personnes exclues, au moment de la manche, du repos, du déjeuner, chez eux, sur ce bord de
trottoir ainsi approprié le temps d'une halte plus ou moins éphémère.
Comment s'adresser à eux et comment être accueillant ? Dans ce mouvement d’aller vers,
nous nous rendons chez eux, nous les interpellons, notre présence, nos mots s’imposent à eux sans
qu’ils n’en aient rien demandé. En retour, ils restent figés, ou nous regardent passivement nous
rapprocher, ils nous serrent la main, nous tendent leur chapeau, nous questionnent : « Qu'est ce que
vous voulez ? »... C’est vrai ça, « qu’est-ce que nous voulons » ?
Pourquoi s’adresse-t-on à un tel plutôt qu’à tel autre ? Qu’est-ce que nous disons à notre
corps défendant en désignant telle ou telle personne comme une personne sans abri ? Chacun fait
selon son inspiration, ses peurs, ses fantasmes, les uns évitent les groupes, les autres les personnes
très alcoolisées, les derniers ceux qui crient … Ce sont nos propres mouvements psychiques qui
nous font nous déplacer vers les uns plutôt que vers les autres.
Aller vers, c’est faire précéder l’offre à la demande. Cela commence toujours par un regard,
un mouvement, un geste et quelques mots :
« Bonjour, comment allez-vous ?»
« Je m'appelle Raymond, je fais partie de MDM, tout va bien ? Vous avez besoin de quelque
chose ? »
« Bonjour, je m'appelle Corinne, est-ce que je peux parler avec vous ? Je ne vous dérange
pas ? »
« Bonjour, est-ce que je peux m'asseoir pour discuter avec vous ? »
« Bonjour, moi c'est Marine et vous, c'est comment ? »
Si nous nous présentons comme une équipe de MDM, ce n’est que très rarement que nous
précisons notre profession, en particulier ceux d’entre nous qui pourraient faire partie des
« soignants », de peur peut-être que cet énoncé ne puisse venir entraver la possibilité de la
rencontre, nous réduisant à n'être les uns et les autres que des soignants et des soignés.
« Bonjour, comment allez-vous ?». Cette phrase que dit-elle de nous ? N’est-ce pas une
étrange façon d’aller vers : de quelle place demandons-nous à l'un de nos semblables comment il va
2
avant même de le connaître ? Apparemment « si naturelle » ou bienveillante, cette phrase ne seraitelle
pas violente ou intrusive ? Elle semble inscrire d'emblée cette personne que nous souhaitons
rencontrer dans une différence ; elle énonce quasi-explicitement nos fantasmes de réparation, elle
véhicule nos représentations de la précarité, nous réduisant le sujet au « sans abrisme ».
« Je m'appelle Raymond, je fais partie de MDM, tout va bien ? vous avez besoin de quelque
chose ? ». L'accroche implique ici une demande matérielle, elle nous protège, légitime notre venue,
correspond à nos projections… Mais ne prend-on pas le risque qu’elle ouvre et ferme la rencontre
dans le même temps ? Sommes-nous vraiment là pour ça ? Pourquoi venons-nous interroger leur
besoin quand le plus souvent nous ne pouvons pas y répondre ?
On le voit, ce premier contact est difficile pour eux peut-être, pour nous certainement. Il n’est pas la
rencontre mais il n’a de sens que s’il peut être inaugural à celle-ci.
Avec pour références la psychothérapie institutionnelle et la psychanalyse, nous voulons
déployer une clinique de l’accueil, d’humanisation du Sujet, une clinique qui permette une mise en
élaboration progressive d'une parole, conduisant à une restauration du sujet et de son espace intime.
Tout en défendant la logique médico-sociale de Médecins du Monde (la survie de chacun et l’accès
aux soins pour tous restent pour nous une préoccupation permanente), nous souhaitons nous situer
dans le champ de l'intime, au plus près du sujet pris dans une double aliénation psychique et sociale.
Comment déployer cette clinique de la présence dans la rue ? Qu’est-ce que la présence dans un
espace qui n’existe pas, en tant qu’il est sans limite et mouvant ? Quel espace notre présence
pourrait-elle ainsi venir habiter ?
Confrontés nous même à l’errance dans nos maraudes, notre premier défi est de rendre notre
présence ni évanescente ni envahissante. Issu du latin sionare, le « soin » signifie « s'occuper de »,
il est « l'attention que l'on porte à faire quelque chose avec propreté, à entretenir quelque chose. » Il
suppose quelque chose de la continuité, de la quotidienneté. C’est alors cette répétition dans le
temps qui est l’objet de notre attention. La régularité de nos maraudes et nos rituels langagiers ou
gestuels viennent scander le temps, marquer des limites à l’espace informe et crée les possibilités de
la rencontre. Ils nous rendent présents. C’est cela notre premier engagement et c’est le plus
exigeant.
Car cette continuité et cette position d’accueil sont difficiles à tenir.
Nous croisons un jour Emile, avec qui nous avons développé quelques liens au fil de nos maraudes,
parlant avec lui de son histoire comme de l'Histoire de la France, de musique et de littérature, de
chiens … Allant vers lui, l'un de nous demande une première fois « Comment allez vous ? »,
« bien » répond-il. Nous sommes sur une artère passante, il y a beaucoup de bruit, nous nous
asseyons par terre près de lui. Distraits par cette installation, nous n’entendons pas sa réponse et ré-
3
itérons la question « Comment allez vous ? ». Emile se lève brusquement, cherchant à échapper à
notre présence, il s'énerve, crie : « Mais qu'est ce que vous me voulez à la fin je n'ai pas besoin de
tuteur moi, je n'ai pas besoin d'un tuteur ! ». Nous restons figés, désarçonnés, décontenancés,
plongés dans notre incompréhension. Nous tentons de le calmer mais rien n’y fait, il est debout,
s'agite, très impressionnant. Après un échange de regard, nous prenons la décision de partir face à
son refus de nous parler et le saluons timidement.
Que s’est-il passé pour Emile dans cette rencontre ? Quelle absence, quelle intrusion serions-nous
venus introduire ou incarner ?
Dans un après coup, une fois l'émotion de cette altercation atténuée, nous réalisons que, pour la
première fois, avant d’aller vers lui, nous nous étions adressés à un autre homme non loin de lui.
Cet événement, pourtant anodin, serait-il venu souligner notre appartenance à Médecins du Monde
et placer Emile comme un SDF parmi tant d'autres ? Comme si, tout à coup, nous n'étions plus sur
un pied d'égalité, nous venions représenter un grand Autre social trop persécuteur, un « tuteur ».
Dans « tuteur » il y a presque tueur… Nous sommes-nous montrés défaillant à ne pas l’entendre,
trop pris par notre propre installation ? Avons-nous fait intrusion chez lui ? Nous n’avions pas
demandé si nous pouvions entrer…
Ainsi, entre une absence d'Autre social fuyant ou un vécu de sa trop grande présence
touchant à la persécution, nous nous situons sur un fil de funambule, tentant de ne pas vaciller entre
deux écueils. Notre engagement dans la continuité est une nécessité lorsque nous faisons le pari
d'un possible, d'une création dans et par le lien. Pour nous qui n’apportons rien, cette présence à
l’Autre n’est faite que de cette continuité. Elle est notre clinique du quotidien, dans la répétition
régulière de nos mots et de nos mouvements venant différencier les espaces pour permettre de les
habiter. Répétition des soins de cet autre souvent maternel, renforçant le sentiment de continuité
d’existence et débouchant sur la construction d’un récit, d’une histoire, commune qui nous lie les
uns aux autres.
Pour les sujets souffrant de troubles psychiatriques, la rencontre avec l'Autre dans la rue,
peut avoir pour conséquence une déglaciation selon les termes de Salomon Resnik, une réanimation
psychique du sujet, où nous devons faire attention aux mouvements de retour de refoulés, à la
résurgence d'événements traumatiques, de mouvements d'agressivité, dans ces moments
particulièrement intenses. Entre défaut ou excès de circulation, telles deux faces d'une même pièce,
« l'asphaltisation » comme l’errance viennent anesthésier le sujet dans la rue, dire son impossible
inscription dans le monde et le « tenir » à distance. L'émergence d'un discours adressé à un Autre
pourrait entraîner une hémorragie psychique ou réactiver une fuite, face à l'incapacité d'inscription
en un lieu, en une temporalité fixe et faisant sens pour le sujet. Alors que d'autres patients peuvent
4
se mouvoir physiquement comme psychiquement entre différents lieux, dans une possibilité de
circulation entre les espaces externes et intimes, les plus fragiles dans la rue n’ont souvent pour seul
lieu de référence que l'asphalte même, où le bord du trottoir peut venir marquer un bord de
précipice psychique à la chute sans fond.
L’histoire de la mission est celle de ces moments heureux où les personnes avec lesquelles se
sont tissées des liens ont pu trouver un lieu où s’inscrire, vivre ; mais elle est aussi celle de moments
douloureux où la décompensation somatique ou psychique nous rappelle parfois dramatiquement
que ce qui nous paraît urgent ne l’est pas toujours, et que le temps de l’action doit respecter le temps
psychique du sujet. Nous pourrions ainsi vous raconter l’histoire de Jean Claude ou celle de
Georges qui sont décédés quelques mois suite à leur mise à l’abri.
Survivre est parfois plus facile que vivre.
L’équilibre est fragile, la continuité délicate à maintenir, mise à mal par le Réel. « L’absurde
naît de cette confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable du monde », nous dit
Albert Camus dans Le mythe de Sisyphe (1942). Cette clinique de l'extrême, de l’absurde nous
plonge inlassablement dans un non sens.
Travailler en équipe, marauder en binôme ainsi que penser et développer notre boîte à outils
deviennent alors sans cesse nécessaires : sans cela, comment penser cet absurde, comment faire face
à cette violence ? Sans réflexion, il y a ou trop ou pas assez de retour, de continuité, prenant le
risque de faire vaciller les fragiles constructions subjectives bâties sur les bords de l’errance ou de
l’asphaltisation.
La question du don revient massivement dans nos réflexions. Elle est omniprésente par la
misère qui s’offre à nos yeux ou par la demande plus ou moins explicite des personnes que nous
rencontrons.
Cette dernière nous ramène une nouvelle fois à l'absurde et à l’inconfort de notre démarche. Faut-il
ou non donner ? Si nous donnons un jour, que fera-t-on le jour suivant ? Si nous ne donnons pas, ne
faillons-nous pas à être cet être secourable ?
Nous en parlons sans cesse en réunion :
« Quand je rencontre quelqu'un qui a vraiment faim comme ce soir, je fais quoi : je parle ou je
lui donne un sandwich ? »
« Moi je les nourris d'abord pour qu'ils parlent la semaine d'après. »
J’ai rencontré Jean, je l’ai invité à venir à la Sardinade. Il m’a rétorqué « Tu vas pas m'acheter
avec des sardines. »
5
« On rencontre un slovaque qui nous demande sans arrêt des baskets du 47, mais c'est pas
évident de trouver des baskets du 47 ! On a fait tous les magasins de sport mais ils s'arrêtaient
au 45, on était désespéré. Finalement, le mec a disparu une fois qu'on les avait trouvés,
heureusement qu'on les a pas acheté ! »
Moi l’autre jour j’ai demandé « Qu'est ce qui pourrait vous faire plaisir ? »… et du coup il m’a
répondu : « Vous croyez qu'on a beaucoup de plaisir dans la rue ? »
« Moi j'avais à manger quand j’ai maraudé hier et donc je leur ai donné… On dira que c'est
parce que je suis nouvelle, que je savais pas qu’on ne donnait pas. »
Nous nous sommes réunis en séminaire l’année passée pour tenter cette question.
A cette occasion, sous avons redit le fondement de notre mission : s'intéresser avant tout à la
relation et ce, sans céder sur notre désir qui risquerait de nous plonger dans du pur humanitaire.
Pour cela, notre travail est d’accepter la frustration de ne pas aider matériellement, de se confronter
à la castration, de se dégager d'une position où nous voudrions faire pour l'autre, à sa place. Nous
sommes là sans rien, et dans ce « rien » se cristallise toute notre position soignante, car, ne venant
rien boucher de la relation avec un objet, nous laissons plutôt dérouler quelque chose du sujet et de
sa demande. Ce rien ouvre le don de confiance et la relation transférentielle. Ce que nous offrons,
c’est nous-même, notre personne propre comme lieu d'adresse Autre où nous accueillons une
singularité malmenée par les errements de l'exil ou de la fuite, les problématiques toxicomanes,
psychotiques ou encore les questions existentielles propres à chaque sujet.
Pour autant, nous ne pouvons laisser quelqu’un mourir de froid dans la rue, ou sans eau en
plein été. Et il n’y a pas à se questionner : ils ont froid, on donne le duvet, ils ont soif, on donne de
l’eau. Toute la difficulté est que cet objet vital ne devienne pas alors tout l’enjeu de la relation : il
est un à-côté sur lequel nous n'avons pas à nous arrêter. Ainsi, nous sommes partis contents de notre
séminaire avec un nouvel outil en poche « L’objet n’est pas un enjeu » !
Soit « l'objet n'est pas un enjeu », mais que devons-nous faire lorsqu'il semble le devenir ?
Nous rencontrons régulièrement un groupe d'hommes. Parmi eux, des personnes qui ont un abri la
nuit mais errent toute la journée durant, d’autres qui sont dans des squats ou à la rue. Plusieurs
d’entre eux ont des soucis de santé importants. Ils sont pour certains pris en charge par des équipes
partenaires sociales ou sanitaires. En lien avec eux, nous tentons de nous rendre présents à eux pour
accompagner à terme les plus fragiles vers les soins. Souvent, quand nous allons les voir, ils sont
alcoolisés et continuent à s'alcooliser devant nous tout en étant toujours accueillants.
Une fois, ils nous demandent à manger. Parce que nous sentons que certains d’entre eux sont en
grande difficulté et parce que « l’objet n’est pas un enjeu » et que, on leur achète de quoi se faire
6
des sandwichs. Une fois, deux fois, trois fois… Chaque fois qu'un binôme de maraudeurs passe les
voir, ils sont par un transfert massif et une demande matérielle qui prend de plus en plus de place.
Nous en parlons, y retournons, et cette fois, on les accompagne pour qu’ils achètent eux-mêmes.
Lors d'une maraude où ils ne sont que trois, ils disent avoir froid ; nous nous engageons à leur
ramener des duvets, tel jour vers telle heure. Au moment prévu, nous arrivons avec nos trois
duvets : ils sont cinq ! Embêtés, nous tentons de tenir quelque chose de notre parole ou de se
protéger derrière l'énonciation d'une règle : « Les duvets étaient pour telle et telle personne, si vous
en voulez on vous en ramène la prochaine fois ». L’agitation, le ton montent… Nous nous sentons
pris dans des enjeux groupaux qui nous échappent. Nous laissons les 3 duvets, très soucieux des
effets de ce « don insuffisant », un instant angoissés à l'idée qu'ils puissent se battre, tentant de se
rassurer l'instant d'après en se disant qu'ils en ont régulièrement et « de toute façon, ils les
revendent ». Nous nous défendons comme nous pouvons, face à nos fantasmes, et cette réalité en
étroite collusion avec un Réel inquiétant.
Quelques jours plus tard, une autre équipe, une autre maraude. Ils sont toujours en groupe.
Le dialogue s’engage mais nous sommes préoccupés par Rachid qui est très affaibli. Il ne veut pas
qu’on appelle les secours ni aller consulter. Il tremble. Très hésitants, nous finissons par prendre
congés d’eux. Puis nous revenons sur nos pas, inquiets, pour proposer un café ou un chocolat chaud.
Amine nous agresse : « Et vous croyez qu’on a besoin de vous pour cela ? »... et « D’ailleurs à quoi
vous servez ? ». D’autres membres du groupe viennent nous protéger « Tu sais bien qu’il n’apporte
pas à manger, MDM ! ». Rachid nous retient par le regard mais ne s’exprime pas. Amine se lève,
l’excitation croît. Les autres calment le jeu « Vous pouvez y aller, ne vous inquiétez pas ». Nous
repartons.
Dans la rencontre avec ce groupe, plusieurs phénomènes sont venus se télescoper : le
groupe, la présence parmi ses membres de Rachid, très affaibli, épileptique et grand alcoolique,
objet de notre souci, le froid,… Et l’effet de notre séminaire de réflexion venu nous mettre à l’abri
de notre inconfort par cette belle formule que « l’objet n’est pas l’enjeu ». Lors de nos reprises en
réunion hebdomadaire, dans un travail de constellation transférentielle, nous avons pu toucher du
doigt ce qui sans doute s’était joué à notre insu : nous avons découvert que dans ce groupe, Amine
avait une place de leader, de protecteur… En apportant ces duvets, en prenant soin de Rachid, nous
étions venus déstabiliser le fonctionnement du groupe et peut-être destitué Amine dans la place qu’il
prenait en son sein...
Nous sommes en permanence aux prises de ce conflit : d’un côté agir face à la maladie et à
la misère et d’un autre désirer respecter le temps psychique du sujet.
Si l’objet n’est pas en enjeu, la place de l’objet dans les relations que nous tissons avec les
personnes de la rue ne serait-elle pas tout l’enjeu de notre propre travail psychique ? Ne serait-ce
7
pas dans l’analyse « psychopathologique de nos dons » que les soignants désorientés que nous
sommes pourraient trouver leur boussole ?
Nous rencontrons un couple, Anne et Vincent. Anne est enceinte de sept mois. Cette situation
est pour nous tout de suite une urgence, il faut que nous puissions être là si besoin est au moment
de l’accouchement. Trois maraudeurs vont à leur rencontre plus régulièrement et leur donnent
un numéro de téléphone. Vincent, toxicomane, n’est pas suivi ; Anne dit être « clean », elle est suivie
par un CSAPA. A chacune de nos rencontres, ils nous rassurent tout en nous demandant implicitement
quelque chose, jamais directement. De l’argent surtout, pour manger, pour une nuit d’hôtel,
pour préparer la venue du bébé… On hésite à donner, puis on donne, on se réunit, on en parle, puis
on hésite…
- Pourquoi de l’argent ? Est-ce pour acheter de la drogue ?
- Ils ne peuvent pas rester à la rue, cet enfant ne peut pas naître dans le caniveau, nous devons
leur payer l’hôtel jusqu’à l’accouchement…
Tout nous fige. Cet enfant qui peut naître sur le trottoir c’est l’image de cette détresse primordiale
qui vient nous cueillir. Nous sommes comme fascinés, pris par cet hilflos mortifère, par
cette jouissance inconsciente face au spectacle voyeuriste d'une réalité de la misère confinant au
Réel. Nous ajoutons des réunions "exceptionnelles" au mois d'août, on essaie d'élaborer autour de
cette demande toujours implicite mais omniprésente. Nous relevons toutes les incohérences de leur
discours, nous tentons de comprendre leur demande. Nous les connaissons peu finalement, nous
n’avons que très peu d'éléments de leur histoire. Nos fantasmes viennent recouvrir la réalité… On
imagine, se répète, se questionne, puis... On redescend sur terre... Et de nouveau on imagine, se répète,
se questionne. Bref, nous tournons en rond avec l'envie et le besoin pour eux comme pour
nous de se décaler de ce temps chronologique mais dans une impossibilité. Ce bébé va arriver, elle
va accoucher et le risque qu'elle accouche dans la rue est grand. C'est une urgence mais le temps logique
de l'inconscient ne prend, lui, pas en compte cette urgence.
Le temps passe... Elle accouche, tout se passe bien même si c’est moins une. Les analyses
révèlent de nombreux toxiques dans le sang de la mère. S’ensuit le sevrage du bébé. Le père arrive à
s'engager dans une prise en charge. Ils sont suivis par la maternité puis par trois associations différentes
au moins. Nous travaillons avec les autres acteurs ; ils tentent de répondre à leur demande,
cèdent puis lâchent : la maternité les fait sortir, une association leur donne une somme d’argent pour
une mise à l’abri temporaire avec l’enfant puis disparaît... Semble ainsi se répéter un mouvement où
l’objet n’arrive jamais à satisfaire la demande mais où il vient rompre les liens. Pendant ce temps là,
nous tentons de maintenir un lien. Ils ne nous appellent que pour demander. Nous avions donné un
peu d’argent pour quelques nuits d’hôtel avant l’accouchement… Cet argent n’a sans doute pas ser-
8
vi à cela… Nous cédons à nouveau sur les couches et sur la poussette, « parce que c’est le soin du
bébé et que cela fait partie de la mission de MDM »… en fait la PMI fournit déjà tout cela… Nous
voilà nous aussi pris dans leur propre répétition… Mais nous le lâchons pas, nous tentons de rester
là pour eux, au-delà des demandes… Nous les écoutons, nous parlons de leur demande, nous ne disons
non, nous tentons de les accompagner vers des acteurs qui pourraient les aider… Et ce faisant,
ils continuent à nous rappeler, un lien semble s’être créé. Et demain ? Nous n’en savons rien, nous
tentons de rester connecté sans imposer notre présence.
De quel objet parlons-nous ?
Il y a l’objet qui répond aux besoins de première nécessité sans lequel il n’y a pas de vie. La
mère nourrit l’enfant de lait et de mots. Dans le dénuement extrême, et c’est le cas pour tous ces
corps échoués sur l’asphalte, rigidifiés par le froid, l’ivresse ou la chaleur, il ne peut y avoir d'autre
maternel sans ses soins de première nécessité.
Il y a l’objet qui est le support à la découverte de l’environnement, l’objet sur lequel vient
s’étayer la relation, l’objet qui permet de parler. Pendant plusieurs années, un membre de la mission
a apporté à un monsieur psychotique qui vivait dans la rue chaque semaine, une canette de coca et
une orange. De canette en orange s’est tissé un lien qui a permis après plusieurs années de mettre à
l’abri ce monsieur. Et aujourd’hui encore, on lui apporte cette canette et cette orange hebdomadaire.
Ces objets ont ouvert la possibilité d’un autre. Le don invite au contre-don, selon Marcel Mauss, il
est au fondement de l’échange et de l’organisation sociale.
Et puis il y a l’objet qui vient boucher la demande, parce qu’il la précède, la camoufle. Cet
objet qui nous rend sourd en nous enfermant dans notre satisfaction narcissique.
Citons une personne anciennement SDF « Donner, je trouve que ça instaure une hiérarchie. On
n’est pas sur un pied d’égalité, cela nous met en dette. J’ai beaucoup de reconnaissance vis-à-vis
de ce que l’on m’a donné quand j’étais SDF, mais revenir à la vraie vie, ce n’est pas être redevable
tout le temps. Quand on reprend sa place d’humain, on doit pouvoir refuser cette dette ».
La place de l’objet est chaque fois à repenser selon les situations, avant et sur le moment mais
surtout dans l’après-coup car ce qui compte, ce n’est pas tant ce que nous faisons ou donnons dans
la rue (faire et donner c’est aussi prendre le risque de la vie), ce qui importe c’est la pensée qui suit
nos actes. Car c’est dans l’après-coup qu’un acte peut devenir passage à l’acte.
9
En conclusion : une clinique de l’humanité
« Tous les jours, pendant six mois, un ouvrier civil italien [Lorenzo] m'apporta un morceau de pain
et le fond de sa gamelle de soupe ; il me donna un de ses chandails rapiécés et écrivit pour moi une
carte postale qu'il envoya en Italie et dont il me fit parvenir la réponse. Il ne demanda rien et
n'accepta rien en échange, parce qu'il était bon et simple, et ne pensait pas que faire le bien dût
rapporter quelque chose. […] Je crois que c'est justement à Lorenzo que je dois d'être encore vivant
aujourd'hui, non pas tant pour son aide matérielle que pour m'avoir constamment rappelé, par sa
présence, par sa façon si simple et facile d'être bon, qu'il existait encore, en dehors du nôtre, un
monde juste, des choses et des êtres encore purs et intègres que ni la corruption ni la barbarie
n'avaient contaminés, qui étaient demeurés étrangers à la haine et à la peur ; quelque chose
d'indéfinissable, comme une lointaine possibilité de bonté, pour laquelle il valait la peine de se
conserver vivant. [...] C'est à Lorenzo que je dois de n'avoir pas oublié que moi aussi j'étais un
homme. » Primo Levi, Si c'est un homme, (1947), p.186-190.
A l'heure d'un lien social tarifé, marchandisé, contre-sens anthropologique, selon le mot de
l'économiste Frédéric Lordon, notre mission de rue vient s'inscrire dans les rides d'un travail
abandonné par le politique, se reposant sur le secteur associatif et militant. Nous nous situons ainsi
aux confluences étymologiques du creux, ruga, la rue, la ride, d'un visage courroucé et sévère, le
creux marquant aussi l'espace entre deux bords. Ici s'établit une première tache sur laquelle nous
nous portons : du bordage, de l'étayage, auprès d'une population délaissée et fragilisée, sur les dérives
de nos artères urbaines, quand celle-ci ose encore s'afficher honteusement, dont les sujets sont
en proie à la violence, autant sociale que singulière, psychique, pulsionnelle, inconsciente. De
déliaisons psychiques en déliaisons sociales, de l'exclusion à l'auto-exclusion et l'asphaltisation du
corps dans le béton, notre clinique a pour principal objet d'ouvrir un lieu d'adresse à un Autre
permettant un amarrage du Sujet dans un discours et une relation, un espace de parole qui pourra
permettre de surcroît de déplier une histoire, un vécu traumatique et des événements de vie ayant
abouti à des processus mortifères. Comme l'explique Michèle Benhaïm dans son dernier livre Les
passions vides : « Notre travail clinique n'est pas mesurable, car combien coûte un sourire ? Ce
travail est une nécessité, une obligation, une exigence, car le vide est contagieux. Faisons le pari
qu'il existe des processus de création au sein même de l'effondrement subjectif, que ces mouvements
seront propices à lier les égarements, et que des forces d'ancrage ouvriront un horizon là où il nous
apparaît, pour l'instant, comme obstrué. ». Cela résume ce qui de façon continue nous porte, où
nous misons que dans cette errance physique et psychique rencontrée dans la rue, un amarrage est
possible, une inscription dans un champ social et discursif. Ces hommes et ces femmes qui se vivent
10
comme n'ayant pas de place dans le monde en sont exclus, ils sont ceux qu'on aimerait ne pas voir,
ne pas entendre, et qui pourtant, par leur présence, viennent nous rappeler les effets de destruction
et de rupture de liens de notre société. Notre tâche vise à restaurer ces liens rompus par la misère et
la violence. Notre clinique est alors de permettre que ces sujets s'autorisent à retrouver ou parfois
même trouver une place dans le monde, dans une idéologie de plaidoyer pour l’hétérogène et une
anti-conformité au modèle social pour ceux ayant fait le choix de la marginalité.
C'est en voyant dans le petit autre l'humanité que l'on peut redécouvrir la sienne propre, dans une
fraternité autour de la souffrance humaine selon le mot de Pierre Delion, et sa potentialité
d'inscription dans le champ social.
Dans cette clinique que nous appellerons la clinique de l’humanité, notre posture est donc
d'accepter l'inconfort et l'intranquillité, que l’on peut voir comme la résultante des projections des
personnes sans abri, des motions qu’elles nous renvoient et prennent dès lors une grande place dans
notre imaginaire, dans nos fantasmes, souvent morbides et angoissants, qui peut tendre à nous
aliéner dans la relation établie.
L'inconfort et l’intranquillité aussi d’une position de maraudeur qui peine à se définir. Face à
une réalité qui confine au réel, notre travail est d’éviter les refuges de nos positions défensives de
« psy » qui refuserait toute incursion dans la réalité et ne voudrait rien voir des besoins d’étayage
sur l’objet, de celles de travailleurs sociaux qui tendraient à boucher le trou d'une demande que nous
ne pourrions plus entendre au-delà de sa matérialité, de celles de médecins qui ne verraient plus le
sujet mais le seul corps échoué et souffrant.
Notre inconfort et notre intranquillité, c’est donc aussi notre renoncement.
Renoncement à être des sauveurs, à venir soulager la souffrance immédiate ou satisfaire la demande
apparente, à donner à la personne ce dont elle manquerait et dont l’absence l’éloignerait de notre
monde.
Renoncement à être des « psy » (ce que nous ne sommes jamais pour eux car ne nous présentant pas
ainsi), à travailler avec eux sur leur transfert. C’est plutôt sur notre transfert qu’il nous faut travailler
et pour que peut-être, dans un effet collatéral, puisse émerger un discours du sujet dans la régularité
des rencontres.
Renoncement donc à notre position de toute-puissance.
Alors, « Qu’est-ce qu’on fout là ? » comme le dit Oury… C’est cette question que nous
remettons finalement inlassablement sur le métier pour tenter de tisser ces liens, qui ne cesse de
nous travailler en chaque instant de la rencontre.
Nous devons alors, entre maraudeurs, nous porter mutuellement, afin de ne pas tomber dans
ce qu'il en serait d'une fascination, d'une jouissance inconsciente. Nous devons dans cette rencontre
11
faire montre d'un étayage respectif entre nous, afin de permettre un décalage de possibles postures
défensives face à ces situations de misère, miseria, malheur, détresse, qui inspire la pitié, en-deçà de
la pauvreté, pauper, produire peu, mais qui peut encore laisser des espaces de création possible.
Dans ce portage mutuel, chaque membre prend alors une fonction thérapeutique spécifique pour les
autres bénévoles, et les sujets de la rue, dans une constellation transférentielle étayante, plurielle,
diffractée. Nous pouvons ainsi faire collectivement face aux effets de violence qui nous sont
renvoyés, dans une posture d'accueil et de maintien d'une dignité humaine. Quand la mort peut
rôder au coin de l'hypothermie hivernale, de la déshydratation estivale, de la violence physique, ou
de l'abandon de soi, hors de la communauté des hommes, l'homme ne serait plus qu'un coquillage
vide, un musel man.
La mission sans abri existe de puis 13 ans. Au départ, elle offrait des consultations aux
personnes sans abri ; aujourd’hui elle propose ce travail d’aller vers et de création de liens. Cette
mission prend tout son sens dans les articulations qu’elle propose avec les partenaires du réseau.
Nous sommes des passeurs, ces liens que nous construisons avec les personnes, nous tentons de les
reproduire avec les acteurs qui interviennent en amont ou en aval de notre action dans les prises en
charge sanitaires et sociales. Ainsi, nous tentons de déployer un maillage solidaire, rigoureux et
attentif autour de la personne sans abri.
Face à une population sans abri de plus en plus nombreuse, protéiforme, confrontée à des
difficultés de plus en plus grande devant la raréfaction des réponses institutionnelles ou associatives
faute de financement, face aux phénomènes migratoires qui ne font que commencer, nous vivons la
maraude comme un acte politique. C’est pour nous un engagement citoyen et concret, fait au
quotidien d’interrogations, de curiosité, de passion plus que de compassion. La frontière entre le
SDF et soi-même est étroite : qui va soigner qui en vérité ? » « Qui sauve un homme, sauve
l'humanité » dit le Talmud.
Cet acte politique doit s’ouvrir. S’ouvrir aux autres citoyens, s’ouvrir aux réseaux de
proximité. C’est dans ce sens que nous souhaitons dans les années à venir faire évoluer notre
action : associer de plus en plus largement les citoyens, les partenaires, et les acteurs locaux du
territoire, en essayant de transmettre quelque chose de la complexité de cette clinique de l’humanité.
BAIDI Christophe – DIMECH Amélie – DOUENEL Corinne – NEGREL Raymond
12
Mission Sans-Abri de Médecins du Monde
Texte présenté aux XXXIè Journées de Psychothérapie Institutionnelle
12-13 Octobre 2017
Le texte que nous vous présentons aujourd'hui a été élaboré, pensé et rédigé en équipe afin
de vous témoigner de notre travail auprès des personnes sans abri ainsi qu'au sein de notre collectif.
Notre démarche est celle d'aller-vers les personnes de la rue, au rythme de trois ou quatre
maraudes par semaine, de jour ou en soirée, à pied, en civil, régulièrement dans le même périmètre
et toujours en binôme car il est essentiel de ne pas s’engager seul dans la rue. Parce qu’« un homme
seul n'est pas un homme » disait Lacan, nous visons à créer du lien, des liens, afin d'amarrer le sujet
en errance, relever et mettre en mouvement le sujet coulé dans l’asphalte du trottoir. Créer un lien
pour lui permettre d’exister et de s’inscrire dans des soins somatiques ou des prises en charge
sociales. Si le sens de notre action prend racines dans la rue, celle-ci acquiert toute sa signification
au cours et grâce aux réunions hebdomadaires d’échanges et de travail, lieu de récits certes, mais
surtout invitation à la parole avec nos inquiétudes, nos doutes et nos interrogations. Pour nous, une
remise en cause permanente de nos certitudes est plus qu'obligatoire, nous ne pouvons pas y
échapper. Portés par les valeurs de Médecins du Monde, « Soigner et témoigner », toute notre action
s’accompagne d’une attention à l’autre, sans-abri ou Maraudeur, car la précarité n’est pas réservée
aux gens de la rue : elle traverse également le vécu des habitants de la ville, des institutions, des
travailleurs sociaux avec lesquels se tissent des liens invisibles.
La préparation de cette présentation a été l'occasion de nombreux échanges. Écrire pour
s'exposer dans sa parole est toujours une prise de risque, produit des effets inattendus et souvent
féconds ; ici aussi, la mise au travail est venue révéler la tension dialectique qui s’exerce en nous et
entre nous dans la réalisation de « notre mission ».
« Psychopathologie des soins quotidiens, une boussole pour soignant désorienté »… De
prime abord, ce sujet était fait pour nous car parler de désorientation et de boussole à des
maraudeurs, forcément, ça matche ! Les « soins quotidiens » cela semblait bien être notre « job » …
car ce que nous prétendons, c’est prendre soin de la personne sans abri dans une présence aussi
quotidienne que possible. Mais peut-on qualifier notre action de « soins quotidiens » alors que nous
faisons irruption dans la vie des SDF ? Et sommes-nous des soignants ? Psychopathologie des soins
quotidiens, qu’est-ce que cela veut dire ? Avec sa psychopathologie de la vie quotidienne, Freud
révèle l’inconscient qui nous gouverne. Avec cette « psychopathologie des soins quotidiens »,
sommes-nous invités par l’AMPI à nous intéresser à cet inconscient qui se dévoile dans nos
1
errements ? Et de quel inconscient parlons-nous ? Celui des personnes vers lesquelles nous allons
ou le nôtre ? Ainsi, nous avons donc recherché nos impasses, nos dissonances, nos refuges pour
tenter d’entendre quelque chose…
Tel un autre maternel suffisamment bon, notre démarche est d’abord celle d'aller à la
rencontre de cet autre, de ces autres en rupture avec le social, assis sur le macadam une main
tendue, une casquette devant eux. C'est ainsi que nous décidons, au gré de nos pérégrinations, de
nous arrêter sur les bords du chemin et d'adresser un regard, une salutation, au creux du quotidien
de ces personnes exclues, au moment de la manche, du repos, du déjeuner, chez eux, sur ce bord de
trottoir ainsi approprié le temps d'une halte plus ou moins éphémère.
Comment s'adresser à eux et comment être accueillant ? Dans ce mouvement d’aller vers,
nous nous rendons chez eux, nous les interpellons, notre présence, nos mots s’imposent à eux sans
qu’ils n’en aient rien demandé. En retour, ils restent figés, ou nous regardent passivement nous
rapprocher, ils nous serrent la main, nous tendent leur chapeau, nous questionnent : « Qu'est ce que
vous voulez ? »... C’est vrai ça, « qu’est-ce que nous voulons » ?
Pourquoi s’adresse-t-on à un tel plutôt qu’à tel autre ? Qu’est-ce que nous disons à notre
corps défendant en désignant telle ou telle personne comme une personne sans abri ? Chacun fait
selon son inspiration, ses peurs, ses fantasmes, les uns évitent les groupes, les autres les personnes
très alcoolisées, les derniers ceux qui crient … Ce sont nos propres mouvements psychiques qui
nous font nous déplacer vers les uns plutôt que vers les autres.
Aller vers, c’est faire précéder l’offre à la demande. Cela commence toujours par un regard,
un mouvement, un geste et quelques mots :
« Bonjour, comment allez-vous ?»
« Je m'appelle Raymond, je fais partie de MDM, tout va bien ? Vous avez besoin de quelque
chose ? »
« Bonjour, je m'appelle Corinne, est-ce que je peux parler avec vous ? Je ne vous dérange
pas ? »
« Bonjour, est-ce que je peux m'asseoir pour discuter avec vous ? »
« Bonjour, moi c'est Marine et vous, c'est comment ? »
Si nous nous présentons comme une équipe de MDM, ce n’est que très rarement que nous
précisons notre profession, en particulier ceux d’entre nous qui pourraient faire partie des
« soignants », de peur peut-être que cet énoncé ne puisse venir entraver la possibilité de la
rencontre, nous réduisant à n'être les uns et les autres que des soignants et des soignés.
« Bonjour, comment allez-vous ?». Cette phrase que dit-elle de nous ? N’est-ce pas une
étrange façon d’aller vers : de quelle place demandons-nous à l'un de nos semblables comment il va
2
avant même de le connaître ? Apparemment « si naturelle » ou bienveillante, cette phrase ne seraitelle
pas violente ou intrusive ? Elle semble inscrire d'emblée cette personne que nous souhaitons
rencontrer dans une différence ; elle énonce quasi-explicitement nos fantasmes de réparation, elle
véhicule nos représentations de la précarité, nous réduisant le sujet au « sans abrisme ».
« Je m'appelle Raymond, je fais partie de MDM, tout va bien ? vous avez besoin de quelque
chose ? ». L'accroche implique ici une demande matérielle, elle nous protège, légitime notre venue,
correspond à nos projections… Mais ne prend-on pas le risque qu’elle ouvre et ferme la rencontre
dans le même temps ? Sommes-nous vraiment là pour ça ? Pourquoi venons-nous interroger leur
besoin quand le plus souvent nous ne pouvons pas y répondre ?
On le voit, ce premier contact est difficile pour eux peut-être, pour nous certainement. Il n’est pas la
rencontre mais il n’a de sens que s’il peut être inaugural à celle-ci.
Avec pour références la psychothérapie institutionnelle et la psychanalyse, nous voulons
déployer une clinique de l’accueil, d’humanisation du Sujet, une clinique qui permette une mise en
élaboration progressive d'une parole, conduisant à une restauration du sujet et de son espace intime.
Tout en défendant la logique médico-sociale de Médecins du Monde (la survie de chacun et l’accès
aux soins pour tous restent pour nous une préoccupation permanente), nous souhaitons nous situer
dans le champ de l'intime, au plus près du sujet pris dans une double aliénation psychique et sociale.
Comment déployer cette clinique de la présence dans la rue ? Qu’est-ce que la présence dans un
espace qui n’existe pas, en tant qu’il est sans limite et mouvant ? Quel espace notre présence
pourrait-elle ainsi venir habiter ?
Confrontés nous même à l’errance dans nos maraudes, notre premier défi est de rendre notre
présence ni évanescente ni envahissante. Issu du latin sionare, le « soin » signifie « s'occuper de »,
il est « l'attention que l'on porte à faire quelque chose avec propreté, à entretenir quelque chose. » Il
suppose quelque chose de la continuité, de la quotidienneté. C’est alors cette répétition dans le
temps qui est l’objet de notre attention. La régularité de nos maraudes et nos rituels langagiers ou
gestuels viennent scander le temps, marquer des limites à l’espace informe et crée les possibilités de
la rencontre. Ils nous rendent présents. C’est cela notre premier engagement et c’est le plus
exigeant.
Car cette continuité et cette position d’accueil sont difficiles à tenir.
Nous croisons un jour Emile, avec qui nous avons développé quelques liens au fil de nos maraudes,
parlant avec lui de son histoire comme de l'Histoire de la France, de musique et de littérature, de
chiens … Allant vers lui, l'un de nous demande une première fois « Comment allez vous ? »,
« bien » répond-il. Nous sommes sur une artère passante, il y a beaucoup de bruit, nous nous
asseyons par terre près de lui. Distraits par cette installation, nous n’entendons pas sa réponse et ré-
3
itérons la question « Comment allez vous ? ». Emile se lève brusquement, cherchant à échapper à
notre présence, il s'énerve, crie : « Mais qu'est ce que vous me voulez à la fin je n'ai pas besoin de
tuteur moi, je n'ai pas besoin d'un tuteur ! ». Nous restons figés, désarçonnés, décontenancés,
plongés dans notre incompréhension. Nous tentons de le calmer mais rien n’y fait, il est debout,
s'agite, très impressionnant. Après un échange de regard, nous prenons la décision de partir face à
son refus de nous parler et le saluons timidement.
Que s’est-il passé pour Emile dans cette rencontre ? Quelle absence, quelle intrusion serions-nous
venus introduire ou incarner ?
Dans un après coup, une fois l'émotion de cette altercation atténuée, nous réalisons que, pour la
première fois, avant d’aller vers lui, nous nous étions adressés à un autre homme non loin de lui.
Cet événement, pourtant anodin, serait-il venu souligner notre appartenance à Médecins du Monde
et placer Emile comme un SDF parmi tant d'autres ? Comme si, tout à coup, nous n'étions plus sur
un pied d'égalité, nous venions représenter un grand Autre social trop persécuteur, un « tuteur ».
Dans « tuteur » il y a presque tueur… Nous sommes-nous montrés défaillant à ne pas l’entendre,
trop pris par notre propre installation ? Avons-nous fait intrusion chez lui ? Nous n’avions pas
demandé si nous pouvions entrer…
Ainsi, entre une absence d'Autre social fuyant ou un vécu de sa trop grande présence
touchant à la persécution, nous nous situons sur un fil de funambule, tentant de ne pas vaciller entre
deux écueils. Notre engagement dans la continuité est une nécessité lorsque nous faisons le pari
d'un possible, d'une création dans et par le lien. Pour nous qui n’apportons rien, cette présence à
l’Autre n’est faite que de cette continuité. Elle est notre clinique du quotidien, dans la répétition
régulière de nos mots et de nos mouvements venant différencier les espaces pour permettre de les
habiter. Répétition des soins de cet autre souvent maternel, renforçant le sentiment de continuité
d’existence et débouchant sur la construction d’un récit, d’une histoire, commune qui nous lie les
uns aux autres.
Pour les sujets souffrant de troubles psychiatriques, la rencontre avec l'Autre dans la rue,
peut avoir pour conséquence une déglaciation selon les termes de Salomon Resnik, une réanimation
psychique du sujet, où nous devons faire attention aux mouvements de retour de refoulés, à la
résurgence d'événements traumatiques, de mouvements d'agressivité, dans ces moments
particulièrement intenses. Entre défaut ou excès de circulation, telles deux faces d'une même pièce,
« l'asphaltisation » comme l’errance viennent anesthésier le sujet dans la rue, dire son impossible
inscription dans le monde et le « tenir » à distance. L'émergence d'un discours adressé à un Autre
pourrait entraîner une hémorragie psychique ou réactiver une fuite, face à l'incapacité d'inscription
en un lieu, en une temporalité fixe et faisant sens pour le sujet. Alors que d'autres patients peuvent
4
se mouvoir physiquement comme psychiquement entre différents lieux, dans une possibilité de
circulation entre les espaces externes et intimes, les plus fragiles dans la rue n’ont souvent pour seul
lieu de référence que l'asphalte même, où le bord du trottoir peut venir marquer un bord de
précipice psychique à la chute sans fond.
L’histoire de la mission est celle de ces moments heureux où les personnes avec lesquelles se
sont tissées des liens ont pu trouver un lieu où s’inscrire, vivre ; mais elle est aussi celle de moments
douloureux où la décompensation somatique ou psychique nous rappelle parfois dramatiquement
que ce qui nous paraît urgent ne l’est pas toujours, et que le temps de l’action doit respecter le temps
psychique du sujet. Nous pourrions ainsi vous raconter l’histoire de Jean Claude ou celle de
Georges qui sont décédés quelques mois suite à leur mise à l’abri.
Survivre est parfois plus facile que vivre.
L’équilibre est fragile, la continuité délicate à maintenir, mise à mal par le Réel. « L’absurde
naît de cette confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable du monde », nous dit
Albert Camus dans Le mythe de Sisyphe (1942). Cette clinique de l'extrême, de l’absurde nous
plonge inlassablement dans un non sens.
Travailler en équipe, marauder en binôme ainsi que penser et développer notre boîte à outils
deviennent alors sans cesse nécessaires : sans cela, comment penser cet absurde, comment faire face
à cette violence ? Sans réflexion, il y a ou trop ou pas assez de retour, de continuité, prenant le
risque de faire vaciller les fragiles constructions subjectives bâties sur les bords de l’errance ou de
l’asphaltisation.
La question du don revient massivement dans nos réflexions. Elle est omniprésente par la
misère qui s’offre à nos yeux ou par la demande plus ou moins explicite des personnes que nous
rencontrons.
Cette dernière nous ramène une nouvelle fois à l'absurde et à l’inconfort de notre démarche. Faut-il
ou non donner ? Si nous donnons un jour, que fera-t-on le jour suivant ? Si nous ne donnons pas, ne
faillons-nous pas à être cet être secourable ?
Nous en parlons sans cesse en réunion :
« Quand je rencontre quelqu'un qui a vraiment faim comme ce soir, je fais quoi : je parle ou je
lui donne un sandwich ? »
« Moi je les nourris d'abord pour qu'ils parlent la semaine d'après. »
J’ai rencontré Jean, je l’ai invité à venir à la Sardinade. Il m’a rétorqué « Tu vas pas m'acheter
avec des sardines. »
5
« On rencontre un slovaque qui nous demande sans arrêt des baskets du 47, mais c'est pas
évident de trouver des baskets du 47 ! On a fait tous les magasins de sport mais ils s'arrêtaient
au 45, on était désespéré. Finalement, le mec a disparu une fois qu'on les avait trouvés,
heureusement qu'on les a pas acheté ! »
Moi l’autre jour j’ai demandé « Qu'est ce qui pourrait vous faire plaisir ? »… et du coup il m’a
répondu : « Vous croyez qu'on a beaucoup de plaisir dans la rue ? »
« Moi j'avais à manger quand j’ai maraudé hier et donc je leur ai donné… On dira que c'est
parce que je suis nouvelle, que je savais pas qu’on ne donnait pas. »
Nous nous sommes réunis en séminaire l’année passée pour tenter cette question.
A cette occasion, sous avons redit le fondement de notre mission : s'intéresser avant tout à la
relation et ce, sans céder sur notre désir qui risquerait de nous plonger dans du pur humanitaire.
Pour cela, notre travail est d’accepter la frustration de ne pas aider matériellement, de se confronter
à la castration, de se dégager d'une position où nous voudrions faire pour l'autre, à sa place. Nous
sommes là sans rien, et dans ce « rien » se cristallise toute notre position soignante, car, ne venant
rien boucher de la relation avec un objet, nous laissons plutôt dérouler quelque chose du sujet et de
sa demande. Ce rien ouvre le don de confiance et la relation transférentielle. Ce que nous offrons,
c’est nous-même, notre personne propre comme lieu d'adresse Autre où nous accueillons une
singularité malmenée par les errements de l'exil ou de la fuite, les problématiques toxicomanes,
psychotiques ou encore les questions existentielles propres à chaque sujet.
Pour autant, nous ne pouvons laisser quelqu’un mourir de froid dans la rue, ou sans eau en
plein été. Et il n’y a pas à se questionner : ils ont froid, on donne le duvet, ils ont soif, on donne de
l’eau. Toute la difficulté est que cet objet vital ne devienne pas alors tout l’enjeu de la relation : il
est un à-côté sur lequel nous n'avons pas à nous arrêter. Ainsi, nous sommes partis contents de notre
séminaire avec un nouvel outil en poche « L’objet n’est pas un enjeu » !
Soit « l'objet n'est pas un enjeu », mais que devons-nous faire lorsqu'il semble le devenir ?
Nous rencontrons régulièrement un groupe d'hommes. Parmi eux, des personnes qui ont un abri la
nuit mais errent toute la journée durant, d’autres qui sont dans des squats ou à la rue. Plusieurs
d’entre eux ont des soucis de santé importants. Ils sont pour certains pris en charge par des équipes
partenaires sociales ou sanitaires. En lien avec eux, nous tentons de nous rendre présents à eux pour
accompagner à terme les plus fragiles vers les soins. Souvent, quand nous allons les voir, ils sont
alcoolisés et continuent à s'alcooliser devant nous tout en étant toujours accueillants.
Une fois, ils nous demandent à manger. Parce que nous sentons que certains d’entre eux sont en
grande difficulté et parce que « l’objet n’est pas un enjeu » et que, on leur achète de quoi se faire
6
des sandwichs. Une fois, deux fois, trois fois… Chaque fois qu'un binôme de maraudeurs passe les
voir, ils sont par un transfert massif et une demande matérielle qui prend de plus en plus de place.
Nous en parlons, y retournons, et cette fois, on les accompagne pour qu’ils achètent eux-mêmes.
Lors d'une maraude où ils ne sont que trois, ils disent avoir froid ; nous nous engageons à leur
ramener des duvets, tel jour vers telle heure. Au moment prévu, nous arrivons avec nos trois
duvets : ils sont cinq ! Embêtés, nous tentons de tenir quelque chose de notre parole ou de se
protéger derrière l'énonciation d'une règle : « Les duvets étaient pour telle et telle personne, si vous
en voulez on vous en ramène la prochaine fois ». L’agitation, le ton montent… Nous nous sentons
pris dans des enjeux groupaux qui nous échappent. Nous laissons les 3 duvets, très soucieux des
effets de ce « don insuffisant », un instant angoissés à l'idée qu'ils puissent se battre, tentant de se
rassurer l'instant d'après en se disant qu'ils en ont régulièrement et « de toute façon, ils les
revendent ». Nous nous défendons comme nous pouvons, face à nos fantasmes, et cette réalité en
étroite collusion avec un Réel inquiétant.
Quelques jours plus tard, une autre équipe, une autre maraude. Ils sont toujours en groupe.
Le dialogue s’engage mais nous sommes préoccupés par Rachid qui est très affaibli. Il ne veut pas
qu’on appelle les secours ni aller consulter. Il tremble. Très hésitants, nous finissons par prendre
congés d’eux. Puis nous revenons sur nos pas, inquiets, pour proposer un café ou un chocolat chaud.
Amine nous agresse : « Et vous croyez qu’on a besoin de vous pour cela ? »... et « D’ailleurs à quoi
vous servez ? ». D’autres membres du groupe viennent nous protéger « Tu sais bien qu’il n’apporte
pas à manger, MDM ! ». Rachid nous retient par le regard mais ne s’exprime pas. Amine se lève,
l’excitation croît. Les autres calment le jeu « Vous pouvez y aller, ne vous inquiétez pas ». Nous
repartons.
Dans la rencontre avec ce groupe, plusieurs phénomènes sont venus se télescoper : le
groupe, la présence parmi ses membres de Rachid, très affaibli, épileptique et grand alcoolique,
objet de notre souci, le froid,… Et l’effet de notre séminaire de réflexion venu nous mettre à l’abri
de notre inconfort par cette belle formule que « l’objet n’est pas l’enjeu ». Lors de nos reprises en
réunion hebdomadaire, dans un travail de constellation transférentielle, nous avons pu toucher du
doigt ce qui sans doute s’était joué à notre insu : nous avons découvert que dans ce groupe, Amine
avait une place de leader, de protecteur… En apportant ces duvets, en prenant soin de Rachid, nous
étions venus déstabiliser le fonctionnement du groupe et peut-être destitué Amine dans la place qu’il
prenait en son sein...
Nous sommes en permanence aux prises de ce conflit : d’un côté agir face à la maladie et à
la misère et d’un autre désirer respecter le temps psychique du sujet.
Si l’objet n’est pas en enjeu, la place de l’objet dans les relations que nous tissons avec les
personnes de la rue ne serait-elle pas tout l’enjeu de notre propre travail psychique ? Ne serait-ce
7
pas dans l’analyse « psychopathologique de nos dons » que les soignants désorientés que nous
sommes pourraient trouver leur boussole ?
Nous rencontrons un couple, Anne et Vincent. Anne est enceinte de sept mois. Cette situation
est pour nous tout de suite une urgence, il faut que nous puissions être là si besoin est au moment
de l’accouchement. Trois maraudeurs vont à leur rencontre plus régulièrement et leur donnent
un numéro de téléphone. Vincent, toxicomane, n’est pas suivi ; Anne dit être « clean », elle est suivie
par un CSAPA. A chacune de nos rencontres, ils nous rassurent tout en nous demandant implicitement
quelque chose, jamais directement. De l’argent surtout, pour manger, pour une nuit d’hôtel,
pour préparer la venue du bébé… On hésite à donner, puis on donne, on se réunit, on en parle, puis
on hésite…
- Pourquoi de l’argent ? Est-ce pour acheter de la drogue ?
- Ils ne peuvent pas rester à la rue, cet enfant ne peut pas naître dans le caniveau, nous devons
leur payer l’hôtel jusqu’à l’accouchement…
Tout nous fige. Cet enfant qui peut naître sur le trottoir c’est l’image de cette détresse primordiale
qui vient nous cueillir. Nous sommes comme fascinés, pris par cet hilflos mortifère, par
cette jouissance inconsciente face au spectacle voyeuriste d'une réalité de la misère confinant au
Réel. Nous ajoutons des réunions "exceptionnelles" au mois d'août, on essaie d'élaborer autour de
cette demande toujours implicite mais omniprésente. Nous relevons toutes les incohérences de leur
discours, nous tentons de comprendre leur demande. Nous les connaissons peu finalement, nous
n’avons que très peu d'éléments de leur histoire. Nos fantasmes viennent recouvrir la réalité… On
imagine, se répète, se questionne, puis... On redescend sur terre... Et de nouveau on imagine, se répète,
se questionne. Bref, nous tournons en rond avec l'envie et le besoin pour eux comme pour
nous de se décaler de ce temps chronologique mais dans une impossibilité. Ce bébé va arriver, elle
va accoucher et le risque qu'elle accouche dans la rue est grand. C'est une urgence mais le temps logique
de l'inconscient ne prend, lui, pas en compte cette urgence.
Le temps passe... Elle accouche, tout se passe bien même si c’est moins une. Les analyses
révèlent de nombreux toxiques dans le sang de la mère. S’ensuit le sevrage du bébé. Le père arrive à
s'engager dans une prise en charge. Ils sont suivis par la maternité puis par trois associations différentes
au moins. Nous travaillons avec les autres acteurs ; ils tentent de répondre à leur demande,
cèdent puis lâchent : la maternité les fait sortir, une association leur donne une somme d’argent pour
une mise à l’abri temporaire avec l’enfant puis disparaît... Semble ainsi se répéter un mouvement où
l’objet n’arrive jamais à satisfaire la demande mais où il vient rompre les liens. Pendant ce temps là,
nous tentons de maintenir un lien. Ils ne nous appellent que pour demander. Nous avions donné un
peu d’argent pour quelques nuits d’hôtel avant l’accouchement… Cet argent n’a sans doute pas ser-
8
vi à cela… Nous cédons à nouveau sur les couches et sur la poussette, « parce que c’est le soin du
bébé et que cela fait partie de la mission de MDM »… en fait la PMI fournit déjà tout cela… Nous
voilà nous aussi pris dans leur propre répétition… Mais nous le lâchons pas, nous tentons de rester
là pour eux, au-delà des demandes… Nous les écoutons, nous parlons de leur demande, nous ne disons
non, nous tentons de les accompagner vers des acteurs qui pourraient les aider… Et ce faisant,
ils continuent à nous rappeler, un lien semble s’être créé. Et demain ? Nous n’en savons rien, nous
tentons de rester connecté sans imposer notre présence.
De quel objet parlons-nous ?
Il y a l’objet qui répond aux besoins de première nécessité sans lequel il n’y a pas de vie. La
mère nourrit l’enfant de lait et de mots. Dans le dénuement extrême, et c’est le cas pour tous ces
corps échoués sur l’asphalte, rigidifiés par le froid, l’ivresse ou la chaleur, il ne peut y avoir d'autre
maternel sans ses soins de première nécessité.
Il y a l’objet qui est le support à la découverte de l’environnement, l’objet sur lequel vient
s’étayer la relation, l’objet qui permet de parler. Pendant plusieurs années, un membre de la mission
a apporté à un monsieur psychotique qui vivait dans la rue chaque semaine, une canette de coca et
une orange. De canette en orange s’est tissé un lien qui a permis après plusieurs années de mettre à
l’abri ce monsieur. Et aujourd’hui encore, on lui apporte cette canette et cette orange hebdomadaire.
Ces objets ont ouvert la possibilité d’un autre. Le don invite au contre-don, selon Marcel Mauss, il
est au fondement de l’échange et de l’organisation sociale.
Et puis il y a l’objet qui vient boucher la demande, parce qu’il la précède, la camoufle. Cet
objet qui nous rend sourd en nous enfermant dans notre satisfaction narcissique.
Citons une personne anciennement SDF « Donner, je trouve que ça instaure une hiérarchie. On
n’est pas sur un pied d’égalité, cela nous met en dette. J’ai beaucoup de reconnaissance vis-à-vis
de ce que l’on m’a donné quand j’étais SDF, mais revenir à la vraie vie, ce n’est pas être redevable
tout le temps. Quand on reprend sa place d’humain, on doit pouvoir refuser cette dette ».
La place de l’objet est chaque fois à repenser selon les situations, avant et sur le moment mais
surtout dans l’après-coup car ce qui compte, ce n’est pas tant ce que nous faisons ou donnons dans
la rue (faire et donner c’est aussi prendre le risque de la vie), ce qui importe c’est la pensée qui suit
nos actes. Car c’est dans l’après-coup qu’un acte peut devenir passage à l’acte.
9
En conclusion : une clinique de l’humanité
« Tous les jours, pendant six mois, un ouvrier civil italien [Lorenzo] m'apporta un morceau de pain
et le fond de sa gamelle de soupe ; il me donna un de ses chandails rapiécés et écrivit pour moi une
carte postale qu'il envoya en Italie et dont il me fit parvenir la réponse. Il ne demanda rien et
n'accepta rien en échange, parce qu'il était bon et simple, et ne pensait pas que faire le bien dût
rapporter quelque chose. […] Je crois que c'est justement à Lorenzo que je dois d'être encore vivant
aujourd'hui, non pas tant pour son aide matérielle que pour m'avoir constamment rappelé, par sa
présence, par sa façon si simple et facile d'être bon, qu'il existait encore, en dehors du nôtre, un
monde juste, des choses et des êtres encore purs et intègres que ni la corruption ni la barbarie
n'avaient contaminés, qui étaient demeurés étrangers à la haine et à la peur ; quelque chose
d'indéfinissable, comme une lointaine possibilité de bonté, pour laquelle il valait la peine de se
conserver vivant. [...] C'est à Lorenzo que je dois de n'avoir pas oublié que moi aussi j'étais un
homme. » Primo Levi, Si c'est un homme, (1947), p.186-190.
A l'heure d'un lien social tarifé, marchandisé, contre-sens anthropologique, selon le mot de
l'économiste Frédéric Lordon, notre mission de rue vient s'inscrire dans les rides d'un travail
abandonné par le politique, se reposant sur le secteur associatif et militant. Nous nous situons ainsi
aux confluences étymologiques du creux, ruga, la rue, la ride, d'un visage courroucé et sévère, le
creux marquant aussi l'espace entre deux bords. Ici s'établit une première tache sur laquelle nous
nous portons : du bordage, de l'étayage, auprès d'une population délaissée et fragilisée, sur les dérives
de nos artères urbaines, quand celle-ci ose encore s'afficher honteusement, dont les sujets sont
en proie à la violence, autant sociale que singulière, psychique, pulsionnelle, inconsciente. De
déliaisons psychiques en déliaisons sociales, de l'exclusion à l'auto-exclusion et l'asphaltisation du
corps dans le béton, notre clinique a pour principal objet d'ouvrir un lieu d'adresse à un Autre
permettant un amarrage du Sujet dans un discours et une relation, un espace de parole qui pourra
permettre de surcroît de déplier une histoire, un vécu traumatique et des événements de vie ayant
abouti à des processus mortifères. Comme l'explique Michèle Benhaïm dans son dernier livre Les
passions vides : « Notre travail clinique n'est pas mesurable, car combien coûte un sourire ? Ce
travail est une nécessité, une obligation, une exigence, car le vide est contagieux. Faisons le pari
qu'il existe des processus de création au sein même de l'effondrement subjectif, que ces mouvements
seront propices à lier les égarements, et que des forces d'ancrage ouvriront un horizon là où il nous
apparaît, pour l'instant, comme obstrué. ». Cela résume ce qui de façon continue nous porte, où
nous misons que dans cette errance physique et psychique rencontrée dans la rue, un amarrage est
possible, une inscription dans un champ social et discursif. Ces hommes et ces femmes qui se vivent
10
comme n'ayant pas de place dans le monde en sont exclus, ils sont ceux qu'on aimerait ne pas voir,
ne pas entendre, et qui pourtant, par leur présence, viennent nous rappeler les effets de destruction
et de rupture de liens de notre société. Notre tâche vise à restaurer ces liens rompus par la misère et
la violence. Notre clinique est alors de permettre que ces sujets s'autorisent à retrouver ou parfois
même trouver une place dans le monde, dans une idéologie de plaidoyer pour l’hétérogène et une
anti-conformité au modèle social pour ceux ayant fait le choix de la marginalité.
C'est en voyant dans le petit autre l'humanité que l'on peut redécouvrir la sienne propre, dans une
fraternité autour de la souffrance humaine selon le mot de Pierre Delion, et sa potentialité
d'inscription dans le champ social.
Dans cette clinique que nous appellerons la clinique de l’humanité, notre posture est donc
d'accepter l'inconfort et l'intranquillité, que l’on peut voir comme la résultante des projections des
personnes sans abri, des motions qu’elles nous renvoient et prennent dès lors une grande place dans
notre imaginaire, dans nos fantasmes, souvent morbides et angoissants, qui peut tendre à nous
aliéner dans la relation établie.
L'inconfort et l’intranquillité aussi d’une position de maraudeur qui peine à se définir. Face à
une réalité qui confine au réel, notre travail est d’éviter les refuges de nos positions défensives de
« psy » qui refuserait toute incursion dans la réalité et ne voudrait rien voir des besoins d’étayage
sur l’objet, de celles de travailleurs sociaux qui tendraient à boucher le trou d'une demande que nous
ne pourrions plus entendre au-delà de sa matérialité, de celles de médecins qui ne verraient plus le
sujet mais le seul corps échoué et souffrant.
Notre inconfort et notre intranquillité, c’est donc aussi notre renoncement.
Renoncement à être des sauveurs, à venir soulager la souffrance immédiate ou satisfaire la demande
apparente, à donner à la personne ce dont elle manquerait et dont l’absence l’éloignerait de notre
monde.
Renoncement à être des « psy » (ce que nous ne sommes jamais pour eux car ne nous présentant pas
ainsi), à travailler avec eux sur leur transfert. C’est plutôt sur notre transfert qu’il nous faut travailler
et pour que peut-être, dans un effet collatéral, puisse émerger un discours du sujet dans la régularité
des rencontres.
Renoncement donc à notre position de toute-puissance.
Alors, « Qu’est-ce qu’on fout là ? » comme le dit Oury… C’est cette question que nous
remettons finalement inlassablement sur le métier pour tenter de tisser ces liens, qui ne cesse de
nous travailler en chaque instant de la rencontre.
Nous devons alors, entre maraudeurs, nous porter mutuellement, afin de ne pas tomber dans
ce qu'il en serait d'une fascination, d'une jouissance inconsciente. Nous devons dans cette rencontre
11
faire montre d'un étayage respectif entre nous, afin de permettre un décalage de possibles postures
défensives face à ces situations de misère, miseria, malheur, détresse, qui inspire la pitié, en-deçà de
la pauvreté, pauper, produire peu, mais qui peut encore laisser des espaces de création possible.
Dans ce portage mutuel, chaque membre prend alors une fonction thérapeutique spécifique pour les
autres bénévoles, et les sujets de la rue, dans une constellation transférentielle étayante, plurielle,
diffractée. Nous pouvons ainsi faire collectivement face aux effets de violence qui nous sont
renvoyés, dans une posture d'accueil et de maintien d'une dignité humaine. Quand la mort peut
rôder au coin de l'hypothermie hivernale, de la déshydratation estivale, de la violence physique, ou
de l'abandon de soi, hors de la communauté des hommes, l'homme ne serait plus qu'un coquillage
vide, un musel man.
La mission sans abri existe de puis 13 ans. Au départ, elle offrait des consultations aux
personnes sans abri ; aujourd’hui elle propose ce travail d’aller vers et de création de liens. Cette
mission prend tout son sens dans les articulations qu’elle propose avec les partenaires du réseau.
Nous sommes des passeurs, ces liens que nous construisons avec les personnes, nous tentons de les
reproduire avec les acteurs qui interviennent en amont ou en aval de notre action dans les prises en
charge sanitaires et sociales. Ainsi, nous tentons de déployer un maillage solidaire, rigoureux et
attentif autour de la personne sans abri.
Face à une population sans abri de plus en plus nombreuse, protéiforme, confrontée à des
difficultés de plus en plus grande devant la raréfaction des réponses institutionnelles ou associatives
faute de financement, face aux phénomènes migratoires qui ne font que commencer, nous vivons la
maraude comme un acte politique. C’est pour nous un engagement citoyen et concret, fait au
quotidien d’interrogations, de curiosité, de passion plus que de compassion. La frontière entre le
SDF et soi-même est étroite : qui va soigner qui en vérité ? » « Qui sauve un homme, sauve
l'humanité » dit le Talmud.
Cet acte politique doit s’ouvrir. S’ouvrir aux autres citoyens, s’ouvrir aux réseaux de
proximité. C’est dans ce sens que nous souhaitons dans les années à venir faire évoluer notre
action : associer de plus en plus largement les citoyens, les partenaires, et les acteurs locaux du
territoire, en essayant de transmettre quelque chose de la complexité de cette clinique de l’humanité.
BAIDI Christophe – DIMECH Amélie – DOUENEL Corinne – NEGREL Raymond
12
07-08 DECEMBRE 2019 DANIELLE ROULOT ET MICHEL LECARPENTIER
|
|
Cliquer ici pour modifier.
|
LES FORMATEURS |
L'équipe de Formation est composée telle une palette de couleurs où chaque intervenant vient partager son expérience et interroger sa pratique et le quotidien avec chacun des stagiaires pour accompagner chacun des stagiaires dans sa singularité art thérapeutique. CO PRÉSIDENTS MICHEL BALAT ET FLORENCE FABRE DIRECTRICE COORDINATRICE DE L'ORGANISME DE FORMATION FLORENCE FABRE COMITÉ SCIENTIFIQUE MICHEL BALAT, PIERRE JOHAN LAFFITTE ET FLORENCE FABRE |
|
|
PARCOURS FONDAMENTAL EN ART-THÉRAPIE
INTERVENANTES RÉFÉRENTES FLORENCE FABRE Art thérapeute, formatrice et fondatrice du lieu Médiations plastiques et corporelles LINA AYOUBI VARLET, Théâtre thérapie, poésie LES INTERVANTS PONCTUELS TOLTEN THOMAS SCHIRA Psychologue croqueur sonore et musico thérapeute partagera son expérience professionnelle et ses ateliers d'écriture. Tolten est un rimailleur invétéré. Dyslexique depuis sa plus tendre enfance c'est tout naturellement qu'il s'est tourné vers la poésie. Il anime régulièrement des ateliers d'écriture et de slam dans différentes institutions (IME, hôpitaux psychiatriques, prisons, milieu scolaire). De plus, il interviens assidûment dans divers lieux de formation (université, CEMEA, etc.) ou auprès d'équipes (CMP, hôpital de jour, etc.) pour parler de cette pratique singulière qu'est l'écriture. Il a publié "L'Etre Ange Monde" aux éditions Champ Social ainsi que plusieurs poèmes ou textes sur le langage dans des revues pour travailleurs sociaux. Il travaille en tant que psychologue dans un IME. LAURA GRIGNOLI ET BARBARA CIPOLLA Ecole ARTELIEU à Pescara Italie Dans le cadre de modules entre les écoles (ELNE-PESCARA) MARIE SCHMITT Marionnettiste et théâtre de l'objet |
PARCOURS THÉORIQUE
INTERVENANTS RÉFÉRENTS MICHEL BALAT nous initiera à la Sémiotique et la Psychanalyse Professeur és lettres Maître de conférence sémiotique et psychologie Master psycho DEA Mathématique pure Maître de conférence en sémiotique et psychologie à l’université de perpignan www.michel-balat.fr PIERRE JOHAN LAFFITTE, Pierre Johan Laffitte est rédacteur en chef de son site www.sensetpraxis.fr.. Sémiologue, il enseigne les sciences du langage à l’Espe de Picardie, et les rapports entre sémiotique et clinique institutionnelle des psychoses et de l’autisme dans le cadre de DU de Paris V et de Paris VII. Ses travaux se situent à la croisée de la sémiotique peircienne et de la psychothérapie institutionnelle. Il est également engagé dans le champ pédagogique, ou les mêmes problématiques, sémiotiques et cliniques, se rencontrent dans le champ des pédagogies coopératives, pédagogie institutionnelle et pédagogie Freinet. LES INVITÉS MARIE FRANCE ET RAYMOND NEGREL 03/2019 MARC LEDOUX 05/2019 DANIELLE ROULOT, Medecin Psychiatre à la clinique de la Borde 12/2019 MICHEL LECARPENTIER , Medecin psychiatre à la clinique de la borde 12/2019 PIERRE DELION, 03/2020 reporté FRANCESCA CARUANA, Artiste et Sémioticienne de l'Art ELIE POUILLAUDE Docteur en Psychologie, Psychologue clinicien et directeur d'un centre de consultation chargé d'enseignement à paris 13 ... |
PARCOURS ARTISTIQUE
INTERVENANT RÉFÉRENT MOHAMAD OMRAN Artiste Sculpteur et plasticien Doctorant sur le corps dans l'Art partagera des ateliers de modelage. Né en 1979 à Damas, Syrie, Mohamad Omran est diplômé de la faculté des Beaux-Arts de l'université de Damas en 2000. Il obtient un Master d'Histoire de l'art contemporain à l'université Lyon 2 en 2009. Il intervient, entre 2011 et 2013, à l’atelier ART-Motion à Elne ou il a suit une formation d’art thérapie. Récompensé à plusieurs reprises, il reçoit en 2003 le Grand Prix de la Biennale d'Almahabba à Lattaquié en Syrie. Depuis, ses œuvres sont présentées dans de nombreux pays comme la Jordanie, le Liban, le Danemark, la Belgique, l’Alemagne et la France. Il réside actuelement à Paris. SITE INTERNET : www.mohamadomran.com LES INVITÉS RICHARD MEIER Artiste et Editeur d'Art Edition Voix Meier www.voixeditions.com FRANCESCA CARUANA, Artiste et Sémioticienne de l'Art CLAUDE BILLÉS, artiste sérigrapheur ... |
LES ENTOURS
|
MICHEL BALAT
C’est la vie… …officiellement depuis le 22 septembre 1944 (1er Vendémiaire an 152), dans une clinique de Perpinyà où, dans une chambre voisine, Aristide Maillol se mourait des suites d’un accident de voiture sur la route de Banyuls sur mer (Banyuls de la marenda par ici). Est-on assez attentif au fait que l’on nait toujours entre deux morts ? Ça balise ! L’autre, celle d’avant, avait été décisive côté bios. Après d’exaspérantes, pénibles et ternes études au Lycée Arago (du CP à la terminale), un transport passionné, comme on disait au Grand Siècle, pour mathématiques et astronomie, un transfert bienvenu sur Vincent Mazeran, par la grâce d’une longue analyse d’au moins 18 ans et une transmutation gaullo-"gauchiste" menant à une active vie politique. Mathématiques, politique et psychanalyse ont tressé, dès la fin des années 60, mon appareil à penser les pensées, côté Bion. C’est la sémiotique de Peirce, dans la rencontre avec Gérard Deledalle en 1980, puis l’analyse institutionnelle, dans celle avec Jean Oury en 1986, qui ont décidé de la suite. Des Systèmes triples de Lie à torsion, mon premier — et seul — travail mathématique, à La triade en psychanalyse qui inaugurait cette suite, un long travail invisible. En ce qui concerne le visible, un stage déterminant à l’Observatoire du mont St Michel, où j’ai eu la chance de travailler sur le grand télescope, un autre, qui allait l’être, comme vacataire au service de math de l’université de Perpignan. Puis assistant de math dans ce lieu-même, un bref séjour de 2 ans à Casablanca et à Fès, des études de psycho où se sont scellées des amitiés toujours actuelles, une thèse "ès-Lettres" sur la fameuse triade, et l’enseignement de sémiotique qui s’en est suivi. Enfin, sonnant comme un mot d’ordre de mes années militantes, la retraite à 60 ans. Pour le privé, on verra plus tard. COÉLABORATION "BALAT - ART MOTION - TUCHÊ - ACCUEILLETTE" Michel Balat coélabore avec Art&motion depuis sa création en 2008. Il est un des co fondateurs de l'association l'ACCUEILLETTE crée en 2016 et Co président et co fondateur de l'organisme de formation LA TUCHÊ en 2016. Coélaborateur au sens de la recherche et de la praxis, il accompagne les étudiants dans leur processus art thérapisant et accompagne les équipes dans un accompagnement d'analyse pratique et institutionelle pour ne pas dire psychothérapie Institutionelle. |
SITE DE PIERRE JOHAN LAFFITTE Vous trouverez donc en ce site une cartographie des différentes aires dans lesquelles j’essaie, au sens strict, ce qui ne se veut qu’un cheminement intellectuel et humain fidèle à l’inscription qui inspira Machado : Camino no hay, hay que caminar. Ce chantier se mène aussi dans le compagnonnage de praticiennes et praticiens, de connivence et de rencontre. Pour inscrire cet incalculable bonheur de la rencontre, je peux l’écrire ou le dire, mais il s’est avéré tout aussi possible et urgent de le recueillir. Peu à peu, et forcé par la période, ce site se fait moulin où accueillir certaines de ces rencontres, certains de ces travaux en cours. Il est donc normal que ce lieu de lieux soit, lui aussi, en voie de devenir un chantier permanent, coopératif, dans lequel d’autres que moi peuvent venir travailler. Ainsi, chaque partie se déploiera progressivement en trois types de pages, consacrées à un travail collectif, à des invites pour des paroles autres et amies, et à des propositions n'engageant que l’auteur de ces lignes. COÉLABORATION "PIERRE JOHAN LAFFITTE ART&MOTION TUCHÊ ACCUEILLETTE" |
ARTELIEU est une association scientifique culturelle à but non lucratif dont l’objectif principal est porté sur l'étude, la recherche, la diffusion des arts thérapies. Artelieu entend cueillir les rapports entre la psychopathologie et la créativité et développer ainsi une méthodologie pour l'approche thérapeutique à travers l'art. ARTELIEU a été fondé en 2003 par une équipe de psychologues, psychothérapeutes, sociologues, artistes et amateurs de l'art et il s'adresse à un public global, de l'enfant à l'adulte, y compris les personnes âgées et les porteurs de handicap, en différenciant les interventions et en créant des conditions favorables à chacun. Artelieu est avant tout un pôle de recherche, nous nous sommes donc engagés dans l’élaboration d’une bibliothèque et d'une vidéothèque sur tout ce qu'il concerne l'art-thérapie au niveau international. Nous proposons des formation, des débats, des stages, des projections sur les thématiques inhérentes à l'art et à la psychologie; Nous offrons par ailleurs un service de consultation en outre pour tous ceux qui entendent commencer une activité dans le domaine de l'art-thérapie. L'association se propose de sensibiliser et de donner des renseignements concernant toutes les formes d'art, avec un soin particulier pour les arts visuels, dans l’intention de créer une culture consciente ; elle est ouverte à la comparaison et à la collaboration avec d'autres organismes ou associations qui poursuivent des buts analogues. C'est la raison pour laquelle l'Artelieu a constitué avec Profac la Fédération Multiculturelle d'Art-Thérapie. À la vie de l'association toutes les catégories d'associés participent, dans le but de développer des activités spécifiques d'étude et de recherche sur la théorie et la pratique de l'art thérapie. Le patrimoine de l'Artelieu est constitué par le matériel produit par les associés, soit en domaine clinique que théorique, documenté par des articles et des publications. Activité de l'Artelieu étudies sur le dessin enfantin et de l'adolescence Parcours de formation en art-thérapie plastique picturale (LINK) Laboratoires expressifs (LINK) pour enfants et adultes Collaboration avec les écoles pour la gestion de Laboratoires d'art-thérapie avec du but préventif Organisation d'événements culturels, séminaires, expositions et colloques pour la diffusion de l'art-thérapie Échanges culturels (LINK) avec des associations et organisations nationales et internationales qui s'occupent d'art-thérapie Supervision sur des cas cliniques avec la méthodologie de l'art-thérapie avec les arts visuels Semaine de l'art: convergence de plus événements artistiques dans une semaine tous les années pour socialiser les initiatives réalisées COÉLABORATION ARTELIEU / ART & MOTION / TUCHÊ Art &motion et Artelieu Coélaborent depuis 2008. Laura Grignoli intervient depuis 2008 sur la formation Art&motion et actuellement sur la Tuchê. Elle y anime des Ateliers et intervient lors de Colloques et de séminaires. Et Florence Fabre intervient sur Artelieu en tant que Formatrice au près de Barbara Cipolla et Laura Grignoli. En 2019 Barbara, Laura et Florence organisent conjointement 2 évènements en France et en Italie: Avril 2019 Florence Fabre représente l'ensemble de l'Atelier Art & motion à Pescara lors d'un Colloque et en Mai 2019 Laura Grignoli intervient sur les 1eres portes ouvertes de l'atelier. L'amitié qui lie Barbara, Laura et Florence les poussent à créer des passages pour les étudiants des deux pays. Ce projet momentanément interrompu reste dans la construction actuelle des projets de la tuchê avec Michel Balat et Pierre Johan Laffitte. |
EXPERICE est le Centre de Recherche Interuniversitaire Expérience Ressources Culturelles Éducation. Issu du rapprochement de deux équipes, l’une de Sorbonne Paris Nord Nord et l’autre de Paris 8, EXPERICE (EA 3971) se veut un centre de recherches fortement organisé autour d’une thématique originale au sein des sciences de l’éducation. Il s’agit en effet de s’intéresser aux apprentissages et à l’éducation hors de l’école en mettant l’accent sur les situations les moins formelles, qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes. Il y a donc focalisation sur ce qui ne prend pas la forme scolaire, y compris les apprentissages informels au sein de l’école, avec le projet scientifique de se centrer sur le non-scolaire et de le penser dans sa cohérence globale et dans la diversité de ses aspects, avant, à côté, en marge, au-delà de la forme scolaire. EXPERICE a vocation à explorer la diversité des espaces d’apprentissage en dehors de ceux qui ont été explicitement et exclusivement conçus pour cela, qu’il s’agisse ou non d’institutions, qu’il y ait ou non intentionnalité voir conscience d’apprendre. Il se situe délibérément dans les courants internationaux encore peu présents en France qui sous différents vocables mettent en œuvre une approche de l’apprentissage (learning) à côté de l’école. D’où l’intérêt porté à l’éducation tout au long de la vie, inscrivant la formation des adultes dans un processus qui commence dès la naissance, traversant différentes situations et institutions, en mettant l’accent sur l’auto-apprentissage et en s’intéressant aux processus de construction du sujet au sein de l’espace social, à la petite enfance, mais aussi aux moments de loisir, aux jeux, aux jouets, au multimédia, à l’ensemble des ressources culturelles porteuses d’apprentissages que l’on en ait ou non conscience. EXPERICE construit son objet collectif de recherche autour de la notion d’expérience comme lieu d’apprentissage, sur l’idée d’un apprentissage qui accompagne différentes pratiques sociales, y compris celles qui ne sont pas conçues comme telles. Cela renvoie tout particulièrement à la réflexion sur ce qu’il est convenu d’appeler éducation informelle et/ou non formelle, même si les travaux peuvent conduire à prendre des distances avec ces catégories. L’intérêt porté aux adultes se fait dans la continuité avec les apprentissages des enfants, en refusant les constructions qui conduisent à isoler socialement et théoriquement les enfants pour les penser comme radicalement différents des adultes. La formation des adultes est pensée dans la continuité d’une éducation tout au long de la vie et réciproquement le jeu et le loisir de l’enfant en tant que porteurs d’apprentissage sont pensés dans la continuité avec ceux de l’adulte. Cette façon d’envisager l’apprentissage, enraciné dans diverses pratiques sociales, présent tout au long de la vie, conduit à porter un intérêt particulier à la biographie aussi bien comme méthode de recueil des données que comme processus de construction de soi à travers des apprentissages. Sans être exclusive la prise en compte des dimensions sociales est importante dans les approches développées par EXPERICE, qui se reconnaît cependant pleinement dans une vision des sciences de l’éducation comme lieu de croisement disciplinaire, dans un ancrage multiréférentiel. La mise en perspective d’approches psychologiques et sociologiques, anthropologiques et historiques, mais aussi philosophiques constitue un élément essentiel de la construction de la recherche au sein du laboratoire. Sans exclusive, on y privilégie des approches qualitatives, une prise en compte des significations produites par les acteurs, un intérêt pour la compréhension des phénomènes, une orientation forte, chez certains chercheurs, pour une démarche herméneutique. On peut souligner également un intérêt pour les courants critiques qui bousculent les allants de soi, supposent un travail de déconstruction qu’il s’agisse de traditions philosophiques européennes ou du mouvement post-structural contemporain, né en France mais largement développé aux Etats-Unis et dans de nombreux pays. Il faut mettre cela en relation avec la forte importance donnée à la dimension interculturelle dans les recherches, qu’il s’agisse de recherches proprement interculturelles ou de l’importance accordée à la comparaison internationale et interculturelle. COÉLABORATION EN COURS |
LA FIAC
La Fédération inter-associations culturelles (FIAC) a pour but de créer des ponts entre les professionnels, qu'ils travaillent en établissements psychiatriques ou dans le médico-social, le social ou l'éducation afin de remédier à l'isolement et de témoigner des pratiques de ces derniers.
Elle édite la revue Institutions, revue indépendante qui ne vit que par ses abonnements, et est à l'initiative de "La Boîte à outils", d'abord sous forme de hors-séries, puis, à partir de 2015, collection à part entière aux "éditions d'une". La revue accueille des témoignages et des analyses de personnes engagées dans la psychothérapie institutionnelle.
La FIAC est composée d'une quarantaine d'associations membres (voir la liste ci-dessous), et organise en partenariat avec une association différente chaque année une Journée nationale de psychothérapie institutionnelle, afin de favoriser les échanges et les avancées sur le plan collectif et local.
Elle édite la revue Institutions, revue indépendante qui ne vit que par ses abonnements, et est à l'initiative de "La Boîte à outils", d'abord sous forme de hors-séries, puis, à partir de 2015, collection à part entière aux "éditions d'une". La revue accueille des témoignages et des analyses de personnes engagées dans la psychothérapie institutionnelle.
La FIAC est composée d'une quarantaine d'associations membres (voir la liste ci-dessous), et organise en partenariat avec une association différente chaque année une Journée nationale de psychothérapie institutionnelle, afin de favoriser les échanges et les avancées sur le plan collectif et local.
TEXTES
Le club thérapeutique extrait texte pierre DeLION
Texte de Pierre Delion
http://ancien.serpsy.org/psy_levons_voile/psychotherapie/club.html
Dans son texte écrit en 1959 pour le rapport introductif aux journées annuelles de la Fédération Nationale des Sociétés Croix-Marine à Paris, Oury reprend très en détail l’histoire et la conceptualisation des clubs thérapeutiques et je ne peux qu’y renvoyer le lecteur. Pour lui, « le développement des véritables clubs est relativement récent et semble résulter de la convergence de plusieurs courants : remise en question des fondements de la psychopathologie par l’avènement du freudisme ; doctrine de la thérapeutique active d’Hermann Simon à Gütersloh après la première guerre mondiale ; développement des psychothérapies de groupe aux Etats-Unis à partir de 1930 ; les activités extra-hospitalières s’inspirant de K. Lewin à la Tavistock Clinic en Angleterre et aboutissant pendant la deuxième guerre mondiale à des applications à la thérapeutique hospitalière ; l’impulsion donnée par Bierer à la constitution de clubs socio-thérapeutiques ; l’occupationnal therapy ; le développement des méthodes actives dans le domaine de la pédagogie proposé par Makarenko, Montessori, l’école de Hambourg, le mouvement Freinet, etc ; les mouvements de jeunesse tels que le Scoutisme, les Auberges de jeunesse...(...) Nous voudrions souligner cette brusque éclosion de conceptions analogues dans divers domaines : psychiatrie, pédagogie, protection de la jeunesse,...Résultant de manifestations du profond remaniement historique et de remise en cause de la plupart de nos principes par éclatement des cadres culturels, les clubs thérapeutiques apparaissent dans cette perspective comme une étape d’une remaniement structural de la société globale. Par la remise en question du style de la vie intérieure des hôpitaux, ils ouvrent ceux-ci au monde environnant. Paradoxalement, ils deviennent des foyers de culture, refondant la vie collective sur une tradition authentique ; le phénomène de la folie retrouvant sa dignité par sa fonction de remise en question permanente de nos règles de vie »
De nombreux clubs thérapeutiques, ou des structures approchantes, ont alors été réalisés : Daumézon à Fleury lès Aubrais, Sivadon et Follin à Ville Evrard, Le Guillant à Villejuif, Ey à Bonneval, Balvet et Requet à Lyon, Ueberschlag à Lannemezan, Fanon à Blida et surtout Tosquelles à Saint-Alban et Oury à la Borde. Le club thérapeutique est une structure associative rendue possible par la circulaire du 4 Février 1958. Elle s’appuie sur l’intérêt de l’intervention d’une association dans l’organisation du travail thérapeutique, évitant que l’argent gagné dans les ateliers thérapeutiques soit la propriété de l’hôpital et non de ceux qui ont travaillé. Une telle association loi 1901 est en général composée de soignants, et, si possible, de personnalités extérieures au soin, et porte le nom de comité hospitalier.
Ce comité passe convention avec l’établissement de référence et créé en son sein, un club thérapeutique composé suivant les cas et les expériences de chaque service, de soignants et de patients, voire de patients seuls. Les objectifs immédiats de ces clubs thérapeutiques sont de pouvoir organiser la vie quotidienne du service en assumant la responsabilité des achats et des dépenses de chaque atelier : la cafétéria, les ateliers créatifs et/ou de production...Mais les objectifs sous-jacents sont de disposer d’unetablature institutionnelle d’espaces et de temps diversifiés possiblement utilisables par le patient, même à son insu, comme les touches d’un clavier, ou mieux, comme les éléments d’un langage. Ces lieux dans lesquels de l’argent est « gagné » viennent autoriser des activités qui en « dépensent » tels les voyages, les sorties et activités culturelles, un journal, ou un fonds de solidarité. Une assemblée générale de tous les membres du collectif a lieu chaque semaine, un bureau est élu parmi les patients ; puis ce bureau élit son président, son secrétaire et son trésorier(il arrive que le trésorier élu par ses pairs du bureau pour gérer les comptes du club thérapeutique, soit lui-même sous curatelle aux termes de la loi du 3 Janvier 1968). Des réunions ont lieu pour poser les problèmes à débattre, prendre les décisions ; des votes sont organisés pour les décisions concernant le budget du club et les orientations ; une réunion régulière a lieu pour les malades « entrants », éventuellement suivie d’un repas, pour les accueillir et leur expliquer le fonctionnement du club thérapeutique et du service, leur présenter les différentes personnes qui y occupent une fonction ; les soignants sont là comme « conseillers techniques ». Depuis la mise en place de la politique de secteur, ce dispositif a été « extrapolé » et des innovations ont eu lieu, telles que la création de « clubs de secteurs »(Denis, Le Roux, ou des « clubs extra-hospitaliers » Colmin, Buzaré, avec tout un travail très intéressant de soutènement du traitement des patients par ces activités de groupes, et des liens avec les autres associations de quartier ou de village. D’autres encore ont utilisé la « fonction club »(Oury), c’est-à-dire un opérateur qui n’a pas forcément la présentation d’un club thérapeutique mais qui peut en avoir la fonction, par exemple une classe coopérative(Laffite ), une association culturelle(Chemla ) ou un journal. On retrouve ces expériences dans différents types d’établissements comme les classes plus ou moins spécialisées(Fernand Oury, Catherine Pochet ), les Instituts Médico-Educatifs(Claude Guillon, Jean-François Aouillé), les services de Pédopsychiatrie(Yves Racine), Pierre Delion). De telles organisations du milieu humain dans lequel se déroule la vie quotidienne, même à temps partiel, plutôt que de laisser se pérenniser les attitudes de dépendance vis-à-vis des soignants et du système hospitalier, néfastes au traitement, ont permis et permettent de vivifier l’ambiance dans laquelle se passent les soins, de responsabiliser les patients sur des activités qui luttent de façon concrète contre les mécanismes d’aliénation, et surtout d’introduire de la différence entre les lieux et les moments de la journée. On comprendra l’importance de cette stratégie dans l’aspect diachronique du traitement en ce qu’elle assure une fonction phorique pour le patient, soit tout ce qui contribue à lui permettre d’être porté, tenu, soutenu, accompagné, tant qu’il ne peut le faire lui-même, comme pour l’enfant qui ne parle ni ne marche a lui aussi besoin d’être porté dans les bras et dans la parole de ses parents jusqu’à ce qu’il puisse le faire lui-même. Il y a donc une véritable dialectique entre l’accueil, le club thérapeutique et la fonction phorique. Mais cette stratégie est également importante sur le plan synchronique puisqu’elle met en évidence le chemin que le patient va être amené à prendre, et pour tout dire, à choisir, même par le négatif. Ne pas aller au rendez-vous prévu peut avoir plus d’importance que d’y avoir été sans y être vraiment. Il y a incidemment toute une réflexion sur le travail du négatif à mener dans ces nouvelles perspectives des institutions articulées entre elles, voire même « structurées comme un langage »...
http://ancien.serpsy.org/psy_levons_voile/psychotherapie/club.html
Dans son texte écrit en 1959 pour le rapport introductif aux journées annuelles de la Fédération Nationale des Sociétés Croix-Marine à Paris, Oury reprend très en détail l’histoire et la conceptualisation des clubs thérapeutiques et je ne peux qu’y renvoyer le lecteur. Pour lui, « le développement des véritables clubs est relativement récent et semble résulter de la convergence de plusieurs courants : remise en question des fondements de la psychopathologie par l’avènement du freudisme ; doctrine de la thérapeutique active d’Hermann Simon à Gütersloh après la première guerre mondiale ; développement des psychothérapies de groupe aux Etats-Unis à partir de 1930 ; les activités extra-hospitalières s’inspirant de K. Lewin à la Tavistock Clinic en Angleterre et aboutissant pendant la deuxième guerre mondiale à des applications à la thérapeutique hospitalière ; l’impulsion donnée par Bierer à la constitution de clubs socio-thérapeutiques ; l’occupationnal therapy ; le développement des méthodes actives dans le domaine de la pédagogie proposé par Makarenko, Montessori, l’école de Hambourg, le mouvement Freinet, etc ; les mouvements de jeunesse tels que le Scoutisme, les Auberges de jeunesse...(...) Nous voudrions souligner cette brusque éclosion de conceptions analogues dans divers domaines : psychiatrie, pédagogie, protection de la jeunesse,...Résultant de manifestations du profond remaniement historique et de remise en cause de la plupart de nos principes par éclatement des cadres culturels, les clubs thérapeutiques apparaissent dans cette perspective comme une étape d’une remaniement structural de la société globale. Par la remise en question du style de la vie intérieure des hôpitaux, ils ouvrent ceux-ci au monde environnant. Paradoxalement, ils deviennent des foyers de culture, refondant la vie collective sur une tradition authentique ; le phénomène de la folie retrouvant sa dignité par sa fonction de remise en question permanente de nos règles de vie »
De nombreux clubs thérapeutiques, ou des structures approchantes, ont alors été réalisés : Daumézon à Fleury lès Aubrais, Sivadon et Follin à Ville Evrard, Le Guillant à Villejuif, Ey à Bonneval, Balvet et Requet à Lyon, Ueberschlag à Lannemezan, Fanon à Blida et surtout Tosquelles à Saint-Alban et Oury à la Borde. Le club thérapeutique est une structure associative rendue possible par la circulaire du 4 Février 1958. Elle s’appuie sur l’intérêt de l’intervention d’une association dans l’organisation du travail thérapeutique, évitant que l’argent gagné dans les ateliers thérapeutiques soit la propriété de l’hôpital et non de ceux qui ont travaillé. Une telle association loi 1901 est en général composée de soignants, et, si possible, de personnalités extérieures au soin, et porte le nom de comité hospitalier.
Ce comité passe convention avec l’établissement de référence et créé en son sein, un club thérapeutique composé suivant les cas et les expériences de chaque service, de soignants et de patients, voire de patients seuls. Les objectifs immédiats de ces clubs thérapeutiques sont de pouvoir organiser la vie quotidienne du service en assumant la responsabilité des achats et des dépenses de chaque atelier : la cafétéria, les ateliers créatifs et/ou de production...Mais les objectifs sous-jacents sont de disposer d’unetablature institutionnelle d’espaces et de temps diversifiés possiblement utilisables par le patient, même à son insu, comme les touches d’un clavier, ou mieux, comme les éléments d’un langage. Ces lieux dans lesquels de l’argent est « gagné » viennent autoriser des activités qui en « dépensent » tels les voyages, les sorties et activités culturelles, un journal, ou un fonds de solidarité. Une assemblée générale de tous les membres du collectif a lieu chaque semaine, un bureau est élu parmi les patients ; puis ce bureau élit son président, son secrétaire et son trésorier(il arrive que le trésorier élu par ses pairs du bureau pour gérer les comptes du club thérapeutique, soit lui-même sous curatelle aux termes de la loi du 3 Janvier 1968). Des réunions ont lieu pour poser les problèmes à débattre, prendre les décisions ; des votes sont organisés pour les décisions concernant le budget du club et les orientations ; une réunion régulière a lieu pour les malades « entrants », éventuellement suivie d’un repas, pour les accueillir et leur expliquer le fonctionnement du club thérapeutique et du service, leur présenter les différentes personnes qui y occupent une fonction ; les soignants sont là comme « conseillers techniques ». Depuis la mise en place de la politique de secteur, ce dispositif a été « extrapolé » et des innovations ont eu lieu, telles que la création de « clubs de secteurs »(Denis, Le Roux, ou des « clubs extra-hospitaliers » Colmin, Buzaré, avec tout un travail très intéressant de soutènement du traitement des patients par ces activités de groupes, et des liens avec les autres associations de quartier ou de village. D’autres encore ont utilisé la « fonction club »(Oury), c’est-à-dire un opérateur qui n’a pas forcément la présentation d’un club thérapeutique mais qui peut en avoir la fonction, par exemple une classe coopérative(Laffite ), une association culturelle(Chemla ) ou un journal. On retrouve ces expériences dans différents types d’établissements comme les classes plus ou moins spécialisées(Fernand Oury, Catherine Pochet ), les Instituts Médico-Educatifs(Claude Guillon, Jean-François Aouillé), les services de Pédopsychiatrie(Yves Racine), Pierre Delion). De telles organisations du milieu humain dans lequel se déroule la vie quotidienne, même à temps partiel, plutôt que de laisser se pérenniser les attitudes de dépendance vis-à-vis des soignants et du système hospitalier, néfastes au traitement, ont permis et permettent de vivifier l’ambiance dans laquelle se passent les soins, de responsabiliser les patients sur des activités qui luttent de façon concrète contre les mécanismes d’aliénation, et surtout d’introduire de la différence entre les lieux et les moments de la journée. On comprendra l’importance de cette stratégie dans l’aspect diachronique du traitement en ce qu’elle assure une fonction phorique pour le patient, soit tout ce qui contribue à lui permettre d’être porté, tenu, soutenu, accompagné, tant qu’il ne peut le faire lui-même, comme pour l’enfant qui ne parle ni ne marche a lui aussi besoin d’être porté dans les bras et dans la parole de ses parents jusqu’à ce qu’il puisse le faire lui-même. Il y a donc une véritable dialectique entre l’accueil, le club thérapeutique et la fonction phorique. Mais cette stratégie est également importante sur le plan synchronique puisqu’elle met en évidence le chemin que le patient va être amené à prendre, et pour tout dire, à choisir, même par le négatif. Ne pas aller au rendez-vous prévu peut avoir plus d’importance que d’y avoir été sans y être vraiment. Il y a incidemment toute une réflexion sur le travail du négatif à mener dans ces nouvelles perspectives des institutions articulées entre elles, voire même « structurées comme un langage »...
statut rôle fonction
Statut, Rôle, Fonction. Extrait d’un colloque à Tours. Jean Oury.
Source : http://cliniquedelaborde.pagesperso-orange.fr/Auteurs/OURY%20jean/Textes/texte11.htm
Je dis depuis toujours que le premier exercice à faire le matin, c’est distinguer rôle, statut et fonction.
Le statut, ce n'est pas tellement sur le plan symbolique, même si ça y touche, c'est : "Tu es embauché en tant que, psychologue, infirmier ou cuisinier, c’est ton statut ». Allez voir la feuille de paye et vous verrez le statut ! Mais cela reste quelque chose qui n’est pas vraiment symbolique mais plutôt de l’ordre de la réalité, c’est à dire un mélange, un entrecroisement entre le symbolique, le réel et l’imaginaire.
Par contre, le rôle, on peut le définir comme on veut. Il y a eu des thèses sur ce qu’est le rôle, par exemple un livre de madame Rochoblave qui date d'une quarantaine d’années. Il y a des questions qui se posent de façon exhaustive, mais comme c’est contradictoire, on peut choisir ce qu'on veut, on peut même inventer un sens. Alors moi j’ai inventé pour moi un sens du rôle : le rôle, souvent, c'est ce qu'on ignore soi-même, ce sont les autres qui vous le donnent. Par exemple, je pense à un schizophrène qui était vu par une psychothérapeute, médecin, de La Borde. Elle le voyait pendant quelques minutes, tous les trois ou quatre jours. Elle le voyait dix minutes en moyenne. Un jour, peut-être qu'elle était pressée ou fatiguée, elle l'a vu trois minutes. Le type s'est fâché on disant : «Vous savez, il me faut sept minutes tous les trois jours, sans quoi les mots perdent leur sens et je ne peux pas être avec les autres à table, je peux être très violent à ce moment-là I". Et en même temps, il lui a dit : "Vous êtes mon analyste I"
Alors là, c'est extraordinaire : elle ne savait pas qu'elle était dans une position analytique. C'est un rôle qu'il lui a donné, qui n'était pas purement imaginaire, qui avait quelque chose à voir avec une rythmicité du temps. Parfois, on joue un rôle qu'on ignore. Il faut faire attention justement à ce qui se passe : "Tu ne savais pas que tu avais ce rôle-là pour lui ? Tu es un peu bigleux !"
Pour finir, la fonction. Alors là, la fonction, c'est grandiose. C'est la fonction médico-psychothérapique. Et justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la fonction psychothérapique, en ce qui concerne les schizophrènes, doit être partagée. Je cite souvent ce mot de Pindare : "Partage est notre maître à tous". Ça fait bien de dire ça ; ça se partage. Il n'y a pas le psychothérapeute et puis ceux qui sont là, sont là seulement pour soigner. Là, je prends une distance vis-à-vis par exemple de Racamier -"Le psychanalyste sans divan» et toute cette époque où on disait qu'il y avait le psychanalyste et puis les autres... Ce n'est pas ça.
La fonction soignante doit être justement ventilée. Je le disais tout à l'heure : pour un malade, une dizaine de personnes. Alors là, entre en jeu le problème de la fonction -1 et toutes ses articulations, les groupes de contrôle... La fonction soignante doit être ventilée, et on peut dire qu'elle ne peut pas être incarnée. Je dis souvent qu'un psychothérapeute qui se croit le seul psychothérapeute de tel malade pris dans une collectivité, il est complètement fou, il se prend pour un statut. Souvent dans les réunions -ça me fait bien voir, de dire ça - ou le directeur est assis à côté de moi.
Source : http://cliniquedelaborde.pagesperso-orange.fr/Auteurs/OURY%20jean/Textes/texte11.htm
Je dis depuis toujours que le premier exercice à faire le matin, c’est distinguer rôle, statut et fonction.
Le statut, ce n'est pas tellement sur le plan symbolique, même si ça y touche, c'est : "Tu es embauché en tant que, psychologue, infirmier ou cuisinier, c’est ton statut ». Allez voir la feuille de paye et vous verrez le statut ! Mais cela reste quelque chose qui n’est pas vraiment symbolique mais plutôt de l’ordre de la réalité, c’est à dire un mélange, un entrecroisement entre le symbolique, le réel et l’imaginaire.
Par contre, le rôle, on peut le définir comme on veut. Il y a eu des thèses sur ce qu’est le rôle, par exemple un livre de madame Rochoblave qui date d'une quarantaine d’années. Il y a des questions qui se posent de façon exhaustive, mais comme c’est contradictoire, on peut choisir ce qu'on veut, on peut même inventer un sens. Alors moi j’ai inventé pour moi un sens du rôle : le rôle, souvent, c'est ce qu'on ignore soi-même, ce sont les autres qui vous le donnent. Par exemple, je pense à un schizophrène qui était vu par une psychothérapeute, médecin, de La Borde. Elle le voyait pendant quelques minutes, tous les trois ou quatre jours. Elle le voyait dix minutes en moyenne. Un jour, peut-être qu'elle était pressée ou fatiguée, elle l'a vu trois minutes. Le type s'est fâché on disant : «Vous savez, il me faut sept minutes tous les trois jours, sans quoi les mots perdent leur sens et je ne peux pas être avec les autres à table, je peux être très violent à ce moment-là I". Et en même temps, il lui a dit : "Vous êtes mon analyste I"
Alors là, c'est extraordinaire : elle ne savait pas qu'elle était dans une position analytique. C'est un rôle qu'il lui a donné, qui n'était pas purement imaginaire, qui avait quelque chose à voir avec une rythmicité du temps. Parfois, on joue un rôle qu'on ignore. Il faut faire attention justement à ce qui se passe : "Tu ne savais pas que tu avais ce rôle-là pour lui ? Tu es un peu bigleux !"
Pour finir, la fonction. Alors là, la fonction, c'est grandiose. C'est la fonction médico-psychothérapique. Et justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la fonction psychothérapique, en ce qui concerne les schizophrènes, doit être partagée. Je cite souvent ce mot de Pindare : "Partage est notre maître à tous". Ça fait bien de dire ça ; ça se partage. Il n'y a pas le psychothérapeute et puis ceux qui sont là, sont là seulement pour soigner. Là, je prends une distance vis-à-vis par exemple de Racamier -"Le psychanalyste sans divan» et toute cette époque où on disait qu'il y avait le psychanalyste et puis les autres... Ce n'est pas ça.
La fonction soignante doit être justement ventilée. Je le disais tout à l'heure : pour un malade, une dizaine de personnes. Alors là, entre en jeu le problème de la fonction -1 et toutes ses articulations, les groupes de contrôle... La fonction soignante doit être ventilée, et on peut dire qu'elle ne peut pas être incarnée. Je dis souvent qu'un psychothérapeute qui se croit le seul psychothérapeute de tel malade pris dans une collectivité, il est complètement fou, il se prend pour un statut. Souvent dans les réunions -ça me fait bien voir, de dire ça - ou le directeur est assis à côté de moi.
title 2
Psychopathologie des soins quotidiens – Une boussole pour soignant désorienté Mission Sans-Abri de Médecins du Monde
Psychopathologie des soins quotidiens – Une boussole pour soignant désorienté
Mission Sans-Abri de Médecins du Monde
Texte présenté aux XXXIè Journées de Psychothérapie Institutionnelle
12-13 Octobre 2017
Le texte que nous vous présentons aujourd'hui a été élaboré, pensé et rédigé en équipe afin
de vous témoigner de notre travail auprès des personnes sans abri ainsi qu'au sein de notre collectif.
Notre démarche est celle d'aller-vers les personnes de la rue, au rythme de trois ou quatre
maraudes par semaine, de jour ou en soirée, à pied, en civil, régulièrement dans le même périmètre
et toujours en binôme car il est essentiel de ne pas s’engager seul dans la rue. Parce qu’« un homme
seul n'est pas un homme » disait Lacan, nous visons à créer du lien, des liens, afin d'amarrer le sujet
en errance, relever et mettre en mouvement le sujet coulé dans l’asphalte du trottoir. Créer un lien
pour lui permettre d’exister et de s’inscrire dans des soins somatiques ou des prises en charge
sociales. Si le sens de notre action prend racines dans la rue, celle-ci acquiert toute sa signification
au cours et grâce aux réunions hebdomadaires d’échanges et de travail, lieu de récits certes, mais
surtout invitation à la parole avec nos inquiétudes, nos doutes et nos interrogations. Pour nous, une
remise en cause permanente de nos certitudes est plus qu'obligatoire, nous ne pouvons pas y
échapper. Portés par les valeurs de Médecins du Monde, « Soigner et témoigner », toute notre action
s’accompagne d’une attention à l’autre, sans-abri ou Maraudeur, car la précarité n’est pas réservée
aux gens de la rue : elle traverse également le vécu des habitants de la ville, des institutions, des
travailleurs sociaux avec lesquels se tissent des liens invisibles.
La préparation de cette présentation a été l'occasion de nombreux échanges. Écrire pour
s'exposer dans sa parole est toujours une prise de risque, produit des effets inattendus et souvent
féconds ; ici aussi, la mise au travail est venue révéler la tension dialectique qui s’exerce en nous et
entre nous dans la réalisation de « notre mission ».
« Psychopathologie des soins quotidiens, une boussole pour soignant désorienté »… De
prime abord, ce sujet était fait pour nous car parler de désorientation et de boussole à des
maraudeurs, forcément, ça matche ! Les « soins quotidiens » cela semblait bien être notre « job » …
car ce que nous prétendons, c’est prendre soin de la personne sans abri dans une présence aussi
quotidienne que possible. Mais peut-on qualifier notre action de « soins quotidiens » alors que nous
faisons irruption dans la vie des SDF ? Et sommes-nous des soignants ? Psychopathologie des soins
quotidiens, qu’est-ce que cela veut dire ? Avec sa psychopathologie de la vie quotidienne, Freud
révèle l’inconscient qui nous gouverne. Avec cette « psychopathologie des soins quotidiens »,
sommes-nous invités par l’AMPI à nous intéresser à cet inconscient qui se dévoile dans nos
1
errements ? Et de quel inconscient parlons-nous ? Celui des personnes vers lesquelles nous allons
ou le nôtre ? Ainsi, nous avons donc recherché nos impasses, nos dissonances, nos refuges pour
tenter d’entendre quelque chose…
Tel un autre maternel suffisamment bon, notre démarche est d’abord celle d'aller à la
rencontre de cet autre, de ces autres en rupture avec le social, assis sur le macadam une main
tendue, une casquette devant eux. C'est ainsi que nous décidons, au gré de nos pérégrinations, de
nous arrêter sur les bords du chemin et d'adresser un regard, une salutation, au creux du quotidien
de ces personnes exclues, au moment de la manche, du repos, du déjeuner, chez eux, sur ce bord de
trottoir ainsi approprié le temps d'une halte plus ou moins éphémère.
Comment s'adresser à eux et comment être accueillant ? Dans ce mouvement d’aller vers,
nous nous rendons chez eux, nous les interpellons, notre présence, nos mots s’imposent à eux sans
qu’ils n’en aient rien demandé. En retour, ils restent figés, ou nous regardent passivement nous
rapprocher, ils nous serrent la main, nous tendent leur chapeau, nous questionnent : « Qu'est ce que
vous voulez ? »... C’est vrai ça, « qu’est-ce que nous voulons » ?
Pourquoi s’adresse-t-on à un tel plutôt qu’à tel autre ? Qu’est-ce que nous disons à notre
corps défendant en désignant telle ou telle personne comme une personne sans abri ? Chacun fait
selon son inspiration, ses peurs, ses fantasmes, les uns évitent les groupes, les autres les personnes
très alcoolisées, les derniers ceux qui crient … Ce sont nos propres mouvements psychiques qui
nous font nous déplacer vers les uns plutôt que vers les autres.
Aller vers, c’est faire précéder l’offre à la demande. Cela commence toujours par un regard,
un mouvement, un geste et quelques mots :
« Bonjour, comment allez-vous ?»
« Je m'appelle Raymond, je fais partie de MDM, tout va bien ? Vous avez besoin de quelque
chose ? »
« Bonjour, je m'appelle Corinne, est-ce que je peux parler avec vous ? Je ne vous dérange
pas ? »
« Bonjour, est-ce que je peux m'asseoir pour discuter avec vous ? »
« Bonjour, moi c'est Marine et vous, c'est comment ? »
Si nous nous présentons comme une équipe de MDM, ce n’est que très rarement que nous
précisons notre profession, en particulier ceux d’entre nous qui pourraient faire partie des
« soignants », de peur peut-être que cet énoncé ne puisse venir entraver la possibilité de la
rencontre, nous réduisant à n'être les uns et les autres que des soignants et des soignés.
« Bonjour, comment allez-vous ?». Cette phrase que dit-elle de nous ? N’est-ce pas une
étrange façon d’aller vers : de quelle place demandons-nous à l'un de nos semblables comment il va
2
avant même de le connaître ? Apparemment « si naturelle » ou bienveillante, cette phrase ne seraitelle
pas violente ou intrusive ? Elle semble inscrire d'emblée cette personne que nous souhaitons
rencontrer dans une différence ; elle énonce quasi-explicitement nos fantasmes de réparation, elle
véhicule nos représentations de la précarité, nous réduisant le sujet au « sans abrisme ».
« Je m'appelle Raymond, je fais partie de MDM, tout va bien ? vous avez besoin de quelque
chose ? ». L'accroche implique ici une demande matérielle, elle nous protège, légitime notre venue,
correspond à nos projections… Mais ne prend-on pas le risque qu’elle ouvre et ferme la rencontre
dans le même temps ? Sommes-nous vraiment là pour ça ? Pourquoi venons-nous interroger leur
besoin quand le plus souvent nous ne pouvons pas y répondre ?
On le voit, ce premier contact est difficile pour eux peut-être, pour nous certainement. Il n’est pas la
rencontre mais il n’a de sens que s’il peut être inaugural à celle-ci.
Avec pour références la psychothérapie institutionnelle et la psychanalyse, nous voulons
déployer une clinique de l’accueil, d’humanisation du Sujet, une clinique qui permette une mise en
élaboration progressive d'une parole, conduisant à une restauration du sujet et de son espace intime.
Tout en défendant la logique médico-sociale de Médecins du Monde (la survie de chacun et l’accès
aux soins pour tous restent pour nous une préoccupation permanente), nous souhaitons nous situer
dans le champ de l'intime, au plus près du sujet pris dans une double aliénation psychique et sociale.
Comment déployer cette clinique de la présence dans la rue ? Qu’est-ce que la présence dans un
espace qui n’existe pas, en tant qu’il est sans limite et mouvant ? Quel espace notre présence
pourrait-elle ainsi venir habiter ?
Confrontés nous même à l’errance dans nos maraudes, notre premier défi est de rendre notre
présence ni évanescente ni envahissante. Issu du latin sionare, le « soin » signifie « s'occuper de »,
il est « l'attention que l'on porte à faire quelque chose avec propreté, à entretenir quelque chose. » Il
suppose quelque chose de la continuité, de la quotidienneté. C’est alors cette répétition dans le
temps qui est l’objet de notre attention. La régularité de nos maraudes et nos rituels langagiers ou
gestuels viennent scander le temps, marquer des limites à l’espace informe et crée les possibilités de
la rencontre. Ils nous rendent présents. C’est cela notre premier engagement et c’est le plus
exigeant.
Car cette continuité et cette position d’accueil sont difficiles à tenir.
Nous croisons un jour Emile, avec qui nous avons développé quelques liens au fil de nos maraudes,
parlant avec lui de son histoire comme de l'Histoire de la France, de musique et de littérature, de
chiens … Allant vers lui, l'un de nous demande une première fois « Comment allez vous ? »,
« bien » répond-il. Nous sommes sur une artère passante, il y a beaucoup de bruit, nous nous
asseyons par terre près de lui. Distraits par cette installation, nous n’entendons pas sa réponse et ré-
3
itérons la question « Comment allez vous ? ». Emile se lève brusquement, cherchant à échapper à
notre présence, il s'énerve, crie : « Mais qu'est ce que vous me voulez à la fin je n'ai pas besoin de
tuteur moi, je n'ai pas besoin d'un tuteur ! ». Nous restons figés, désarçonnés, décontenancés,
plongés dans notre incompréhension. Nous tentons de le calmer mais rien n’y fait, il est debout,
s'agite, très impressionnant. Après un échange de regard, nous prenons la décision de partir face à
son refus de nous parler et le saluons timidement.
Que s’est-il passé pour Emile dans cette rencontre ? Quelle absence, quelle intrusion serions-nous
venus introduire ou incarner ?
Dans un après coup, une fois l'émotion de cette altercation atténuée, nous réalisons que, pour la
première fois, avant d’aller vers lui, nous nous étions adressés à un autre homme non loin de lui.
Cet événement, pourtant anodin, serait-il venu souligner notre appartenance à Médecins du Monde
et placer Emile comme un SDF parmi tant d'autres ? Comme si, tout à coup, nous n'étions plus sur
un pied d'égalité, nous venions représenter un grand Autre social trop persécuteur, un « tuteur ».
Dans « tuteur » il y a presque tueur… Nous sommes-nous montrés défaillant à ne pas l’entendre,
trop pris par notre propre installation ? Avons-nous fait intrusion chez lui ? Nous n’avions pas
demandé si nous pouvions entrer…
Ainsi, entre une absence d'Autre social fuyant ou un vécu de sa trop grande présence
touchant à la persécution, nous nous situons sur un fil de funambule, tentant de ne pas vaciller entre
deux écueils. Notre engagement dans la continuité est une nécessité lorsque nous faisons le pari
d'un possible, d'une création dans et par le lien. Pour nous qui n’apportons rien, cette présence à
l’Autre n’est faite que de cette continuité. Elle est notre clinique du quotidien, dans la répétition
régulière de nos mots et de nos mouvements venant différencier les espaces pour permettre de les
habiter. Répétition des soins de cet autre souvent maternel, renforçant le sentiment de continuité
d’existence et débouchant sur la construction d’un récit, d’une histoire, commune qui nous lie les
uns aux autres.
Pour les sujets souffrant de troubles psychiatriques, la rencontre avec l'Autre dans la rue,
peut avoir pour conséquence une déglaciation selon les termes de Salomon Resnik, une réanimation
psychique du sujet, où nous devons faire attention aux mouvements de retour de refoulés, à la
résurgence d'événements traumatiques, de mouvements d'agressivité, dans ces moments
particulièrement intenses. Entre défaut ou excès de circulation, telles deux faces d'une même pièce,
« l'asphaltisation » comme l’errance viennent anesthésier le sujet dans la rue, dire son impossible
inscription dans le monde et le « tenir » à distance. L'émergence d'un discours adressé à un Autre
pourrait entraîner une hémorragie psychique ou réactiver une fuite, face à l'incapacité d'inscription
en un lieu, en une temporalité fixe et faisant sens pour le sujet. Alors que d'autres patients peuvent
4
se mouvoir physiquement comme psychiquement entre différents lieux, dans une possibilité de
circulation entre les espaces externes et intimes, les plus fragiles dans la rue n’ont souvent pour seul
lieu de référence que l'asphalte même, où le bord du trottoir peut venir marquer un bord de
précipice psychique à la chute sans fond.
L’histoire de la mission est celle de ces moments heureux où les personnes avec lesquelles se
sont tissées des liens ont pu trouver un lieu où s’inscrire, vivre ; mais elle est aussi celle de moments
douloureux où la décompensation somatique ou psychique nous rappelle parfois dramatiquement
que ce qui nous paraît urgent ne l’est pas toujours, et que le temps de l’action doit respecter le temps
psychique du sujet. Nous pourrions ainsi vous raconter l’histoire de Jean Claude ou celle de
Georges qui sont décédés quelques mois suite à leur mise à l’abri.
Survivre est parfois plus facile que vivre.
L’équilibre est fragile, la continuité délicate à maintenir, mise à mal par le Réel. « L’absurde
naît de cette confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable du monde », nous dit
Albert Camus dans Le mythe de Sisyphe (1942). Cette clinique de l'extrême, de l’absurde nous
plonge inlassablement dans un non sens.
Travailler en équipe, marauder en binôme ainsi que penser et développer notre boîte à outils
deviennent alors sans cesse nécessaires : sans cela, comment penser cet absurde, comment faire face
à cette violence ? Sans réflexion, il y a ou trop ou pas assez de retour, de continuité, prenant le
risque de faire vaciller les fragiles constructions subjectives bâties sur les bords de l’errance ou de
l’asphaltisation.
La question du don revient massivement dans nos réflexions. Elle est omniprésente par la
misère qui s’offre à nos yeux ou par la demande plus ou moins explicite des personnes que nous
rencontrons.
Cette dernière nous ramène une nouvelle fois à l'absurde et à l’inconfort de notre démarche. Faut-il
ou non donner ? Si nous donnons un jour, que fera-t-on le jour suivant ? Si nous ne donnons pas, ne
faillons-nous pas à être cet être secourable ?
Nous en parlons sans cesse en réunion :
« Quand je rencontre quelqu'un qui a vraiment faim comme ce soir, je fais quoi : je parle ou je
lui donne un sandwich ? »
« Moi je les nourris d'abord pour qu'ils parlent la semaine d'après. »
J’ai rencontré Jean, je l’ai invité à venir à la Sardinade. Il m’a rétorqué « Tu vas pas m'acheter
avec des sardines. »
5
« On rencontre un slovaque qui nous demande sans arrêt des baskets du 47, mais c'est pas
évident de trouver des baskets du 47 ! On a fait tous les magasins de sport mais ils s'arrêtaient
au 45, on était désespéré. Finalement, le mec a disparu une fois qu'on les avait trouvés,
heureusement qu'on les a pas acheté ! »
Moi l’autre jour j’ai demandé « Qu'est ce qui pourrait vous faire plaisir ? »… et du coup il m’a
répondu : « Vous croyez qu'on a beaucoup de plaisir dans la rue ? »
« Moi j'avais à manger quand j’ai maraudé hier et donc je leur ai donné… On dira que c'est
parce que je suis nouvelle, que je savais pas qu’on ne donnait pas. »
Nous nous sommes réunis en séminaire l’année passée pour tenter cette question.
A cette occasion, sous avons redit le fondement de notre mission : s'intéresser avant tout à la
relation et ce, sans céder sur notre désir qui risquerait de nous plonger dans du pur humanitaire.
Pour cela, notre travail est d’accepter la frustration de ne pas aider matériellement, de se confronter
à la castration, de se dégager d'une position où nous voudrions faire pour l'autre, à sa place. Nous
sommes là sans rien, et dans ce « rien » se cristallise toute notre position soignante, car, ne venant
rien boucher de la relation avec un objet, nous laissons plutôt dérouler quelque chose du sujet et de
sa demande. Ce rien ouvre le don de confiance et la relation transférentielle. Ce que nous offrons,
c’est nous-même, notre personne propre comme lieu d'adresse Autre où nous accueillons une
singularité malmenée par les errements de l'exil ou de la fuite, les problématiques toxicomanes,
psychotiques ou encore les questions existentielles propres à chaque sujet.
Pour autant, nous ne pouvons laisser quelqu’un mourir de froid dans la rue, ou sans eau en
plein été. Et il n’y a pas à se questionner : ils ont froid, on donne le duvet, ils ont soif, on donne de
l’eau. Toute la difficulté est que cet objet vital ne devienne pas alors tout l’enjeu de la relation : il
est un à-côté sur lequel nous n'avons pas à nous arrêter. Ainsi, nous sommes partis contents de notre
séminaire avec un nouvel outil en poche « L’objet n’est pas un enjeu » !
Soit « l'objet n'est pas un enjeu », mais que devons-nous faire lorsqu'il semble le devenir ?
Nous rencontrons régulièrement un groupe d'hommes. Parmi eux, des personnes qui ont un abri la
nuit mais errent toute la journée durant, d’autres qui sont dans des squats ou à la rue. Plusieurs
d’entre eux ont des soucis de santé importants. Ils sont pour certains pris en charge par des équipes
partenaires sociales ou sanitaires. En lien avec eux, nous tentons de nous rendre présents à eux pour
accompagner à terme les plus fragiles vers les soins. Souvent, quand nous allons les voir, ils sont
alcoolisés et continuent à s'alcooliser devant nous tout en étant toujours accueillants.
Une fois, ils nous demandent à manger. Parce que nous sentons que certains d’entre eux sont en
grande difficulté et parce que « l’objet n’est pas un enjeu » et que, on leur achète de quoi se faire
6
des sandwichs. Une fois, deux fois, trois fois… Chaque fois qu'un binôme de maraudeurs passe les
voir, ils sont par un transfert massif et une demande matérielle qui prend de plus en plus de place.
Nous en parlons, y retournons, et cette fois, on les accompagne pour qu’ils achètent eux-mêmes.
Lors d'une maraude où ils ne sont que trois, ils disent avoir froid ; nous nous engageons à leur
ramener des duvets, tel jour vers telle heure. Au moment prévu, nous arrivons avec nos trois
duvets : ils sont cinq ! Embêtés, nous tentons de tenir quelque chose de notre parole ou de se
protéger derrière l'énonciation d'une règle : « Les duvets étaient pour telle et telle personne, si vous
en voulez on vous en ramène la prochaine fois ». L’agitation, le ton montent… Nous nous sentons
pris dans des enjeux groupaux qui nous échappent. Nous laissons les 3 duvets, très soucieux des
effets de ce « don insuffisant », un instant angoissés à l'idée qu'ils puissent se battre, tentant de se
rassurer l'instant d'après en se disant qu'ils en ont régulièrement et « de toute façon, ils les
revendent ». Nous nous défendons comme nous pouvons, face à nos fantasmes, et cette réalité en
étroite collusion avec un Réel inquiétant.
Quelques jours plus tard, une autre équipe, une autre maraude. Ils sont toujours en groupe.
Le dialogue s’engage mais nous sommes préoccupés par Rachid qui est très affaibli. Il ne veut pas
qu’on appelle les secours ni aller consulter. Il tremble. Très hésitants, nous finissons par prendre
congés d’eux. Puis nous revenons sur nos pas, inquiets, pour proposer un café ou un chocolat chaud.
Amine nous agresse : « Et vous croyez qu’on a besoin de vous pour cela ? »... et « D’ailleurs à quoi
vous servez ? ». D’autres membres du groupe viennent nous protéger « Tu sais bien qu’il n’apporte
pas à manger, MDM ! ». Rachid nous retient par le regard mais ne s’exprime pas. Amine se lève,
l’excitation croît. Les autres calment le jeu « Vous pouvez y aller, ne vous inquiétez pas ». Nous
repartons.
Dans la rencontre avec ce groupe, plusieurs phénomènes sont venus se télescoper : le
groupe, la présence parmi ses membres de Rachid, très affaibli, épileptique et grand alcoolique,
objet de notre souci, le froid,… Et l’effet de notre séminaire de réflexion venu nous mettre à l’abri
de notre inconfort par cette belle formule que « l’objet n’est pas l’enjeu ». Lors de nos reprises en
réunion hebdomadaire, dans un travail de constellation transférentielle, nous avons pu toucher du
doigt ce qui sans doute s’était joué à notre insu : nous avons découvert que dans ce groupe, Amine
avait une place de leader, de protecteur… En apportant ces duvets, en prenant soin de Rachid, nous
étions venus déstabiliser le fonctionnement du groupe et peut-être destitué Amine dans la place qu’il
prenait en son sein...
Nous sommes en permanence aux prises de ce conflit : d’un côté agir face à la maladie et à
la misère et d’un autre désirer respecter le temps psychique du sujet.
Si l’objet n’est pas en enjeu, la place de l’objet dans les relations que nous tissons avec les
personnes de la rue ne serait-elle pas tout l’enjeu de notre propre travail psychique ? Ne serait-ce
7
pas dans l’analyse « psychopathologique de nos dons » que les soignants désorientés que nous
sommes pourraient trouver leur boussole ?
Nous rencontrons un couple, Anne et Vincent. Anne est enceinte de sept mois. Cette situation
est pour nous tout de suite une urgence, il faut que nous puissions être là si besoin est au moment
de l’accouchement. Trois maraudeurs vont à leur rencontre plus régulièrement et leur donnent
un numéro de téléphone. Vincent, toxicomane, n’est pas suivi ; Anne dit être « clean », elle est suivie
par un CSAPA. A chacune de nos rencontres, ils nous rassurent tout en nous demandant implicitement
quelque chose, jamais directement. De l’argent surtout, pour manger, pour une nuit d’hôtel,
pour préparer la venue du bébé… On hésite à donner, puis on donne, on se réunit, on en parle, puis
on hésite…
- Pourquoi de l’argent ? Est-ce pour acheter de la drogue ?
- Ils ne peuvent pas rester à la rue, cet enfant ne peut pas naître dans le caniveau, nous devons
leur payer l’hôtel jusqu’à l’accouchement…
Tout nous fige. Cet enfant qui peut naître sur le trottoir c’est l’image de cette détresse primordiale
qui vient nous cueillir. Nous sommes comme fascinés, pris par cet hilflos mortifère, par
cette jouissance inconsciente face au spectacle voyeuriste d'une réalité de la misère confinant au
Réel. Nous ajoutons des réunions "exceptionnelles" au mois d'août, on essaie d'élaborer autour de
cette demande toujours implicite mais omniprésente. Nous relevons toutes les incohérences de leur
discours, nous tentons de comprendre leur demande. Nous les connaissons peu finalement, nous
n’avons que très peu d'éléments de leur histoire. Nos fantasmes viennent recouvrir la réalité… On
imagine, se répète, se questionne, puis... On redescend sur terre... Et de nouveau on imagine, se répète,
se questionne. Bref, nous tournons en rond avec l'envie et le besoin pour eux comme pour
nous de se décaler de ce temps chronologique mais dans une impossibilité. Ce bébé va arriver, elle
va accoucher et le risque qu'elle accouche dans la rue est grand. C'est une urgence mais le temps logique
de l'inconscient ne prend, lui, pas en compte cette urgence.
Le temps passe... Elle accouche, tout se passe bien même si c’est moins une. Les analyses
révèlent de nombreux toxiques dans le sang de la mère. S’ensuit le sevrage du bébé. Le père arrive à
s'engager dans une prise en charge. Ils sont suivis par la maternité puis par trois associations différentes
au moins. Nous travaillons avec les autres acteurs ; ils tentent de répondre à leur demande,
cèdent puis lâchent : la maternité les fait sortir, une association leur donne une somme d’argent pour
une mise à l’abri temporaire avec l’enfant puis disparaît... Semble ainsi se répéter un mouvement où
l’objet n’arrive jamais à satisfaire la demande mais où il vient rompre les liens. Pendant ce temps là,
nous tentons de maintenir un lien. Ils ne nous appellent que pour demander. Nous avions donné un
peu d’argent pour quelques nuits d’hôtel avant l’accouchement… Cet argent n’a sans doute pas ser-
8
vi à cela… Nous cédons à nouveau sur les couches et sur la poussette, « parce que c’est le soin du
bébé et que cela fait partie de la mission de MDM »… en fait la PMI fournit déjà tout cela… Nous
voilà nous aussi pris dans leur propre répétition… Mais nous le lâchons pas, nous tentons de rester
là pour eux, au-delà des demandes… Nous les écoutons, nous parlons de leur demande, nous ne disons
non, nous tentons de les accompagner vers des acteurs qui pourraient les aider… Et ce faisant,
ils continuent à nous rappeler, un lien semble s’être créé. Et demain ? Nous n’en savons rien, nous
tentons de rester connecté sans imposer notre présence.
De quel objet parlons-nous ?
Il y a l’objet qui répond aux besoins de première nécessité sans lequel il n’y a pas de vie. La
mère nourrit l’enfant de lait et de mots. Dans le dénuement extrême, et c’est le cas pour tous ces
corps échoués sur l’asphalte, rigidifiés par le froid, l’ivresse ou la chaleur, il ne peut y avoir d'autre
maternel sans ses soins de première nécessité.
Il y a l’objet qui est le support à la découverte de l’environnement, l’objet sur lequel vient
s’étayer la relation, l’objet qui permet de parler. Pendant plusieurs années, un membre de la mission
a apporté à un monsieur psychotique qui vivait dans la rue chaque semaine, une canette de coca et
une orange. De canette en orange s’est tissé un lien qui a permis après plusieurs années de mettre à
l’abri ce monsieur. Et aujourd’hui encore, on lui apporte cette canette et cette orange hebdomadaire.
Ces objets ont ouvert la possibilité d’un autre. Le don invite au contre-don, selon Marcel Mauss, il
est au fondement de l’échange et de l’organisation sociale.
Et puis il y a l’objet qui vient boucher la demande, parce qu’il la précède, la camoufle. Cet
objet qui nous rend sourd en nous enfermant dans notre satisfaction narcissique.
Citons une personne anciennement SDF « Donner, je trouve que ça instaure une hiérarchie. On
n’est pas sur un pied d’égalité, cela nous met en dette. J’ai beaucoup de reconnaissance vis-à-vis
de ce que l’on m’a donné quand j’étais SDF, mais revenir à la vraie vie, ce n’est pas être redevable
tout le temps. Quand on reprend sa place d’humain, on doit pouvoir refuser cette dette ».
La place de l’objet est chaque fois à repenser selon les situations, avant et sur le moment mais
surtout dans l’après-coup car ce qui compte, ce n’est pas tant ce que nous faisons ou donnons dans
la rue (faire et donner c’est aussi prendre le risque de la vie), ce qui importe c’est la pensée qui suit
nos actes. Car c’est dans l’après-coup qu’un acte peut devenir passage à l’acte.
9
En conclusion : une clinique de l’humanité
« Tous les jours, pendant six mois, un ouvrier civil italien [Lorenzo] m'apporta un morceau de pain
et le fond de sa gamelle de soupe ; il me donna un de ses chandails rapiécés et écrivit pour moi une
carte postale qu'il envoya en Italie et dont il me fit parvenir la réponse. Il ne demanda rien et
n'accepta rien en échange, parce qu'il était bon et simple, et ne pensait pas que faire le bien dût
rapporter quelque chose. […] Je crois que c'est justement à Lorenzo que je dois d'être encore vivant
aujourd'hui, non pas tant pour son aide matérielle que pour m'avoir constamment rappelé, par sa
présence, par sa façon si simple et facile d'être bon, qu'il existait encore, en dehors du nôtre, un
monde juste, des choses et des êtres encore purs et intègres que ni la corruption ni la barbarie
n'avaient contaminés, qui étaient demeurés étrangers à la haine et à la peur ; quelque chose
d'indéfinissable, comme une lointaine possibilité de bonté, pour laquelle il valait la peine de se
conserver vivant. [...] C'est à Lorenzo que je dois de n'avoir pas oublié que moi aussi j'étais un
homme. » Primo Levi, Si c'est un homme, (1947), p.186-190.
A l'heure d'un lien social tarifé, marchandisé, contre-sens anthropologique, selon le mot de
l'économiste Frédéric Lordon, notre mission de rue vient s'inscrire dans les rides d'un travail
abandonné par le politique, se reposant sur le secteur associatif et militant. Nous nous situons ainsi
aux confluences étymologiques du creux, ruga, la rue, la ride, d'un visage courroucé et sévère, le
creux marquant aussi l'espace entre deux bords. Ici s'établit une première tache sur laquelle nous
nous portons : du bordage, de l'étayage, auprès d'une population délaissée et fragilisée, sur les dérives
de nos artères urbaines, quand celle-ci ose encore s'afficher honteusement, dont les sujets sont
en proie à la violence, autant sociale que singulière, psychique, pulsionnelle, inconsciente. De
déliaisons psychiques en déliaisons sociales, de l'exclusion à l'auto-exclusion et l'asphaltisation du
corps dans le béton, notre clinique a pour principal objet d'ouvrir un lieu d'adresse à un Autre
permettant un amarrage du Sujet dans un discours et une relation, un espace de parole qui pourra
permettre de surcroît de déplier une histoire, un vécu traumatique et des événements de vie ayant
abouti à des processus mortifères. Comme l'explique Michèle Benhaïm dans son dernier livre Les
passions vides : « Notre travail clinique n'est pas mesurable, car combien coûte un sourire ? Ce
travail est une nécessité, une obligation, une exigence, car le vide est contagieux. Faisons le pari
qu'il existe des processus de création au sein même de l'effondrement subjectif, que ces mouvements
seront propices à lier les égarements, et que des forces d'ancrage ouvriront un horizon là où il nous
apparaît, pour l'instant, comme obstrué. ». Cela résume ce qui de façon continue nous porte, où
nous misons que dans cette errance physique et psychique rencontrée dans la rue, un amarrage est
possible, une inscription dans un champ social et discursif. Ces hommes et ces femmes qui se vivent
10
comme n'ayant pas de place dans le monde en sont exclus, ils sont ceux qu'on aimerait ne pas voir,
ne pas entendre, et qui pourtant, par leur présence, viennent nous rappeler les effets de destruction
et de rupture de liens de notre société. Notre tâche vise à restaurer ces liens rompus par la misère et
la violence. Notre clinique est alors de permettre que ces sujets s'autorisent à retrouver ou parfois
même trouver une place dans le monde, dans une idéologie de plaidoyer pour l’hétérogène et une
anti-conformité au modèle social pour ceux ayant fait le choix de la marginalité.
C'est en voyant dans le petit autre l'humanité que l'on peut redécouvrir la sienne propre, dans une
fraternité autour de la souffrance humaine selon le mot de Pierre Delion, et sa potentialité
d'inscription dans le champ social.
Dans cette clinique que nous appellerons la clinique de l’humanité, notre posture est donc
d'accepter l'inconfort et l'intranquillité, que l’on peut voir comme la résultante des projections des
personnes sans abri, des motions qu’elles nous renvoient et prennent dès lors une grande place dans
notre imaginaire, dans nos fantasmes, souvent morbides et angoissants, qui peut tendre à nous
aliéner dans la relation établie.
L'inconfort et l’intranquillité aussi d’une position de maraudeur qui peine à se définir. Face à
une réalité qui confine au réel, notre travail est d’éviter les refuges de nos positions défensives de
« psy » qui refuserait toute incursion dans la réalité et ne voudrait rien voir des besoins d’étayage
sur l’objet, de celles de travailleurs sociaux qui tendraient à boucher le trou d'une demande que nous
ne pourrions plus entendre au-delà de sa matérialité, de celles de médecins qui ne verraient plus le
sujet mais le seul corps échoué et souffrant.
Notre inconfort et notre intranquillité, c’est donc aussi notre renoncement.
Renoncement à être des sauveurs, à venir soulager la souffrance immédiate ou satisfaire la demande
apparente, à donner à la personne ce dont elle manquerait et dont l’absence l’éloignerait de notre
monde.
Renoncement à être des « psy » (ce que nous ne sommes jamais pour eux car ne nous présentant pas
ainsi), à travailler avec eux sur leur transfert. C’est plutôt sur notre transfert qu’il nous faut travailler
et pour que peut-être, dans un effet collatéral, puisse émerger un discours du sujet dans la régularité
des rencontres.
Renoncement donc à notre position de toute-puissance.
Alors, « Qu’est-ce qu’on fout là ? » comme le dit Oury… C’est cette question que nous
remettons finalement inlassablement sur le métier pour tenter de tisser ces liens, qui ne cesse de
nous travailler en chaque instant de la rencontre.
Nous devons alors, entre maraudeurs, nous porter mutuellement, afin de ne pas tomber dans
ce qu'il en serait d'une fascination, d'une jouissance inconsciente. Nous devons dans cette rencontre
11
faire montre d'un étayage respectif entre nous, afin de permettre un décalage de possibles postures
défensives face à ces situations de misère, miseria, malheur, détresse, qui inspire la pitié, en-deçà de
la pauvreté, pauper, produire peu, mais qui peut encore laisser des espaces de création possible.
Dans ce portage mutuel, chaque membre prend alors une fonction thérapeutique spécifique pour les
autres bénévoles, et les sujets de la rue, dans une constellation transférentielle étayante, plurielle,
diffractée. Nous pouvons ainsi faire collectivement face aux effets de violence qui nous sont
renvoyés, dans une posture d'accueil et de maintien d'une dignité humaine. Quand la mort peut
rôder au coin de l'hypothermie hivernale, de la déshydratation estivale, de la violence physique, ou
de l'abandon de soi, hors de la communauté des hommes, l'homme ne serait plus qu'un coquillage
vide, un musel man.
La mission sans abri existe de puis 13 ans. Au départ, elle offrait des consultations aux
personnes sans abri ; aujourd’hui elle propose ce travail d’aller vers et de création de liens. Cette
mission prend tout son sens dans les articulations qu’elle propose avec les partenaires du réseau.
Nous sommes des passeurs, ces liens que nous construisons avec les personnes, nous tentons de les
reproduire avec les acteurs qui interviennent en amont ou en aval de notre action dans les prises en
charge sanitaires et sociales. Ainsi, nous tentons de déployer un maillage solidaire, rigoureux et
attentif autour de la personne sans abri.
Face à une population sans abri de plus en plus nombreuse, protéiforme, confrontée à des
difficultés de plus en plus grande devant la raréfaction des réponses institutionnelles ou associatives
faute de financement, face aux phénomènes migratoires qui ne font que commencer, nous vivons la
maraude comme un acte politique. C’est pour nous un engagement citoyen et concret, fait au
quotidien d’interrogations, de curiosité, de passion plus que de compassion. La frontière entre le
SDF et soi-même est étroite : qui va soigner qui en vérité ? » « Qui sauve un homme, sauve
l'humanité » dit le Talmud.
Cet acte politique doit s’ouvrir. S’ouvrir aux autres citoyens, s’ouvrir aux réseaux de
proximité. C’est dans ce sens que nous souhaitons dans les années à venir faire évoluer notre
action : associer de plus en plus largement les citoyens, les partenaires, et les acteurs locaux du
territoire, en essayant de transmettre quelque chose de la complexité de cette clinique de l’humanité.
BAIDI Christophe – DIMECH Amélie – DOUENEL Corinne – NEGREL Raymond
12
Mission Sans-Abri de Médecins du Monde
Texte présenté aux XXXIè Journées de Psychothérapie Institutionnelle
12-13 Octobre 2017
Le texte que nous vous présentons aujourd'hui a été élaboré, pensé et rédigé en équipe afin
de vous témoigner de notre travail auprès des personnes sans abri ainsi qu'au sein de notre collectif.
Notre démarche est celle d'aller-vers les personnes de la rue, au rythme de trois ou quatre
maraudes par semaine, de jour ou en soirée, à pied, en civil, régulièrement dans le même périmètre
et toujours en binôme car il est essentiel de ne pas s’engager seul dans la rue. Parce qu’« un homme
seul n'est pas un homme » disait Lacan, nous visons à créer du lien, des liens, afin d'amarrer le sujet
en errance, relever et mettre en mouvement le sujet coulé dans l’asphalte du trottoir. Créer un lien
pour lui permettre d’exister et de s’inscrire dans des soins somatiques ou des prises en charge
sociales. Si le sens de notre action prend racines dans la rue, celle-ci acquiert toute sa signification
au cours et grâce aux réunions hebdomadaires d’échanges et de travail, lieu de récits certes, mais
surtout invitation à la parole avec nos inquiétudes, nos doutes et nos interrogations. Pour nous, une
remise en cause permanente de nos certitudes est plus qu'obligatoire, nous ne pouvons pas y
échapper. Portés par les valeurs de Médecins du Monde, « Soigner et témoigner », toute notre action
s’accompagne d’une attention à l’autre, sans-abri ou Maraudeur, car la précarité n’est pas réservée
aux gens de la rue : elle traverse également le vécu des habitants de la ville, des institutions, des
travailleurs sociaux avec lesquels se tissent des liens invisibles.
La préparation de cette présentation a été l'occasion de nombreux échanges. Écrire pour
s'exposer dans sa parole est toujours une prise de risque, produit des effets inattendus et souvent
féconds ; ici aussi, la mise au travail est venue révéler la tension dialectique qui s’exerce en nous et
entre nous dans la réalisation de « notre mission ».
« Psychopathologie des soins quotidiens, une boussole pour soignant désorienté »… De
prime abord, ce sujet était fait pour nous car parler de désorientation et de boussole à des
maraudeurs, forcément, ça matche ! Les « soins quotidiens » cela semblait bien être notre « job » …
car ce que nous prétendons, c’est prendre soin de la personne sans abri dans une présence aussi
quotidienne que possible. Mais peut-on qualifier notre action de « soins quotidiens » alors que nous
faisons irruption dans la vie des SDF ? Et sommes-nous des soignants ? Psychopathologie des soins
quotidiens, qu’est-ce que cela veut dire ? Avec sa psychopathologie de la vie quotidienne, Freud
révèle l’inconscient qui nous gouverne. Avec cette « psychopathologie des soins quotidiens »,
sommes-nous invités par l’AMPI à nous intéresser à cet inconscient qui se dévoile dans nos
1
errements ? Et de quel inconscient parlons-nous ? Celui des personnes vers lesquelles nous allons
ou le nôtre ? Ainsi, nous avons donc recherché nos impasses, nos dissonances, nos refuges pour
tenter d’entendre quelque chose…
Tel un autre maternel suffisamment bon, notre démarche est d’abord celle d'aller à la
rencontre de cet autre, de ces autres en rupture avec le social, assis sur le macadam une main
tendue, une casquette devant eux. C'est ainsi que nous décidons, au gré de nos pérégrinations, de
nous arrêter sur les bords du chemin et d'adresser un regard, une salutation, au creux du quotidien
de ces personnes exclues, au moment de la manche, du repos, du déjeuner, chez eux, sur ce bord de
trottoir ainsi approprié le temps d'une halte plus ou moins éphémère.
Comment s'adresser à eux et comment être accueillant ? Dans ce mouvement d’aller vers,
nous nous rendons chez eux, nous les interpellons, notre présence, nos mots s’imposent à eux sans
qu’ils n’en aient rien demandé. En retour, ils restent figés, ou nous regardent passivement nous
rapprocher, ils nous serrent la main, nous tendent leur chapeau, nous questionnent : « Qu'est ce que
vous voulez ? »... C’est vrai ça, « qu’est-ce que nous voulons » ?
Pourquoi s’adresse-t-on à un tel plutôt qu’à tel autre ? Qu’est-ce que nous disons à notre
corps défendant en désignant telle ou telle personne comme une personne sans abri ? Chacun fait
selon son inspiration, ses peurs, ses fantasmes, les uns évitent les groupes, les autres les personnes
très alcoolisées, les derniers ceux qui crient … Ce sont nos propres mouvements psychiques qui
nous font nous déplacer vers les uns plutôt que vers les autres.
Aller vers, c’est faire précéder l’offre à la demande. Cela commence toujours par un regard,
un mouvement, un geste et quelques mots :
« Bonjour, comment allez-vous ?»
« Je m'appelle Raymond, je fais partie de MDM, tout va bien ? Vous avez besoin de quelque
chose ? »
« Bonjour, je m'appelle Corinne, est-ce que je peux parler avec vous ? Je ne vous dérange
pas ? »
« Bonjour, est-ce que je peux m'asseoir pour discuter avec vous ? »
« Bonjour, moi c'est Marine et vous, c'est comment ? »
Si nous nous présentons comme une équipe de MDM, ce n’est que très rarement que nous
précisons notre profession, en particulier ceux d’entre nous qui pourraient faire partie des
« soignants », de peur peut-être que cet énoncé ne puisse venir entraver la possibilité de la
rencontre, nous réduisant à n'être les uns et les autres que des soignants et des soignés.
« Bonjour, comment allez-vous ?». Cette phrase que dit-elle de nous ? N’est-ce pas une
étrange façon d’aller vers : de quelle place demandons-nous à l'un de nos semblables comment il va
2
avant même de le connaître ? Apparemment « si naturelle » ou bienveillante, cette phrase ne seraitelle
pas violente ou intrusive ? Elle semble inscrire d'emblée cette personne que nous souhaitons
rencontrer dans une différence ; elle énonce quasi-explicitement nos fantasmes de réparation, elle
véhicule nos représentations de la précarité, nous réduisant le sujet au « sans abrisme ».
« Je m'appelle Raymond, je fais partie de MDM, tout va bien ? vous avez besoin de quelque
chose ? ». L'accroche implique ici une demande matérielle, elle nous protège, légitime notre venue,
correspond à nos projections… Mais ne prend-on pas le risque qu’elle ouvre et ferme la rencontre
dans le même temps ? Sommes-nous vraiment là pour ça ? Pourquoi venons-nous interroger leur
besoin quand le plus souvent nous ne pouvons pas y répondre ?
On le voit, ce premier contact est difficile pour eux peut-être, pour nous certainement. Il n’est pas la
rencontre mais il n’a de sens que s’il peut être inaugural à celle-ci.
Avec pour références la psychothérapie institutionnelle et la psychanalyse, nous voulons
déployer une clinique de l’accueil, d’humanisation du Sujet, une clinique qui permette une mise en
élaboration progressive d'une parole, conduisant à une restauration du sujet et de son espace intime.
Tout en défendant la logique médico-sociale de Médecins du Monde (la survie de chacun et l’accès
aux soins pour tous restent pour nous une préoccupation permanente), nous souhaitons nous situer
dans le champ de l'intime, au plus près du sujet pris dans une double aliénation psychique et sociale.
Comment déployer cette clinique de la présence dans la rue ? Qu’est-ce que la présence dans un
espace qui n’existe pas, en tant qu’il est sans limite et mouvant ? Quel espace notre présence
pourrait-elle ainsi venir habiter ?
Confrontés nous même à l’errance dans nos maraudes, notre premier défi est de rendre notre
présence ni évanescente ni envahissante. Issu du latin sionare, le « soin » signifie « s'occuper de »,
il est « l'attention que l'on porte à faire quelque chose avec propreté, à entretenir quelque chose. » Il
suppose quelque chose de la continuité, de la quotidienneté. C’est alors cette répétition dans le
temps qui est l’objet de notre attention. La régularité de nos maraudes et nos rituels langagiers ou
gestuels viennent scander le temps, marquer des limites à l’espace informe et crée les possibilités de
la rencontre. Ils nous rendent présents. C’est cela notre premier engagement et c’est le plus
exigeant.
Car cette continuité et cette position d’accueil sont difficiles à tenir.
Nous croisons un jour Emile, avec qui nous avons développé quelques liens au fil de nos maraudes,
parlant avec lui de son histoire comme de l'Histoire de la France, de musique et de littérature, de
chiens … Allant vers lui, l'un de nous demande une première fois « Comment allez vous ? »,
« bien » répond-il. Nous sommes sur une artère passante, il y a beaucoup de bruit, nous nous
asseyons par terre près de lui. Distraits par cette installation, nous n’entendons pas sa réponse et ré-
3
itérons la question « Comment allez vous ? ». Emile se lève brusquement, cherchant à échapper à
notre présence, il s'énerve, crie : « Mais qu'est ce que vous me voulez à la fin je n'ai pas besoin de
tuteur moi, je n'ai pas besoin d'un tuteur ! ». Nous restons figés, désarçonnés, décontenancés,
plongés dans notre incompréhension. Nous tentons de le calmer mais rien n’y fait, il est debout,
s'agite, très impressionnant. Après un échange de regard, nous prenons la décision de partir face à
son refus de nous parler et le saluons timidement.
Que s’est-il passé pour Emile dans cette rencontre ? Quelle absence, quelle intrusion serions-nous
venus introduire ou incarner ?
Dans un après coup, une fois l'émotion de cette altercation atténuée, nous réalisons que, pour la
première fois, avant d’aller vers lui, nous nous étions adressés à un autre homme non loin de lui.
Cet événement, pourtant anodin, serait-il venu souligner notre appartenance à Médecins du Monde
et placer Emile comme un SDF parmi tant d'autres ? Comme si, tout à coup, nous n'étions plus sur
un pied d'égalité, nous venions représenter un grand Autre social trop persécuteur, un « tuteur ».
Dans « tuteur » il y a presque tueur… Nous sommes-nous montrés défaillant à ne pas l’entendre,
trop pris par notre propre installation ? Avons-nous fait intrusion chez lui ? Nous n’avions pas
demandé si nous pouvions entrer…
Ainsi, entre une absence d'Autre social fuyant ou un vécu de sa trop grande présence
touchant à la persécution, nous nous situons sur un fil de funambule, tentant de ne pas vaciller entre
deux écueils. Notre engagement dans la continuité est une nécessité lorsque nous faisons le pari
d'un possible, d'une création dans et par le lien. Pour nous qui n’apportons rien, cette présence à
l’Autre n’est faite que de cette continuité. Elle est notre clinique du quotidien, dans la répétition
régulière de nos mots et de nos mouvements venant différencier les espaces pour permettre de les
habiter. Répétition des soins de cet autre souvent maternel, renforçant le sentiment de continuité
d’existence et débouchant sur la construction d’un récit, d’une histoire, commune qui nous lie les
uns aux autres.
Pour les sujets souffrant de troubles psychiatriques, la rencontre avec l'Autre dans la rue,
peut avoir pour conséquence une déglaciation selon les termes de Salomon Resnik, une réanimation
psychique du sujet, où nous devons faire attention aux mouvements de retour de refoulés, à la
résurgence d'événements traumatiques, de mouvements d'agressivité, dans ces moments
particulièrement intenses. Entre défaut ou excès de circulation, telles deux faces d'une même pièce,
« l'asphaltisation » comme l’errance viennent anesthésier le sujet dans la rue, dire son impossible
inscription dans le monde et le « tenir » à distance. L'émergence d'un discours adressé à un Autre
pourrait entraîner une hémorragie psychique ou réactiver une fuite, face à l'incapacité d'inscription
en un lieu, en une temporalité fixe et faisant sens pour le sujet. Alors que d'autres patients peuvent
4
se mouvoir physiquement comme psychiquement entre différents lieux, dans une possibilité de
circulation entre les espaces externes et intimes, les plus fragiles dans la rue n’ont souvent pour seul
lieu de référence que l'asphalte même, où le bord du trottoir peut venir marquer un bord de
précipice psychique à la chute sans fond.
L’histoire de la mission est celle de ces moments heureux où les personnes avec lesquelles se
sont tissées des liens ont pu trouver un lieu où s’inscrire, vivre ; mais elle est aussi celle de moments
douloureux où la décompensation somatique ou psychique nous rappelle parfois dramatiquement
que ce qui nous paraît urgent ne l’est pas toujours, et que le temps de l’action doit respecter le temps
psychique du sujet. Nous pourrions ainsi vous raconter l’histoire de Jean Claude ou celle de
Georges qui sont décédés quelques mois suite à leur mise à l’abri.
Survivre est parfois plus facile que vivre.
L’équilibre est fragile, la continuité délicate à maintenir, mise à mal par le Réel. « L’absurde
naît de cette confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable du monde », nous dit
Albert Camus dans Le mythe de Sisyphe (1942). Cette clinique de l'extrême, de l’absurde nous
plonge inlassablement dans un non sens.
Travailler en équipe, marauder en binôme ainsi que penser et développer notre boîte à outils
deviennent alors sans cesse nécessaires : sans cela, comment penser cet absurde, comment faire face
à cette violence ? Sans réflexion, il y a ou trop ou pas assez de retour, de continuité, prenant le
risque de faire vaciller les fragiles constructions subjectives bâties sur les bords de l’errance ou de
l’asphaltisation.
La question du don revient massivement dans nos réflexions. Elle est omniprésente par la
misère qui s’offre à nos yeux ou par la demande plus ou moins explicite des personnes que nous
rencontrons.
Cette dernière nous ramène une nouvelle fois à l'absurde et à l’inconfort de notre démarche. Faut-il
ou non donner ? Si nous donnons un jour, que fera-t-on le jour suivant ? Si nous ne donnons pas, ne
faillons-nous pas à être cet être secourable ?
Nous en parlons sans cesse en réunion :
« Quand je rencontre quelqu'un qui a vraiment faim comme ce soir, je fais quoi : je parle ou je
lui donne un sandwich ? »
« Moi je les nourris d'abord pour qu'ils parlent la semaine d'après. »
J’ai rencontré Jean, je l’ai invité à venir à la Sardinade. Il m’a rétorqué « Tu vas pas m'acheter
avec des sardines. »
5
« On rencontre un slovaque qui nous demande sans arrêt des baskets du 47, mais c'est pas
évident de trouver des baskets du 47 ! On a fait tous les magasins de sport mais ils s'arrêtaient
au 45, on était désespéré. Finalement, le mec a disparu une fois qu'on les avait trouvés,
heureusement qu'on les a pas acheté ! »
Moi l’autre jour j’ai demandé « Qu'est ce qui pourrait vous faire plaisir ? »… et du coup il m’a
répondu : « Vous croyez qu'on a beaucoup de plaisir dans la rue ? »
« Moi j'avais à manger quand j’ai maraudé hier et donc je leur ai donné… On dira que c'est
parce que je suis nouvelle, que je savais pas qu’on ne donnait pas. »
Nous nous sommes réunis en séminaire l’année passée pour tenter cette question.
A cette occasion, sous avons redit le fondement de notre mission : s'intéresser avant tout à la
relation et ce, sans céder sur notre désir qui risquerait de nous plonger dans du pur humanitaire.
Pour cela, notre travail est d’accepter la frustration de ne pas aider matériellement, de se confronter
à la castration, de se dégager d'une position où nous voudrions faire pour l'autre, à sa place. Nous
sommes là sans rien, et dans ce « rien » se cristallise toute notre position soignante, car, ne venant
rien boucher de la relation avec un objet, nous laissons plutôt dérouler quelque chose du sujet et de
sa demande. Ce rien ouvre le don de confiance et la relation transférentielle. Ce que nous offrons,
c’est nous-même, notre personne propre comme lieu d'adresse Autre où nous accueillons une
singularité malmenée par les errements de l'exil ou de la fuite, les problématiques toxicomanes,
psychotiques ou encore les questions existentielles propres à chaque sujet.
Pour autant, nous ne pouvons laisser quelqu’un mourir de froid dans la rue, ou sans eau en
plein été. Et il n’y a pas à se questionner : ils ont froid, on donne le duvet, ils ont soif, on donne de
l’eau. Toute la difficulté est que cet objet vital ne devienne pas alors tout l’enjeu de la relation : il
est un à-côté sur lequel nous n'avons pas à nous arrêter. Ainsi, nous sommes partis contents de notre
séminaire avec un nouvel outil en poche « L’objet n’est pas un enjeu » !
Soit « l'objet n'est pas un enjeu », mais que devons-nous faire lorsqu'il semble le devenir ?
Nous rencontrons régulièrement un groupe d'hommes. Parmi eux, des personnes qui ont un abri la
nuit mais errent toute la journée durant, d’autres qui sont dans des squats ou à la rue. Plusieurs
d’entre eux ont des soucis de santé importants. Ils sont pour certains pris en charge par des équipes
partenaires sociales ou sanitaires. En lien avec eux, nous tentons de nous rendre présents à eux pour
accompagner à terme les plus fragiles vers les soins. Souvent, quand nous allons les voir, ils sont
alcoolisés et continuent à s'alcooliser devant nous tout en étant toujours accueillants.
Une fois, ils nous demandent à manger. Parce que nous sentons que certains d’entre eux sont en
grande difficulté et parce que « l’objet n’est pas un enjeu » et que, on leur achète de quoi se faire
6
des sandwichs. Une fois, deux fois, trois fois… Chaque fois qu'un binôme de maraudeurs passe les
voir, ils sont par un transfert massif et une demande matérielle qui prend de plus en plus de place.
Nous en parlons, y retournons, et cette fois, on les accompagne pour qu’ils achètent eux-mêmes.
Lors d'une maraude où ils ne sont que trois, ils disent avoir froid ; nous nous engageons à leur
ramener des duvets, tel jour vers telle heure. Au moment prévu, nous arrivons avec nos trois
duvets : ils sont cinq ! Embêtés, nous tentons de tenir quelque chose de notre parole ou de se
protéger derrière l'énonciation d'une règle : « Les duvets étaient pour telle et telle personne, si vous
en voulez on vous en ramène la prochaine fois ». L’agitation, le ton montent… Nous nous sentons
pris dans des enjeux groupaux qui nous échappent. Nous laissons les 3 duvets, très soucieux des
effets de ce « don insuffisant », un instant angoissés à l'idée qu'ils puissent se battre, tentant de se
rassurer l'instant d'après en se disant qu'ils en ont régulièrement et « de toute façon, ils les
revendent ». Nous nous défendons comme nous pouvons, face à nos fantasmes, et cette réalité en
étroite collusion avec un Réel inquiétant.
Quelques jours plus tard, une autre équipe, une autre maraude. Ils sont toujours en groupe.
Le dialogue s’engage mais nous sommes préoccupés par Rachid qui est très affaibli. Il ne veut pas
qu’on appelle les secours ni aller consulter. Il tremble. Très hésitants, nous finissons par prendre
congés d’eux. Puis nous revenons sur nos pas, inquiets, pour proposer un café ou un chocolat chaud.
Amine nous agresse : « Et vous croyez qu’on a besoin de vous pour cela ? »... et « D’ailleurs à quoi
vous servez ? ». D’autres membres du groupe viennent nous protéger « Tu sais bien qu’il n’apporte
pas à manger, MDM ! ». Rachid nous retient par le regard mais ne s’exprime pas. Amine se lève,
l’excitation croît. Les autres calment le jeu « Vous pouvez y aller, ne vous inquiétez pas ». Nous
repartons.
Dans la rencontre avec ce groupe, plusieurs phénomènes sont venus se télescoper : le
groupe, la présence parmi ses membres de Rachid, très affaibli, épileptique et grand alcoolique,
objet de notre souci, le froid,… Et l’effet de notre séminaire de réflexion venu nous mettre à l’abri
de notre inconfort par cette belle formule que « l’objet n’est pas l’enjeu ». Lors de nos reprises en
réunion hebdomadaire, dans un travail de constellation transférentielle, nous avons pu toucher du
doigt ce qui sans doute s’était joué à notre insu : nous avons découvert que dans ce groupe, Amine
avait une place de leader, de protecteur… En apportant ces duvets, en prenant soin de Rachid, nous
étions venus déstabiliser le fonctionnement du groupe et peut-être destitué Amine dans la place qu’il
prenait en son sein...
Nous sommes en permanence aux prises de ce conflit : d’un côté agir face à la maladie et à
la misère et d’un autre désirer respecter le temps psychique du sujet.
Si l’objet n’est pas en enjeu, la place de l’objet dans les relations que nous tissons avec les
personnes de la rue ne serait-elle pas tout l’enjeu de notre propre travail psychique ? Ne serait-ce
7
pas dans l’analyse « psychopathologique de nos dons » que les soignants désorientés que nous
sommes pourraient trouver leur boussole ?
Nous rencontrons un couple, Anne et Vincent. Anne est enceinte de sept mois. Cette situation
est pour nous tout de suite une urgence, il faut que nous puissions être là si besoin est au moment
de l’accouchement. Trois maraudeurs vont à leur rencontre plus régulièrement et leur donnent
un numéro de téléphone. Vincent, toxicomane, n’est pas suivi ; Anne dit être « clean », elle est suivie
par un CSAPA. A chacune de nos rencontres, ils nous rassurent tout en nous demandant implicitement
quelque chose, jamais directement. De l’argent surtout, pour manger, pour une nuit d’hôtel,
pour préparer la venue du bébé… On hésite à donner, puis on donne, on se réunit, on en parle, puis
on hésite…
- Pourquoi de l’argent ? Est-ce pour acheter de la drogue ?
- Ils ne peuvent pas rester à la rue, cet enfant ne peut pas naître dans le caniveau, nous devons
leur payer l’hôtel jusqu’à l’accouchement…
Tout nous fige. Cet enfant qui peut naître sur le trottoir c’est l’image de cette détresse primordiale
qui vient nous cueillir. Nous sommes comme fascinés, pris par cet hilflos mortifère, par
cette jouissance inconsciente face au spectacle voyeuriste d'une réalité de la misère confinant au
Réel. Nous ajoutons des réunions "exceptionnelles" au mois d'août, on essaie d'élaborer autour de
cette demande toujours implicite mais omniprésente. Nous relevons toutes les incohérences de leur
discours, nous tentons de comprendre leur demande. Nous les connaissons peu finalement, nous
n’avons que très peu d'éléments de leur histoire. Nos fantasmes viennent recouvrir la réalité… On
imagine, se répète, se questionne, puis... On redescend sur terre... Et de nouveau on imagine, se répète,
se questionne. Bref, nous tournons en rond avec l'envie et le besoin pour eux comme pour
nous de se décaler de ce temps chronologique mais dans une impossibilité. Ce bébé va arriver, elle
va accoucher et le risque qu'elle accouche dans la rue est grand. C'est une urgence mais le temps logique
de l'inconscient ne prend, lui, pas en compte cette urgence.
Le temps passe... Elle accouche, tout se passe bien même si c’est moins une. Les analyses
révèlent de nombreux toxiques dans le sang de la mère. S’ensuit le sevrage du bébé. Le père arrive à
s'engager dans une prise en charge. Ils sont suivis par la maternité puis par trois associations différentes
au moins. Nous travaillons avec les autres acteurs ; ils tentent de répondre à leur demande,
cèdent puis lâchent : la maternité les fait sortir, une association leur donne une somme d’argent pour
une mise à l’abri temporaire avec l’enfant puis disparaît... Semble ainsi se répéter un mouvement où
l’objet n’arrive jamais à satisfaire la demande mais où il vient rompre les liens. Pendant ce temps là,
nous tentons de maintenir un lien. Ils ne nous appellent que pour demander. Nous avions donné un
peu d’argent pour quelques nuits d’hôtel avant l’accouchement… Cet argent n’a sans doute pas ser-
8
vi à cela… Nous cédons à nouveau sur les couches et sur la poussette, « parce que c’est le soin du
bébé et que cela fait partie de la mission de MDM »… en fait la PMI fournit déjà tout cela… Nous
voilà nous aussi pris dans leur propre répétition… Mais nous le lâchons pas, nous tentons de rester
là pour eux, au-delà des demandes… Nous les écoutons, nous parlons de leur demande, nous ne disons
non, nous tentons de les accompagner vers des acteurs qui pourraient les aider… Et ce faisant,
ils continuent à nous rappeler, un lien semble s’être créé. Et demain ? Nous n’en savons rien, nous
tentons de rester connecté sans imposer notre présence.
De quel objet parlons-nous ?
Il y a l’objet qui répond aux besoins de première nécessité sans lequel il n’y a pas de vie. La
mère nourrit l’enfant de lait et de mots. Dans le dénuement extrême, et c’est le cas pour tous ces
corps échoués sur l’asphalte, rigidifiés par le froid, l’ivresse ou la chaleur, il ne peut y avoir d'autre
maternel sans ses soins de première nécessité.
Il y a l’objet qui est le support à la découverte de l’environnement, l’objet sur lequel vient
s’étayer la relation, l’objet qui permet de parler. Pendant plusieurs années, un membre de la mission
a apporté à un monsieur psychotique qui vivait dans la rue chaque semaine, une canette de coca et
une orange. De canette en orange s’est tissé un lien qui a permis après plusieurs années de mettre à
l’abri ce monsieur. Et aujourd’hui encore, on lui apporte cette canette et cette orange hebdomadaire.
Ces objets ont ouvert la possibilité d’un autre. Le don invite au contre-don, selon Marcel Mauss, il
est au fondement de l’échange et de l’organisation sociale.
Et puis il y a l’objet qui vient boucher la demande, parce qu’il la précède, la camoufle. Cet
objet qui nous rend sourd en nous enfermant dans notre satisfaction narcissique.
Citons une personne anciennement SDF « Donner, je trouve que ça instaure une hiérarchie. On
n’est pas sur un pied d’égalité, cela nous met en dette. J’ai beaucoup de reconnaissance vis-à-vis
de ce que l’on m’a donné quand j’étais SDF, mais revenir à la vraie vie, ce n’est pas être redevable
tout le temps. Quand on reprend sa place d’humain, on doit pouvoir refuser cette dette ».
La place de l’objet est chaque fois à repenser selon les situations, avant et sur le moment mais
surtout dans l’après-coup car ce qui compte, ce n’est pas tant ce que nous faisons ou donnons dans
la rue (faire et donner c’est aussi prendre le risque de la vie), ce qui importe c’est la pensée qui suit
nos actes. Car c’est dans l’après-coup qu’un acte peut devenir passage à l’acte.
9
En conclusion : une clinique de l’humanité
« Tous les jours, pendant six mois, un ouvrier civil italien [Lorenzo] m'apporta un morceau de pain
et le fond de sa gamelle de soupe ; il me donna un de ses chandails rapiécés et écrivit pour moi une
carte postale qu'il envoya en Italie et dont il me fit parvenir la réponse. Il ne demanda rien et
n'accepta rien en échange, parce qu'il était bon et simple, et ne pensait pas que faire le bien dût
rapporter quelque chose. […] Je crois que c'est justement à Lorenzo que je dois d'être encore vivant
aujourd'hui, non pas tant pour son aide matérielle que pour m'avoir constamment rappelé, par sa
présence, par sa façon si simple et facile d'être bon, qu'il existait encore, en dehors du nôtre, un
monde juste, des choses et des êtres encore purs et intègres que ni la corruption ni la barbarie
n'avaient contaminés, qui étaient demeurés étrangers à la haine et à la peur ; quelque chose
d'indéfinissable, comme une lointaine possibilité de bonté, pour laquelle il valait la peine de se
conserver vivant. [...] C'est à Lorenzo que je dois de n'avoir pas oublié que moi aussi j'étais un
homme. » Primo Levi, Si c'est un homme, (1947), p.186-190.
A l'heure d'un lien social tarifé, marchandisé, contre-sens anthropologique, selon le mot de
l'économiste Frédéric Lordon, notre mission de rue vient s'inscrire dans les rides d'un travail
abandonné par le politique, se reposant sur le secteur associatif et militant. Nous nous situons ainsi
aux confluences étymologiques du creux, ruga, la rue, la ride, d'un visage courroucé et sévère, le
creux marquant aussi l'espace entre deux bords. Ici s'établit une première tache sur laquelle nous
nous portons : du bordage, de l'étayage, auprès d'une population délaissée et fragilisée, sur les dérives
de nos artères urbaines, quand celle-ci ose encore s'afficher honteusement, dont les sujets sont
en proie à la violence, autant sociale que singulière, psychique, pulsionnelle, inconsciente. De
déliaisons psychiques en déliaisons sociales, de l'exclusion à l'auto-exclusion et l'asphaltisation du
corps dans le béton, notre clinique a pour principal objet d'ouvrir un lieu d'adresse à un Autre
permettant un amarrage du Sujet dans un discours et une relation, un espace de parole qui pourra
permettre de surcroît de déplier une histoire, un vécu traumatique et des événements de vie ayant
abouti à des processus mortifères. Comme l'explique Michèle Benhaïm dans son dernier livre Les
passions vides : « Notre travail clinique n'est pas mesurable, car combien coûte un sourire ? Ce
travail est une nécessité, une obligation, une exigence, car le vide est contagieux. Faisons le pari
qu'il existe des processus de création au sein même de l'effondrement subjectif, que ces mouvements
seront propices à lier les égarements, et que des forces d'ancrage ouvriront un horizon là où il nous
apparaît, pour l'instant, comme obstrué. ». Cela résume ce qui de façon continue nous porte, où
nous misons que dans cette errance physique et psychique rencontrée dans la rue, un amarrage est
possible, une inscription dans un champ social et discursif. Ces hommes et ces femmes qui se vivent
10
comme n'ayant pas de place dans le monde en sont exclus, ils sont ceux qu'on aimerait ne pas voir,
ne pas entendre, et qui pourtant, par leur présence, viennent nous rappeler les effets de destruction
et de rupture de liens de notre société. Notre tâche vise à restaurer ces liens rompus par la misère et
la violence. Notre clinique est alors de permettre que ces sujets s'autorisent à retrouver ou parfois
même trouver une place dans le monde, dans une idéologie de plaidoyer pour l’hétérogène et une
anti-conformité au modèle social pour ceux ayant fait le choix de la marginalité.
C'est en voyant dans le petit autre l'humanité que l'on peut redécouvrir la sienne propre, dans une
fraternité autour de la souffrance humaine selon le mot de Pierre Delion, et sa potentialité
d'inscription dans le champ social.
Dans cette clinique que nous appellerons la clinique de l’humanité, notre posture est donc
d'accepter l'inconfort et l'intranquillité, que l’on peut voir comme la résultante des projections des
personnes sans abri, des motions qu’elles nous renvoient et prennent dès lors une grande place dans
notre imaginaire, dans nos fantasmes, souvent morbides et angoissants, qui peut tendre à nous
aliéner dans la relation établie.
L'inconfort et l’intranquillité aussi d’une position de maraudeur qui peine à se définir. Face à
une réalité qui confine au réel, notre travail est d’éviter les refuges de nos positions défensives de
« psy » qui refuserait toute incursion dans la réalité et ne voudrait rien voir des besoins d’étayage
sur l’objet, de celles de travailleurs sociaux qui tendraient à boucher le trou d'une demande que nous
ne pourrions plus entendre au-delà de sa matérialité, de celles de médecins qui ne verraient plus le
sujet mais le seul corps échoué et souffrant.
Notre inconfort et notre intranquillité, c’est donc aussi notre renoncement.
Renoncement à être des sauveurs, à venir soulager la souffrance immédiate ou satisfaire la demande
apparente, à donner à la personne ce dont elle manquerait et dont l’absence l’éloignerait de notre
monde.
Renoncement à être des « psy » (ce que nous ne sommes jamais pour eux car ne nous présentant pas
ainsi), à travailler avec eux sur leur transfert. C’est plutôt sur notre transfert qu’il nous faut travailler
et pour que peut-être, dans un effet collatéral, puisse émerger un discours du sujet dans la régularité
des rencontres.
Renoncement donc à notre position de toute-puissance.
Alors, « Qu’est-ce qu’on fout là ? » comme le dit Oury… C’est cette question que nous
remettons finalement inlassablement sur le métier pour tenter de tisser ces liens, qui ne cesse de
nous travailler en chaque instant de la rencontre.
Nous devons alors, entre maraudeurs, nous porter mutuellement, afin de ne pas tomber dans
ce qu'il en serait d'une fascination, d'une jouissance inconsciente. Nous devons dans cette rencontre
11
faire montre d'un étayage respectif entre nous, afin de permettre un décalage de possibles postures
défensives face à ces situations de misère, miseria, malheur, détresse, qui inspire la pitié, en-deçà de
la pauvreté, pauper, produire peu, mais qui peut encore laisser des espaces de création possible.
Dans ce portage mutuel, chaque membre prend alors une fonction thérapeutique spécifique pour les
autres bénévoles, et les sujets de la rue, dans une constellation transférentielle étayante, plurielle,
diffractée. Nous pouvons ainsi faire collectivement face aux effets de violence qui nous sont
renvoyés, dans une posture d'accueil et de maintien d'une dignité humaine. Quand la mort peut
rôder au coin de l'hypothermie hivernale, de la déshydratation estivale, de la violence physique, ou
de l'abandon de soi, hors de la communauté des hommes, l'homme ne serait plus qu'un coquillage
vide, un musel man.
La mission sans abri existe de puis 13 ans. Au départ, elle offrait des consultations aux
personnes sans abri ; aujourd’hui elle propose ce travail d’aller vers et de création de liens. Cette
mission prend tout son sens dans les articulations qu’elle propose avec les partenaires du réseau.
Nous sommes des passeurs, ces liens que nous construisons avec les personnes, nous tentons de les
reproduire avec les acteurs qui interviennent en amont ou en aval de notre action dans les prises en
charge sanitaires et sociales. Ainsi, nous tentons de déployer un maillage solidaire, rigoureux et
attentif autour de la personne sans abri.
Face à une population sans abri de plus en plus nombreuse, protéiforme, confrontée à des
difficultés de plus en plus grande devant la raréfaction des réponses institutionnelles ou associatives
faute de financement, face aux phénomènes migratoires qui ne font que commencer, nous vivons la
maraude comme un acte politique. C’est pour nous un engagement citoyen et concret, fait au
quotidien d’interrogations, de curiosité, de passion plus que de compassion. La frontière entre le
SDF et soi-même est étroite : qui va soigner qui en vérité ? » « Qui sauve un homme, sauve
l'humanité » dit le Talmud.
Cet acte politique doit s’ouvrir. S’ouvrir aux autres citoyens, s’ouvrir aux réseaux de
proximité. C’est dans ce sens que nous souhaitons dans les années à venir faire évoluer notre
action : associer de plus en plus largement les citoyens, les partenaires, et les acteurs locaux du
territoire, en essayant de transmettre quelque chose de la complexité de cette clinique de l’humanité.
BAIDI Christophe – DIMECH Amélie – DOUENEL Corinne – NEGREL Raymond
12
POLARS ET PSYCHIATRIE - ANTOINE VIADER 11/2017
POLARS ET PSYCHIATRIE
On peut se demander quels points communs existent entre la psychiatrie et les romans ou les films policiers. A mon avis il peut y en avoir plusieurs. Mais avant d'aborder ces points communs il faut sans doute dire quelques mots sur les origines de la littérature policière. On s'accorde habituellement pour désigner Edgar Allan Poe comme le fondateur de cette littérature avec des récits tels que « Le mystère Marie Roget », « Deux assassinats rue Morgue » et « La lettre volée ». Il ne faut pas oublier que Poe était aussi et surtout un poète. Cependant, dans un numéro d'août de cette année de « La Quinzaine littéraire » consacré à la littérature policière, Matthieu Letourneux, professeur de littérature à l'université a Paris- Nanterre, affirme que cette origine remonte à Eugène Sue avec « Les mystères de Paris » et à Ponson du Terrail avec « Les drames de Paris » et les aventures de Rocambole. Pour cet auteur comme pour d'autres auteurs dans cette revue il s'agit de dévoiler « la face obscure » de nos sociétés que révèlent les récits policiers au delà des énigmes ou des intrigues proprement policières et Véronique Bergen intitule son article ainsi : « Raymond Chandler : enquête sur la condition humaine ».
Nous aurons l'occasion d'y revenir.
* * *
Donc, il y l'intrigue ou l'énigme à élucider. Sans doute, un psychiatre n'est pas en principe un détective ou un policier et l'énigme en question n'a souvent rien à voir avec les mystères de la psychopathologie. Cependant, dans les deux cas il s'agit d'une recherche. Le détective cherche un suspect ou un coupable et le psychiatre tente d'aider le sujet de trouver sa propre vérité. Et ces recherches impliquent l'utilisation d'une logique.
Un deuxième point commun concerne l'interprétation.
Dans un roman policier le détective cherche à interpréter les signes ou les indices recueillis sur la scène du crime. C'est sans doute le cas pour l'un des plus célèbres détectives de roman, Sherlock Holmes de Conan Doyle.
Mais dans un autre contexte l'interprétation fait partie du travail du psychiatre et du psychanalyste ce que l'on retrouve entre autres dans l' « Interprétation des rêves » de Freud et cela fait partie du travail du thérapeute comme du patient.
D'autre part, on connaît aussi les interprétations pathologiques dans les délires d'interprétation.
Il y sur certains points une opposition entre traduction et interprétation. En dehors de l'aspect oral ou écrit, la traduction consiste à passer un texte d'une langue à une autre en tendant à conserver le même sens et la même valeur alors que l'interprétation consiste à donner à l'énoncé dans la même langue un autre sens.
Un autre point concerne la personnalité des criminels qui apparaissent dans ces romans ou dans ces films et dans celles de certains policiers ou détectives.
Je ne vais pas essayer d'analyser la psychopathologie de ces criminels psychopathes ou psychotiques qu'on retrouve dans ces œuvres policières. Je vais juste en citer quelques uns. Sans doute le plus connu et le plus impressionnant c'est le personnage de « Psychose » d'Alfred Hitchcock interprété par Anthony Perkins. On en trouve aussi dans d'autres films du même auteur comme « L'inconnu du Nord-Express » ou, de façon différente, dans « La maison du docteur Edwards » où l'auteur s'intéresse à la psychanalyse. Pour ne pas quitter tout de suite Hitchcock on peut citer certains de ses films pendant sa période anglaise comme « Une femme disparaît » ou « Les 39 marches » où il s'agit plutôt de films d'espionnage et où l'humour atténue largement la violence de certaines actions.
Lorsqu'il s'agit de ces personnages, criminels ou enquêteurs il faut les situer dans une certaine ambiance surtout quand l'auteur crée de son côté une ambiance ou une atmosphère.
L'existence ou la qualité d'une ambiance diffère selon les romans policiers comme dans la psychiatrie. On connaît l'importance de l'ambiance dans les lieux de soin et elle dépend souvent de la présence de certaines personnes, patients ou soignants. Dans les romans policiers l'ambiance est très différente suivant l'auteur. Ainsi, dans les romans dont le ressort principal est la solution de l'énigme ou l'intrigue l'ambiance a peu d'importance. C'est le cas le plus souvent des livres d'Agatha Christie, de ceux de Conan Doyle avec Sherlock Holmes et de ceux d'Ellery Queen entre autres. Je cite ce dernier qui avait pas mal de succès dans les années 1940 - 1960 parce que Jorge Borges lui même auteur de récits à énigme le cite à plusieurs reprises dans ses notes de lecture. Dans ce genre de livres les personnages restent des personnages souvent caricaturaux comme Hercule Poirot qui par contraste montre sa brillante intelligence dans ces intrigues souvent très bien agencées par l'auteur.
Par contre, il suffit de quelques lignes à Simenon pour créer une véritable ambiance où le commissaire Maigret prend l'épaisseur d'une personne vivante au delà de son personnage.
On peut peut être prendre l'exemple de Maigret pour aborder la question de la logique ou des logiques utilisées par les enquêteurs.
Maigret c'est un taiseux qui fume sa pipe comme s'il ruminait, donne des ordres à ses inspecteurs boit de la bière ou un grog quand il est enrhumé ou grippé. Lorsqu'il est grippé, lorsqu'il qu'il a de la fièvre, il transpire et on peut dire qu'il « sécrète » et finalement il livre le secret en question. Jules Maigret apparaît comme une personne car, contrairement aux créateurs de Sherlock Holmes ou d'Hercule Poirot, Simenon le décrit comme un homme du peuple, quelqu'un qui connaît ce qu'on appelle la « nature humaine » ou simplement les gens qu'il fréquente dans leur paysage commun. Sans doute il raisonne, il interprète les faits et les paroles lors des interrogatoires et il emploie la déduction, l'induction ou ses propres intuitions par associations d'idées comme tout chercheur.
Les autres enquêteurs que je viens d'évoquer ne se situent pas vraiment dans un paysage mais plutôt sur une scène. Ils se concentrent sur leurs raisonnements déductifs à partir des faits, des indices et des témoignages sans sortir de la scène de l'énigme elle même. C'est peut être différent même chez Agatha Christie quand il s'agit de Miss Marple. Celle-ci fait souvent allusion lors de ses enquêtes à la vie de son village où elle trouve des analogies avec l'intrigue qu'elle tente de résoudre. C'est aussi le cas de l'héroïne de Patricia Wentworth, Miss Silver dont ses collègues et admirateurs disent d'elle: « Elle connaît les gens ». En fait, Miss Silver, ancienne préceptrice devenue sur le tard détective privée, prend contact avec les gens du village où elle enquête en liant conversation avec les commerçants locaux ou en aidant une domestique à faire la vaisselle dans la maison où elle a été appelée. Certains se rappellent la cuisine des pavillons de notre hôpital psychiatrique où, tout en faisant cuire les biftecks les conversations allaient bon train.
Un autre point à propos des logiques utilisées. Je parlais de déduction, d'induction ou d'intuition. Sans être très au fait de la logique en général je me risque sur ce terrain à propos de ce que Charles Spencer Peirce et Michel Balat nomment l'abduction. J'ai pensé qu'on pourrait illustrer ce genre de raisonnement par les livres de Fred Vargas avec le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg. Celui-ci est entouré d'une équipe qu'on peut qualifier de rationnelle et cartésienne alors que lui même semble toujours à côté de la plaque. Ses pensées naviguent en dehors des sillons tracés. On pourrait dire en paraphrasant Victor Hugo que c'est quelqu'un qui pense à autre chose. Mais c'est en suivant les détours de ses pensées qu'il parvient à la vérité.
On dira peut être que nous sommes loin des préoccupations de la psychiatrie. Cependant ce que Jean Oury appelle la phénoménologie de la rencontre et la question du diagnostic correspond aussi à la recherche de la vérité dans ces romans.
Et les psychiatres utilisent aussi ces logiques auxquelles il faudrait ajouter la logique poétique que préconise Oury dans les relations avec les psychotiques ou la fonction poétique du langage dont parle François Tosquelles. À ce propos on pourrait évoquer le personnage de Fantômas de Marcel Allain et Pierre Souvestre et relire la « Complainte de Fantômas » de Robert Desnos.
Quand je parle de connaître les gens dans certains romans policiers je pense aussi que l'une des fonctions des équipes du Secteur Psychiatrique consistait précisément à connaître les gens. Non seulement les malades et leurs familles mais les habitants du quartier et surtout ceux qui ont une certaine influence comme les hommes politiques locaux, les policiers du commissariat, les prêtres, certains commerçants en particulier les patrons de bar.
Bien sûr on ne peut pas connaître de près tout le monde mais on peut s'attarder sur certains visages et écouter ce qui se dit surtout quand on a du mal à comprendre ce qui se passe. Ainsi, dans le dernier livre de Fred Vargas, « Quand sort la recluse », le commissaire Adamsberg note quelques mots échangés lors de plusieurs conversations, des mots et des noms qui le tracassent sans savoir pour quoi jusqu'au moment où il trouve ce pourquoi.
L'importance du regard on la retrouve dans « La lettre volée » d'Edgar Poe. On sait que Jacques Lacan a consacré l'un de ses Séminaires cette lettre volée et que Deleuze et Derrida l'ont commenté. Pour ma part je ne fais que résumer cette nouvelle de Poe. Dans cette histoire figurent d'abord le roi, la reine et le ministre. Se trouve sur une table une lettre compromettante pour la reine. Celle ci tente de la cacher mais le ministre la subtilise adroitement. Le roi ne voit rien et surtout il ne doit rien voir. Il y a donc dans cette scène des échanges de regards et des gestes surpris. Les policiers tentent de retrouver cette lettre en fouillant le cabinet et le domicile du ministre pendant son absence sans rien trouver. Car pour eux un objet comme cette lettre doit être enfermée quelque part et doit être hors de la vision extérieure. Mais les policiers ont beau sonder tous les meubles et tous les murs, planchers et plafonds la lettre reste introuvable jusqu'à ce que le préfet de police ait recours au Chevalier Dupin. Celui-ci après deux visites chez le ministre remet la lettre au préfet. En effet, la lettre en question, un peu salie et froissée se trouve en évidence au milieu d'autres lettres et cartes dans un porte cartes accroché au mur. On peut dire que « ça crève les yeux ». Et bien sûr si on a les yeux crevés on ne voit rien. Sauf si on se réfère à Œdipe qui lui, ne devient voyant qu'après qu'il se soit crevé les yeux.
Dans cette nouvelle de Poe il s'agit de dissimulation mais aussi de simulation dans la mesure où la lettre originale a été camouflée pour qu'elle ne ressemble pas à l'originale.. A ce sujet on pourrait se référer au livre de Roland Kuhn, « Phénoménologie des masques à travers le Rorcharch » avec la préface de Gaston Bachelard dans la traduction française. Il s'agit bien de dissimuler le visage grâce au masque mais aussi de simuler, de faire semblant d'avoir un autre visage ou une autre expression.
Il faut dire quelques mots des détectives sédentaires et de leurs auxiliaires. Contrairement à Sherlock Holmes et à Hercule Poirot grands voyageurs, certains détectives ne quittent guère leur domicile. C'est le cas de Néro Wolfe, le personnage de Rex Stout, dont l'embonpoint ne facilite pas ses mouvements et qui a horreur de se déplacer en voiture ou à pied. Il est vrai qu'il a un auxiliaire très mobile et efficace en la personne d'Archie Goodwin. Mais le plus sédentaire des détectives c'est sans doute Don Isidro Parodi le personnage créé par H. Bustos Domecq, c'est à dire par Adolfo Bioy Casares et Jorge Luis Borges qui ont utilisé ce pseudonyme pour écrire ensemble « Six problèmes pour Don Isidro Parodi. Donc, Don Isidro est sédentaire par force puisqu'il a été condamné à vingt ans de prison pour un crime qu'il n'a pas commis mais il s'accommode de sa situation et il reçoit divers visiteurs en proie à des difficultés qu'ils jugent insurmontables sans l'aide de l'ancien coiffeur installé dans sa cellule. Il s'agit, dans ces six épisodes, de gens, pour la plupart du genre masculin, et qui tiennent des discours plutôt labyrinthiques et qui ne manquent jamais de vanter leur intelligence, leur courage et leur franchise ou, au contraire d'afficher une humilité invraisemblable comme par exemple le petit diplomate chinois : « Mon misérable nom est Shu T'ung et j'occupe, à la risée de tous, le poste d'attaché culturel à l'ambassade de Chine, antre discrédité et malsain... ». Les auteurs s'amusent à placer des miroirs dans tous les coins pour fausser et inverser la logique des discours des divers personnages et Don Isidro ne se contente pas de piocher les bonnes pièces du puzzle mais il modifie la position des miroirs pour faire éclater la vérité.
Juste quelques mots pour les « auxiliaires » ou « seconds » qui apparaissent dans certains romans. Le plus connu de ces seconds c'est sans doute le Dr. Watson, ami fidèle de Holmes et qui s'attire inévitablement la réponse de son maître : « Élémentaire mon cher Watson ! ». Il y a aussi le capitaine Hastings, le second d'Hercule Poirot, détective amateur et sentimental dont la maladresse ne manque pas de donner quelques idées inattendues à Poirot.
Ici aussi on pourrait dire qu'on est loin de la psychiatrie mais nous avons aussi appris le métier auprès de gens plus expérimentés et savants que nous et qu'on peut parfois qualifier de maîtres et nous avons aussi reçu quelques répliques cinglantes.
J'ai parlé des détectives sédentaires mais on pourrait étendre cette notion aux situations où les détectives font autre chose que détecter et où les psychothérapeutes et les patients ne se trouvent pas ensemble dans une séance. Les détectives font ce qui leur plaît. L'un joue du violon, un autre cultive des orchidées, un troisième se demande pourquoi les œufs ne sont pas carrés et un autre que je n'ai pas encore cité se penche sur les problèmes d'échecs du maître Capablanca.
Les psychothérapeutes et psychanalystes font aussi ce qu'il leur plaît en principe. Certains jouent aussi aux échecs, écrivent des poèmes, peignent … il y en a qui tricotent, qui écrivent des « Écrits », il y en a qui écrivent même des romans policiers... En tout cas, ils continuent à travailler ou à être travaillés par ces problèmes.
Mais que font les patients ? Eux aussi, entre les séances, ils travaillent, restent en proie à leurs difficultés et souvent ils travaillent du chapeau. Quand ils bénéficient d'une certaine liberté de circulation ils font comme les autres et se présentent à leurs séances librement. Mais comme Jean Oury l'a signalé il y a des patients qui ne vont pas voir leur thérapeute librement mais qu'on amène entre deux infirmiers car le reste du temps le patient en question est en cellule.
J'en arrive à l'aspect social ou politique de certains romans policiers. En France il y a des auteurs « engagés » comme Manchette ou Daeninckx mais ces aspects sociaux apparaissent surtout dans les romans « noirs » des auteurs américains comme Daschell Hammett, Raymond Chandler, James . M. Cain et Ross Mac Donald. Bien sûr il y en a beaucoup d'autres mais on ne peut pas tous les citer. Ces auteurs explorent et dénoncent une société corrompue par l'argent et l'ambition où certains hommes politiques, hommes d'affaires ou policiers incarnent le mal aussi bien que les véritables criminels.
Ces écrivains posent la question de l'éthique dans ce genre de société, comme chez d'autres écrivains, français déjà cités ou écrivains scandinaves comme M. Sjöwall et P. Wahlöö ou Henning Mankell entre autres.
Quelques mots sur les écrivains américains.
Daschell Hammett avait été condamné à six mois de prison par la Commission Mac Carthy en 1951 pour avoir refusé de dénoncer ses amis suspects d'être communistes. Parmi ses romans les plus connus on trouve « Le faucon maltais », « La clé de verre », « Sang maudit », « L'introuvable » …. L'écriture de Hammett est incisive, sobre, aux phrases courtes et révèle le caractère d'un véritable écrivain. Parmi ses personnages il y a l'agent anonyme de l'Agence Pinkerton qu'on retrouve dans plusieurs romans et Sam Spade le privé du Faucon maltais. Ce dernier livre constitue une sorte de métaphore de cette société. Les gens s'entre-tuent pour posséder ce faucon supposé être en or alors qu'à la fin en grattant la peinture ou le vernis on s'aperçoit qu'il est en plomb. Le cynisme de certains personnages comme Spade n'empêche pas qu'ils restent fidèles à certaines valeurs humaines.
Raymond Chandler dénonce aussi la société américaine et en particulier Los Angeles. Si Hammett était tuberculeux Chandler était alcoolique et avait été interné une fois ou deux dans des hôpitaux psychiatriques. Il n'empêche qu'en créant le personnage de Philip Marlowe, en hommage au poète anglais Christopher Marlowe, il avait crée un enquêteur intègre, obstiné, à la recherche de la vérité, insubordonné, moins cynique que désenchanté et doué d'un humour souvent décapant. Deux des livres de Chandler parmi les plus connus, « Le grand sommeil » et « La dame du lac » avaient été traduit en français par Boris Vian et sa femme Michelle Vian.
On peut peut être citer un petit passage de son roman « The long goodbye », traduit à l'époque de façon assez bizarre sous le titre de
« Sur un air de navaja » . Au cours de ce roman Philip Marlowe rencontre une riche héritière fille d'un magnat de l'acier et qui possède la plupart des journaux locaux que, par ailleurs, il méprise. Marlowe tombe amoureux de cette femme, Linda Loring. Celle ci lui propose de rencontrer son père. Le chauffeur du milliardaire un noir nommé Amos va le chercher dans la limousine.
Après cet entretien :
« -Alors, me demanda-t-elle doucement, ça s'est bien passé avec mon père ?.
-Très bien. Il m'a fait un cours sur la civilisation … Telle qu'il la conçoit du moins. Il va la laisser évoluer encore quelque temps. Mais elle ferait bien de se tenir à carreau et de ne pas envahir sa vie privée. Sinon, il est capable de téléphoner à Dieu le père de tout foutre en l'air.
-Vous êtes incorrigible.
-Moi, incorrigible ? Regardez votre père en face, ma petite dame. A côté de lui, je suis juste un enfant de chœur.
Je sortis et trouvai Amos qui m'attendait avec la Cadillac. Il me ramena à Hollywood. Je lui offris un dollar, mais il le refusa. Je lui proposai alors de lui acheter les poèmes de T.S.Eliot. Il me répondit qu'il les avait déjà ».
C'est peut être chez Chandler qu'on retrouve de la façon la plus claire la question de l'éthique dans les relations inter humaines où, à côté de quelques policiers honnêtes, et des gangsters, des policiers véreux, et des hommes d'affaires corrompus on trouve de véritables malades mentaux, psychopathes et pervers.
Ross Mac Donald, grand admirateur de Chandler, campe lui aussi avec Lew Archer un détective privé intègre et humaniste. Ce qui peut nous intéresser dans ses romans c'est que, souvent, cet enquêteur doit remonter à plusieurs générations pour trouver la solution.
Bien sûr, ces commentaires ne peuvent pas rendre compte de l'ensemble du contenu de ces livres. Pour en avoir une compréhension plus large et plus précise il faudrait naturellement les lire.
Je vais essayer à présent de dire quelques mots sur Chesterton car
cet auteur, Gilbert Keith Chesterton, nous offre un véritable monde où on retrouve les problèmes sociaux, les énigmes les plus obscures, la poésie et les logiques les plus surprenantes.
Borges le considérait comme l'un de ses maîtres
Les œuvres de Chesterton sont surtout connues par les enquêtes du « Père Brown », prêtre catholique et détective amateur. Il faut savoir que Chesterton s'était converti au catholicisme en 1922 dans une Angleterre dominée par la religion protestante.
Avant les enquêtes du « Père Brown » il avait déjà écrit d'autres romans entre autres « Le nommé Jeudi ». Ce livre, préfacé dans sa traduction française par Pierre Klossowski, nous présente une série d'événements en miroir. On y trouve deux groupes. Le premier est composé de sept anarchistes qui portent tous les noms de la semaine et dont le président s'appelle Dimanche. Le deuxième groupe est formé par sept détectives qui tentent de détruire le groupe anarchiste. Ainsi, l'un des détectives, qui est aussi un poète, s'infiltre dans le groupe anarchiste et prend le nom de Jeudi car celui qui occupait cette place venait de mourir. Le poète détective attaque le premier anarchiste pour s'apercevoir que celui-ci est aussi un détective infiltré. La suite est facile à comprendre : Tous les anarchistes sont des détectives et le président est aussi le chef des détectives. On s'aperçoit en continuant la lecture que ce livre constitue aussi une métaphore de la Genèse : Dieu a travaillé six jours et le septième il s'est reposé.
Cette logique paradoxale Chesterton l'illustre aussi en affirmant que ce ne sont pas les prolétaires révoltés qui font exploser des bombes mais que les vrais anarchistes ce sont les capitalistes et les milliardaires.
On retrouve d'autres logiques chez la Père Brown en particulier dans « Le secret du Père Brown » où il vaut mieux en citer quelques lignes plutôt que les paraphraser. Ainsi : « Ce qu'ils (les scientifiques) veulent dire, c'est qu'il faut se tenir à l'extérieur de l'homme et l'étudier comme s'il était un gigantesque insecte ; en vertu d'une approche d'où l'émotion est absente et qu'ils qualifient d'impartiale ; et en vertu de ce que moi j'appelle une approche inerte et déshumanisée ». …........... « Eh bien, ce que vous appelez « le secret », c'est exactement le contraire. Je n'essaie pas de me tenir à l'extérieur de l'homme. J'essaie d'entrer dans la peau de l'assassin.... C'est en fait bien plus que cela, comprenez vous ? Je suis vraiment à l'intérieur d'un homme ; j'actionne ses bras et ses jambes : mais j'attends de savoir que je suis à l'intérieur d'un assassin, que j'ai fait miennes ses pensées, et que je me débatte avec ses passions ; jusqu'à ce que je me sois coulé dans le moule de sa haine ….. ».
Sans doute nos malades ne sont pas des assassins et je ne sais pas s'il faut essayer de s'identifier à tel ou tel malade. Je crois qu'il s'agit pour nous plutôt de sympathie que d'empathie. Mais Jean Oury disait qu'il lui arrivait parfois de mimer les gestes de certains malades.
En tout cas, il me semble que les approches logiques et éthiques de Chesterton restent très intéressantes pour nous.
* * *
Ce parcours que je croyais se résumer à une petite récréation s'est avéré plus difficile et peut être plus intéressant que prévu. En tout cas pour ceux qui ont lu des romans policiers et qui se sont approché de la psychiatrie.
Bien sûr ce texte n'est que l'esquisse de ce qu'on pourrait développer et préciser sur le plan logique, social et même poétique. Il s'agit en tout cas de questions concernant la condition humaine. Des questions qui restent souvent et heureusement sans réponses.
Jean Oury parlait d'un malade qui disait à son médecin : « J'en ai marre de me poser des réponses ! ».
Antoine Viader
POLARS ET PSYCHIATRIE
On peut se demander quels points communs existent entre la psychiatrie et les romans ou les films policiers. A mon avis il peut y en avoir plusieurs. Mais avant d'aborder ces points communs il faut sans doute dire quelques mots sur les origines de la littérature policière. On s'accorde habituellement pour désigner Edgar Allan Poe comme le fondateur de cette littérature avec des récits tels que « Le mystère Marie Roget », « Deux assassinats rue Morgue » et « La lettre volée ». Il ne faut pas oublier que Poe était aussi et surtout un poète. Cependant, dans un numéro d'août de cette année de « La Quinzaine littéraire » consacré à la littérature policière, Matthieu Letourneux, professeur de littérature à l'université a Paris- Nanterre, affirme que cette origine remonte à Eugène Sue avec « Les mystères de Paris » et à Ponson du Terrail avec « Les drames de Paris » et les aventures de Rocambole. Pour cet auteur comme pour d'autres auteurs dans cette revue il s'agit de dévoiler « la face obscure » de nos sociétés que révèlent les récits policiers au delà des énigmes ou des intrigues proprement policières et Véronique Bergen intitule son article ainsi : « Raymond Chandler : enquête sur la condition humaine ».
Nous aurons l'occasion d'y revenir.
* * *
Donc, il y l'intrigue ou l'énigme à élucider. Sans doute, un psychiatre n'est pas en principe un détective ou un policier et l'énigme en question n'a souvent rien à voir avec les mystères de la psychopathologie. Cependant, dans les deux cas il s'agit d'une recherche. Le détective cherche un suspect ou un coupable et le psychiatre tente d'aider le sujet de trouver sa propre vérité. Et ces recherches impliquent l'utilisation d'une logique.
Un deuxième point commun concerne l'interprétation.
Dans un roman policier le détective cherche à interpréter les signes ou les indices recueillis sur la scène du crime. C'est sans doute le cas pour l'un des plus célèbres détectives de roman, Sherlock Holmes de Conan Doyle.
Mais dans un autre contexte l'interprétation fait partie du travail du psychiatre et du psychanalyste ce que l'on retrouve entre autres dans l' « Interprétation des rêves » de Freud et cela fait partie du travail du thérapeute comme du patient.
D'autre part, on connaît aussi les interprétations pathologiques dans les délires d'interprétation.
Il y sur certains points une opposition entre traduction et interprétation. En dehors de l'aspect oral ou écrit, la traduction consiste à passer un texte d'une langue à une autre en tendant à conserver le même sens et la même valeur alors que l'interprétation consiste à donner à l'énoncé dans la même langue un autre sens.
Un autre point concerne la personnalité des criminels qui apparaissent dans ces romans ou dans ces films et dans celles de certains policiers ou détectives.
Je ne vais pas essayer d'analyser la psychopathologie de ces criminels psychopathes ou psychotiques qu'on retrouve dans ces œuvres policières. Je vais juste en citer quelques uns. Sans doute le plus connu et le plus impressionnant c'est le personnage de « Psychose » d'Alfred Hitchcock interprété par Anthony Perkins. On en trouve aussi dans d'autres films du même auteur comme « L'inconnu du Nord-Express » ou, de façon différente, dans « La maison du docteur Edwards » où l'auteur s'intéresse à la psychanalyse. Pour ne pas quitter tout de suite Hitchcock on peut citer certains de ses films pendant sa période anglaise comme « Une femme disparaît » ou « Les 39 marches » où il s'agit plutôt de films d'espionnage et où l'humour atténue largement la violence de certaines actions.
Lorsqu'il s'agit de ces personnages, criminels ou enquêteurs il faut les situer dans une certaine ambiance surtout quand l'auteur crée de son côté une ambiance ou une atmosphère.
L'existence ou la qualité d'une ambiance diffère selon les romans policiers comme dans la psychiatrie. On connaît l'importance de l'ambiance dans les lieux de soin et elle dépend souvent de la présence de certaines personnes, patients ou soignants. Dans les romans policiers l'ambiance est très différente suivant l'auteur. Ainsi, dans les romans dont le ressort principal est la solution de l'énigme ou l'intrigue l'ambiance a peu d'importance. C'est le cas le plus souvent des livres d'Agatha Christie, de ceux de Conan Doyle avec Sherlock Holmes et de ceux d'Ellery Queen entre autres. Je cite ce dernier qui avait pas mal de succès dans les années 1940 - 1960 parce que Jorge Borges lui même auteur de récits à énigme le cite à plusieurs reprises dans ses notes de lecture. Dans ce genre de livres les personnages restent des personnages souvent caricaturaux comme Hercule Poirot qui par contraste montre sa brillante intelligence dans ces intrigues souvent très bien agencées par l'auteur.
Par contre, il suffit de quelques lignes à Simenon pour créer une véritable ambiance où le commissaire Maigret prend l'épaisseur d'une personne vivante au delà de son personnage.
On peut peut être prendre l'exemple de Maigret pour aborder la question de la logique ou des logiques utilisées par les enquêteurs.
Maigret c'est un taiseux qui fume sa pipe comme s'il ruminait, donne des ordres à ses inspecteurs boit de la bière ou un grog quand il est enrhumé ou grippé. Lorsqu'il est grippé, lorsqu'il qu'il a de la fièvre, il transpire et on peut dire qu'il « sécrète » et finalement il livre le secret en question. Jules Maigret apparaît comme une personne car, contrairement aux créateurs de Sherlock Holmes ou d'Hercule Poirot, Simenon le décrit comme un homme du peuple, quelqu'un qui connaît ce qu'on appelle la « nature humaine » ou simplement les gens qu'il fréquente dans leur paysage commun. Sans doute il raisonne, il interprète les faits et les paroles lors des interrogatoires et il emploie la déduction, l'induction ou ses propres intuitions par associations d'idées comme tout chercheur.
Les autres enquêteurs que je viens d'évoquer ne se situent pas vraiment dans un paysage mais plutôt sur une scène. Ils se concentrent sur leurs raisonnements déductifs à partir des faits, des indices et des témoignages sans sortir de la scène de l'énigme elle même. C'est peut être différent même chez Agatha Christie quand il s'agit de Miss Marple. Celle-ci fait souvent allusion lors de ses enquêtes à la vie de son village où elle trouve des analogies avec l'intrigue qu'elle tente de résoudre. C'est aussi le cas de l'héroïne de Patricia Wentworth, Miss Silver dont ses collègues et admirateurs disent d'elle: « Elle connaît les gens ». En fait, Miss Silver, ancienne préceptrice devenue sur le tard détective privée, prend contact avec les gens du village où elle enquête en liant conversation avec les commerçants locaux ou en aidant une domestique à faire la vaisselle dans la maison où elle a été appelée. Certains se rappellent la cuisine des pavillons de notre hôpital psychiatrique où, tout en faisant cuire les biftecks les conversations allaient bon train.
Un autre point à propos des logiques utilisées. Je parlais de déduction, d'induction ou d'intuition. Sans être très au fait de la logique en général je me risque sur ce terrain à propos de ce que Charles Spencer Peirce et Michel Balat nomment l'abduction. J'ai pensé qu'on pourrait illustrer ce genre de raisonnement par les livres de Fred Vargas avec le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg. Celui-ci est entouré d'une équipe qu'on peut qualifier de rationnelle et cartésienne alors que lui même semble toujours à côté de la plaque. Ses pensées naviguent en dehors des sillons tracés. On pourrait dire en paraphrasant Victor Hugo que c'est quelqu'un qui pense à autre chose. Mais c'est en suivant les détours de ses pensées qu'il parvient à la vérité.
On dira peut être que nous sommes loin des préoccupations de la psychiatrie. Cependant ce que Jean Oury appelle la phénoménologie de la rencontre et la question du diagnostic correspond aussi à la recherche de la vérité dans ces romans.
Et les psychiatres utilisent aussi ces logiques auxquelles il faudrait ajouter la logique poétique que préconise Oury dans les relations avec les psychotiques ou la fonction poétique du langage dont parle François Tosquelles. À ce propos on pourrait évoquer le personnage de Fantômas de Marcel Allain et Pierre Souvestre et relire la « Complainte de Fantômas » de Robert Desnos.
Quand je parle de connaître les gens dans certains romans policiers je pense aussi que l'une des fonctions des équipes du Secteur Psychiatrique consistait précisément à connaître les gens. Non seulement les malades et leurs familles mais les habitants du quartier et surtout ceux qui ont une certaine influence comme les hommes politiques locaux, les policiers du commissariat, les prêtres, certains commerçants en particulier les patrons de bar.
Bien sûr on ne peut pas connaître de près tout le monde mais on peut s'attarder sur certains visages et écouter ce qui se dit surtout quand on a du mal à comprendre ce qui se passe. Ainsi, dans le dernier livre de Fred Vargas, « Quand sort la recluse », le commissaire Adamsberg note quelques mots échangés lors de plusieurs conversations, des mots et des noms qui le tracassent sans savoir pour quoi jusqu'au moment où il trouve ce pourquoi.
L'importance du regard on la retrouve dans « La lettre volée » d'Edgar Poe. On sait que Jacques Lacan a consacré l'un de ses Séminaires cette lettre volée et que Deleuze et Derrida l'ont commenté. Pour ma part je ne fais que résumer cette nouvelle de Poe. Dans cette histoire figurent d'abord le roi, la reine et le ministre. Se trouve sur une table une lettre compromettante pour la reine. Celle ci tente de la cacher mais le ministre la subtilise adroitement. Le roi ne voit rien et surtout il ne doit rien voir. Il y a donc dans cette scène des échanges de regards et des gestes surpris. Les policiers tentent de retrouver cette lettre en fouillant le cabinet et le domicile du ministre pendant son absence sans rien trouver. Car pour eux un objet comme cette lettre doit être enfermée quelque part et doit être hors de la vision extérieure. Mais les policiers ont beau sonder tous les meubles et tous les murs, planchers et plafonds la lettre reste introuvable jusqu'à ce que le préfet de police ait recours au Chevalier Dupin. Celui-ci après deux visites chez le ministre remet la lettre au préfet. En effet, la lettre en question, un peu salie et froissée se trouve en évidence au milieu d'autres lettres et cartes dans un porte cartes accroché au mur. On peut dire que « ça crève les yeux ». Et bien sûr si on a les yeux crevés on ne voit rien. Sauf si on se réfère à Œdipe qui lui, ne devient voyant qu'après qu'il se soit crevé les yeux.
Dans cette nouvelle de Poe il s'agit de dissimulation mais aussi de simulation dans la mesure où la lettre originale a été camouflée pour qu'elle ne ressemble pas à l'originale.. A ce sujet on pourrait se référer au livre de Roland Kuhn, « Phénoménologie des masques à travers le Rorcharch » avec la préface de Gaston Bachelard dans la traduction française. Il s'agit bien de dissimuler le visage grâce au masque mais aussi de simuler, de faire semblant d'avoir un autre visage ou une autre expression.
Il faut dire quelques mots des détectives sédentaires et de leurs auxiliaires. Contrairement à Sherlock Holmes et à Hercule Poirot grands voyageurs, certains détectives ne quittent guère leur domicile. C'est le cas de Néro Wolfe, le personnage de Rex Stout, dont l'embonpoint ne facilite pas ses mouvements et qui a horreur de se déplacer en voiture ou à pied. Il est vrai qu'il a un auxiliaire très mobile et efficace en la personne d'Archie Goodwin. Mais le plus sédentaire des détectives c'est sans doute Don Isidro Parodi le personnage créé par H. Bustos Domecq, c'est à dire par Adolfo Bioy Casares et Jorge Luis Borges qui ont utilisé ce pseudonyme pour écrire ensemble « Six problèmes pour Don Isidro Parodi. Donc, Don Isidro est sédentaire par force puisqu'il a été condamné à vingt ans de prison pour un crime qu'il n'a pas commis mais il s'accommode de sa situation et il reçoit divers visiteurs en proie à des difficultés qu'ils jugent insurmontables sans l'aide de l'ancien coiffeur installé dans sa cellule. Il s'agit, dans ces six épisodes, de gens, pour la plupart du genre masculin, et qui tiennent des discours plutôt labyrinthiques et qui ne manquent jamais de vanter leur intelligence, leur courage et leur franchise ou, au contraire d'afficher une humilité invraisemblable comme par exemple le petit diplomate chinois : « Mon misérable nom est Shu T'ung et j'occupe, à la risée de tous, le poste d'attaché culturel à l'ambassade de Chine, antre discrédité et malsain... ». Les auteurs s'amusent à placer des miroirs dans tous les coins pour fausser et inverser la logique des discours des divers personnages et Don Isidro ne se contente pas de piocher les bonnes pièces du puzzle mais il modifie la position des miroirs pour faire éclater la vérité.
Juste quelques mots pour les « auxiliaires » ou « seconds » qui apparaissent dans certains romans. Le plus connu de ces seconds c'est sans doute le Dr. Watson, ami fidèle de Holmes et qui s'attire inévitablement la réponse de son maître : « Élémentaire mon cher Watson ! ». Il y a aussi le capitaine Hastings, le second d'Hercule Poirot, détective amateur et sentimental dont la maladresse ne manque pas de donner quelques idées inattendues à Poirot.
Ici aussi on pourrait dire qu'on est loin de la psychiatrie mais nous avons aussi appris le métier auprès de gens plus expérimentés et savants que nous et qu'on peut parfois qualifier de maîtres et nous avons aussi reçu quelques répliques cinglantes.
J'ai parlé des détectives sédentaires mais on pourrait étendre cette notion aux situations où les détectives font autre chose que détecter et où les psychothérapeutes et les patients ne se trouvent pas ensemble dans une séance. Les détectives font ce qui leur plaît. L'un joue du violon, un autre cultive des orchidées, un troisième se demande pourquoi les œufs ne sont pas carrés et un autre que je n'ai pas encore cité se penche sur les problèmes d'échecs du maître Capablanca.
Les psychothérapeutes et psychanalystes font aussi ce qu'il leur plaît en principe. Certains jouent aussi aux échecs, écrivent des poèmes, peignent … il y en a qui tricotent, qui écrivent des « Écrits », il y en a qui écrivent même des romans policiers... En tout cas, ils continuent à travailler ou à être travaillés par ces problèmes.
Mais que font les patients ? Eux aussi, entre les séances, ils travaillent, restent en proie à leurs difficultés et souvent ils travaillent du chapeau. Quand ils bénéficient d'une certaine liberté de circulation ils font comme les autres et se présentent à leurs séances librement. Mais comme Jean Oury l'a signalé il y a des patients qui ne vont pas voir leur thérapeute librement mais qu'on amène entre deux infirmiers car le reste du temps le patient en question est en cellule.
J'en arrive à l'aspect social ou politique de certains romans policiers. En France il y a des auteurs « engagés » comme Manchette ou Daeninckx mais ces aspects sociaux apparaissent surtout dans les romans « noirs » des auteurs américains comme Daschell Hammett, Raymond Chandler, James . M. Cain et Ross Mac Donald. Bien sûr il y en a beaucoup d'autres mais on ne peut pas tous les citer. Ces auteurs explorent et dénoncent une société corrompue par l'argent et l'ambition où certains hommes politiques, hommes d'affaires ou policiers incarnent le mal aussi bien que les véritables criminels.
Ces écrivains posent la question de l'éthique dans ce genre de société, comme chez d'autres écrivains, français déjà cités ou écrivains scandinaves comme M. Sjöwall et P. Wahlöö ou Henning Mankell entre autres.
Quelques mots sur les écrivains américains.
Daschell Hammett avait été condamné à six mois de prison par la Commission Mac Carthy en 1951 pour avoir refusé de dénoncer ses amis suspects d'être communistes. Parmi ses romans les plus connus on trouve « Le faucon maltais », « La clé de verre », « Sang maudit », « L'introuvable » …. L'écriture de Hammett est incisive, sobre, aux phrases courtes et révèle le caractère d'un véritable écrivain. Parmi ses personnages il y a l'agent anonyme de l'Agence Pinkerton qu'on retrouve dans plusieurs romans et Sam Spade le privé du Faucon maltais. Ce dernier livre constitue une sorte de métaphore de cette société. Les gens s'entre-tuent pour posséder ce faucon supposé être en or alors qu'à la fin en grattant la peinture ou le vernis on s'aperçoit qu'il est en plomb. Le cynisme de certains personnages comme Spade n'empêche pas qu'ils restent fidèles à certaines valeurs humaines.
Raymond Chandler dénonce aussi la société américaine et en particulier Los Angeles. Si Hammett était tuberculeux Chandler était alcoolique et avait été interné une fois ou deux dans des hôpitaux psychiatriques. Il n'empêche qu'en créant le personnage de Philip Marlowe, en hommage au poète anglais Christopher Marlowe, il avait crée un enquêteur intègre, obstiné, à la recherche de la vérité, insubordonné, moins cynique que désenchanté et doué d'un humour souvent décapant. Deux des livres de Chandler parmi les plus connus, « Le grand sommeil » et « La dame du lac » avaient été traduit en français par Boris Vian et sa femme Michelle Vian.
On peut peut être citer un petit passage de son roman « The long goodbye », traduit à l'époque de façon assez bizarre sous le titre de
« Sur un air de navaja » . Au cours de ce roman Philip Marlowe rencontre une riche héritière fille d'un magnat de l'acier et qui possède la plupart des journaux locaux que, par ailleurs, il méprise. Marlowe tombe amoureux de cette femme, Linda Loring. Celle ci lui propose de rencontrer son père. Le chauffeur du milliardaire un noir nommé Amos va le chercher dans la limousine.
Après cet entretien :
« -Alors, me demanda-t-elle doucement, ça s'est bien passé avec mon père ?.
-Très bien. Il m'a fait un cours sur la civilisation … Telle qu'il la conçoit du moins. Il va la laisser évoluer encore quelque temps. Mais elle ferait bien de se tenir à carreau et de ne pas envahir sa vie privée. Sinon, il est capable de téléphoner à Dieu le père de tout foutre en l'air.
-Vous êtes incorrigible.
-Moi, incorrigible ? Regardez votre père en face, ma petite dame. A côté de lui, je suis juste un enfant de chœur.
Je sortis et trouvai Amos qui m'attendait avec la Cadillac. Il me ramena à Hollywood. Je lui offris un dollar, mais il le refusa. Je lui proposai alors de lui acheter les poèmes de T.S.Eliot. Il me répondit qu'il les avait déjà ».
C'est peut être chez Chandler qu'on retrouve de la façon la plus claire la question de l'éthique dans les relations inter humaines où, à côté de quelques policiers honnêtes, et des gangsters, des policiers véreux, et des hommes d'affaires corrompus on trouve de véritables malades mentaux, psychopathes et pervers.
Ross Mac Donald, grand admirateur de Chandler, campe lui aussi avec Lew Archer un détective privé intègre et humaniste. Ce qui peut nous intéresser dans ses romans c'est que, souvent, cet enquêteur doit remonter à plusieurs générations pour trouver la solution.
Bien sûr, ces commentaires ne peuvent pas rendre compte de l'ensemble du contenu de ces livres. Pour en avoir une compréhension plus large et plus précise il faudrait naturellement les lire.
Je vais essayer à présent de dire quelques mots sur Chesterton car
cet auteur, Gilbert Keith Chesterton, nous offre un véritable monde où on retrouve les problèmes sociaux, les énigmes les plus obscures, la poésie et les logiques les plus surprenantes.
Borges le considérait comme l'un de ses maîtres
Les œuvres de Chesterton sont surtout connues par les enquêtes du « Père Brown », prêtre catholique et détective amateur. Il faut savoir que Chesterton s'était converti au catholicisme en 1922 dans une Angleterre dominée par la religion protestante.
Avant les enquêtes du « Père Brown » il avait déjà écrit d'autres romans entre autres « Le nommé Jeudi ». Ce livre, préfacé dans sa traduction française par Pierre Klossowski, nous présente une série d'événements en miroir. On y trouve deux groupes. Le premier est composé de sept anarchistes qui portent tous les noms de la semaine et dont le président s'appelle Dimanche. Le deuxième groupe est formé par sept détectives qui tentent de détruire le groupe anarchiste. Ainsi, l'un des détectives, qui est aussi un poète, s'infiltre dans le groupe anarchiste et prend le nom de Jeudi car celui qui occupait cette place venait de mourir. Le poète détective attaque le premier anarchiste pour s'apercevoir que celui-ci est aussi un détective infiltré. La suite est facile à comprendre : Tous les anarchistes sont des détectives et le président est aussi le chef des détectives. On s'aperçoit en continuant la lecture que ce livre constitue aussi une métaphore de la Genèse : Dieu a travaillé six jours et le septième il s'est reposé.
Cette logique paradoxale Chesterton l'illustre aussi en affirmant que ce ne sont pas les prolétaires révoltés qui font exploser des bombes mais que les vrais anarchistes ce sont les capitalistes et les milliardaires.
On retrouve d'autres logiques chez la Père Brown en particulier dans « Le secret du Père Brown » où il vaut mieux en citer quelques lignes plutôt que les paraphraser. Ainsi : « Ce qu'ils (les scientifiques) veulent dire, c'est qu'il faut se tenir à l'extérieur de l'homme et l'étudier comme s'il était un gigantesque insecte ; en vertu d'une approche d'où l'émotion est absente et qu'ils qualifient d'impartiale ; et en vertu de ce que moi j'appelle une approche inerte et déshumanisée ». …........... « Eh bien, ce que vous appelez « le secret », c'est exactement le contraire. Je n'essaie pas de me tenir à l'extérieur de l'homme. J'essaie d'entrer dans la peau de l'assassin.... C'est en fait bien plus que cela, comprenez vous ? Je suis vraiment à l'intérieur d'un homme ; j'actionne ses bras et ses jambes : mais j'attends de savoir que je suis à l'intérieur d'un assassin, que j'ai fait miennes ses pensées, et que je me débatte avec ses passions ; jusqu'à ce que je me sois coulé dans le moule de sa haine ….. ».
Sans doute nos malades ne sont pas des assassins et je ne sais pas s'il faut essayer de s'identifier à tel ou tel malade. Je crois qu'il s'agit pour nous plutôt de sympathie que d'empathie. Mais Jean Oury disait qu'il lui arrivait parfois de mimer les gestes de certains malades.
En tout cas, il me semble que les approches logiques et éthiques de Chesterton restent très intéressantes pour nous.
* * *
Ce parcours que je croyais se résumer à une petite récréation s'est avéré plus difficile et peut être plus intéressant que prévu. En tout cas pour ceux qui ont lu des romans policiers et qui se sont approché de la psychiatrie.
Bien sûr ce texte n'est que l'esquisse de ce qu'on pourrait développer et préciser sur le plan logique, social et même poétique. Il s'agit en tout cas de questions concernant la condition humaine. Des questions qui restent souvent et heureusement sans réponses.
Jean Oury parlait d'un malade qui disait à son médecin : « J'en ai marre de me poser des réponses ! ».
Antoine Viader
Le temps de l'INSCRIPTION PAR LAURENCE FANJOUX COHEN
Le temps de l’inscription.
(L’usage sémiotique du temps dans le quotidien d’une psychiatrie de ville).
Au début de mon activité de psychiatre, le concept de temps n’intervenait que très peu dans ma pratique quotidienne. Je faisais une psychiatrie que l’on peut qualifier de « généraliste », basée sur l’enseignement universitaire durant mes années d’internat à Marseille où se mêlaient à la fois des notions phénoménologiques et quelques rudiments psychanalytiques. Une orientation en thérapie systémique m’a conduite à travailler un an à San Francisco sur les thérapies de couple puis trois ans à Paris avec Mony Elkaïm, mais là aussi la notion de temps n’intervenait que très peu dans ma pratique. Si je réfléchissais au temps, c’était celui du temps vécu, concept que j’avais étudié dans le service du Pr Tatossian. On parlait de ralentissement du temps vécu dans les dépressions, d’accélération du temps vécu dans les manies et il nous était demandé à nous, étudiants internes de l’époque, de toujours rechercher cette dimension temporelle dans l’approche clinique des patients.
Après plusieurs années de pratique au sein de différents hôpitaux marseillais, je me suis installée en cabinet de ville à Perpignan. C’est là, que le hasard m’a fait rencontrer la sémiotique qu’enseigne Michel Balat[1] à l’université. Cet enseignement est très original car il mêle à la fois des concepts sémiotiques à ceux de la psychanalyse freudienne et lacanienne. L’abord en est complexe et nécessite une approche à pas mesurés, mais les concepts qu’elle utilise se sont avérés pour moi d’une grande utilité dans la pratique quotidienne. Il me semble que celui du maniement du temps est une dimension majeure et c’est ce dont je vais essayer de vous parler aujourd’hui.
Qu’est ce que la sémiotique ? C’est la science des signes. Le monde est fait de signes et la sémiotique propose des outils afin de pouvoir penser ces signes. La sémiotique qu’aborde Michel Balat[2] est celle développée par Peirce, philosophe et mathématicien américain du XIXème siècle, auteur d’une œuvre absolument majeure. Peirce affirme que la façon dont nous abordons le monde est triadique. Il existe trois façons de rencontrer le monde qu’il nomme la priméité, la secondéité et la tiercéité. La priméité est tout ce que nous rencontrons de manière immédiate, au point où on ne peut presque même pas parler de rencontre, mais une manière d’être là, avec la chose même. On pourrait dire que la priméité est ce qui a trait à l’ambiance, à ce que nous ressentons dans la rencontre avec quelqu’un mais dans une dimension qui est en deçà des mots, quelque chose qui a à voir avec la tonalité. La secondéité est une sorte de rencontre brutale avec le monde, quand quelque chose arrive et provoque en nous une sorte de surprise. La tiercéité est notre rencontre du monde dans la relation. C’est la catégorie du signe. Le signe est quelque chose qui est là pour quelqu’un [un autre signe appelé interprétant]. Il est donc par excellence de l’ordre de la tiercéité. Peirce ajoute que ces trois catégories sont hiérarchisées. Priméité et secondéité sont contenues dans la tiercéité. Mais il n’y a pas de tiercéité dans la priméité, ni dans la secondéité. Par exemple, ce qui a trait à l’ambiance, à la tonalité n’est pas lié à la relation en présence. Ces trois catégories peuvent être rapprochées des trois catégories lacaniennes du psychisme : l’imaginaire serait de l’ordre de la priméité, la secondéité serait ce que Lacan appelle le réel et le symbolique de l’ordre de la tiercéité.
De la même manière et en suivant cette logique, Peirce dit que le signe peut être décomposé en trois pôles : son représentement, son objet et son interprétant. Chaque pôle mériterait un long exposé pour détailler de quoi il est fait, mais ce qui est important à retenir est que cette triade est toujours présente dans une relation. Il y a ce qui se présente, le représentement, ce qui est en question, l’objet et la signification que l’on en donne qui est l’interprétant.
Nous savons tous que quand nous rencontrons quelqu’un, nous interprétons en permanence. Nous attribuons un sens à ce que nous voyons, à ce que nous vivons de cette rencontre. Peirce postule que dans ce fait même d’interpréter ce que se passe dans la rencontre, le représentement qui est présent à l’origine dans le signe va s’en trouver modifié et entraîner une nouvelle interprétation qui va entraîner une nouvelle fabrication de signes. Dès que quelque chose se présente, dans la tentative de saisir sa signification, on voit bien qu’on est confronté à un processus et non à quelque chose de figé. En terme sémiotique, ce processus est nommé une sémiose. Donc dans toute tentative de saisir le signe, on se trouve confronté non seulement à une triadicité, mais aussi à un mouvement lié à la nature même du signe.
Quelles en sont les répercussions sur notre pratique de psychothérapeute ?
Une des pensées majeures de la sémiotique est de dire que l’être humain a besoin d’inscrire son histoire. Et que c’est un défaut d’inscription qui est à l’origine de la souffrance psychique. La répétition que nous constatons dans nos propres vies et dans celles de nos patients serait une tentative d’inscrire ce qui ne l’a pas été. Et aller consulter un thérapeute est une des possibilités d’inscrire cette histoire. L’introspection individuelle ne nous permet pas d’inscrire notre histoire puisqu’elle est de l’ordre de ce que Peirce appelle la priméité, c’est à dire de l’imaginaire. Pour qu’il y ait inscription, il faut qu’il y ait un accès au symbolique, il faut symboliser la chose. Une autre façon d’exprimer les choses pourrait être : pour savoir ce qu’on pense, encore faut-il le dire. On croit que penser les choses est suffisant, mais cela ne suffit pas. Il faut pouvoir s’être exposé à un public, quelque qu’il soit, pour que cela puisse s’inscrire, sinon cela reste en suspens. Etre dans la tiercéité, dans la relation peut permettre cette inscription, cette symbolisation.
Le travail du thérapeute est donc de fabriquer un espace où l’inscription puisse se produire. C’est ce qu’on appelle la fonction scribe[3]. On pourrait croire que ce travail n’est finalement pas si difficile que cela. Qu’il suffit d’écouter le discours du patient pour que son histoire puisse s’écrire. Mais si on a en tête que toute formulation d’un signe est, de fait, un processus triadique dans lequel patient et thérapeute sont pris, on peut mesurer que cette tâche est infiniment complexe.
Un des grands axes sur lequel il est nécessaire de s’appuyer dans ce processus d’inscription, est que ni le patient, ni le thérapeute ne sait ce qui est en train de s’inscrire. Si le patient savait ce qu’il est en train de dire, cela reviendrait à dire qu’il a déjà symbolisé son questionnement et donc que sa démarche serait d’emblée vidée de son sens. Et le thérapeute, bien sûr, ne sait rien du patient. Le scribe écrit ce qu’on lui raconte sans savoir ce qu’il écrit. Il est mis dans une position de supposé savoir par le patient, et c’est probablement un des grands pièges de la relation thérapeutique : de croire que l’on sait de quoi le patient est fait. La relation thérapeutique dans son essence même nous conduit à croire cela. Bien sûr, nous pouvons repérer des choses, rassembler autour de certains indices des éléments qui vont nous permettre d’évoquer un diagnostic, envisager de soulager en proposant certains médicaments, mais le patient qui est en face de nous ne pourra jamais se résumer à ce simple diagnostic. Les choses sont beaucoup plus complexes. Lacan a une formule utile lorsqu’il dit : « Le malentendu est constitutif de l’être parlant ». Dans toute relation humaine, on croit qu’on parle de la même chose, qu’on partage les mêmes objets, mais on se trompe. La vérité ne s’attrape pas. On ne peut jamais dire « voilà, ça y est, c’est ça ! ».
Dans sa découverte de la technique analytique, c’est bien là dessus que Freud insiste : il n’y a aucune domination psychique de l’analyste sur le patient puisque l’analyste ne sait pas de quoi le patient est fait. C’est tout l’art et la technique de l’analyste de venir accueillir ce que le patient lui présente. Freud le décrit ainsi dans les Conseils aux Médecins[4] « Comment faut-il que l’analyste procède ? Il devra se déplacer suivant les besoins du patient, d’une position psychique à une autre, en évitant toute spéculation ». Comme l’explique Jacques Sedat[5] dans un de ses derniers livres, « Freud renonce clairement à la position de pensée intellectualiste qui a été sa première approche du patient. Il adopte et prône désormais une « position psychique » où le psychothérapeute est capable d’osciller d’une position à l’autre, en fonction de ce que lui dicte la demande de chaque patient. (…) Cette parole n’est plus délocutive (parler de quelqu’un) , mais allocutive (parler à quelqu’un) ».
Les concepts de sémiose et de processus triadique de la relation rendent bien compte de la position analytique qui annule la dimension hiérarchique. Jean Oury[6], à propos de psychiatrie institutionnelle, insiste beaucoup sur la nocivité de la hiérarchie dans les processus thérapeutiques et il affirme que cela ne peut, dans le meilleur des cas, qu’obtenir des améliorations temporaires par suggestion. Il affirme que la hiérarchie est ce qui nous reste de l’animalité.
Donc, toute démarche auprès d’un thérapeute est faite pour produire une inscription et dans la nature même de la rencontre se manifeste toujours un processus. Dans ce concept de processus qui se déroule, dans le mouvement inhérent à la recherche de sens, on voit bien que la dimension temporelle est présente. On retrouve toute la notion de l’après-coup développée par Freud. Que ce qui se passe dans le présent ne se dévoilera que dans le futur. Freud dit « l’inconscient est détemporalisé ». Ainsi, ce qui se joue dans la relation psychothérapique, dans la relation transférentielle que le patient met en place, c’est le défaut d’inscription de son histoire qui appartient au passé mais qui ne pourra être saisi que lorsque la chaîne des interprétants se sera déployé dans le futur.. Il existe une logique temporelle à laquelle nous ne pouvons échapper, à laquelle nous sommes soumis dans notre condition d’être humain.
Ce soubassement théorique entraîne plusieurs conséquences concrètes :
Lorsqu’un patient se présente pour une thérapie, on ne peut jamais savoir quelle sera la durée nécessaire pour lui à l’inscription de son histoire. Il est impossible de pouvoir déterminer à l’avance un nombre connu de séances. La prise en charge peut ainsi être de quelques séances, plusieurs semaines, des mois voire des années. Donc, lors d’une première consultation, j’ai toujours en tête que je me dois d’être disponible pour ce patient pour une durée très longue, que je me dois de l’assumer aussi longtemps que celui-ci le nécessite. Mais bien sûr chaque séance est limitée dans le temps. Formée avec un psychanalyste lacanien, je suis adepte des séances plutôt courtes et en règle générale elles sont comprises entre vingt et trente minutes. Donc des séances brèves liées à une possibilité de prise en charge très longue.
Dans la perspective temporelle, il est important de distinguer la cadence du rythme, deux vecteurs qui sont intimement liés.
Au tout début d’une thérapie, on décide ensemble de la cadence à donner au travail. Très souvent une séance tous les quinze jours est suffisante pour que le travail psychique puisse se faire. Mais, cette cadence est à adapter à chaque patient. Certains ont besoin soit d’une cadence plus rapide, parfois une fois par semaine, parfois deux, soit au contraire d’une cadence plus lente, une fois par mois, même une fois tous les deux mois. Cette cadence est donc singulière et modulable. Elle se décide à deux, dans un accord entre le patient et le thérapeute.
La cadence est à distinguer du rythme. Chacun a un rythme intérieur. Il est important de ne pas le négliger afin de ne pas surinterpréter des signes qui ne sont pas des symptômes mais qui sont liés au rythme.
Il y a des moments dans notre vie où nous avons une ouverture intérieure pour examiner de quoi nous sommes faits. Mais ces moments passent et s’ils ne sont pas saisis pour mettre en place un processus de pensée autour de nos questionnements, l’ouverture se referme et quelque soient les efforts fournis ensuite, il n’y a plus d’accès à des choses que l’on a enfouies. On dit que la dépression est un des moments féconds d’ouverture psychique. Elle serait une chance dans la vie de chacun d’entre nous pour examiner de quoi nous sommes faits. Ainsi, dans le traitement d’une dépression, outre l’aspect médicamenteux, l’abord psychothérapique doit toujours être proposé.
Par ailleurs, il est important de souligner que le travail psychique n’est pas linéaire, n’obéit pas à la loi du défilement du chronos. Il y a des moments où rien ne se passe, où dans le déroulement des séances on a l’impression d’une stagnation des choses. Ces moments-là, qu’on pourrait dire liés au rythme, liés à des mouvements intérieurs qui ne se disent pas, sont fondamentaux à respecter. De la même manière qu’il est nécessaire au thérapeute de se sentir tranquille intérieurement pour accueillir le patient, le patient doit pouvoir être tranquille, sentir qu’on lui laisse le temps. Et si ce temps semble vide, ennuyeux, le travail du thérapeute est d’accepter cet ennui, de ne rien bousculer, de ne pas chercher à provoquer des faits, des évènements. Une expression pourrait en rendre compte en disant « on ne peut pas aller plus vite que la musique ». Tenter de provoquer le patient à « sortir quelque chose » entraîne le plus souvent une rupture dans la relation thérapeutique ou malheureusement des dégâts importants. Hélène Chaigneau[7], grande thérapeute institutionnelle, disait qu’il faut traverser l’ennui.
J’ai reçu ainsi pendant plusieurs années une dame d’âge mûr, très introvertie. Elle parlait très peu, quelques phrases prononcées du bout des lèvres mais qu’elle ne sortait qu’après un temps assez long qui pouvait durer plus de 20 minutes. C’est assez long 20 minutes de silence. Pendant longtemps, j’ai donné de multiples interprétations théoriques à ce silence qui provoquait en moi un contre-transfert négatif très important, jusqu’à ce que cette notion de rythme s’impose à moi et que je conçoive qu’elle mettait en place une sorte de sas en début de séance avant de pouvoir verbaliser quelque chose. Le suivi s’est poursuivi plusieurs années avec toujours ce même espace silencieux en début de séance qui lui était nécessaire.
Un autre exemple de suivi illustre aussi l’aspect temporel des séances. Un jeune homme avec un long passé d’hospitalisation psychiatrique, fortement neuroleptisé, vient me demander une prise en charge pour « se sortir de la psychiatrie ». Très rapidement, il nous est apparu à tous les deux qu’une séance par semaine était largement insuffisante. Donc nous avons mis en place pendant quelques semaines une prise en charge une fois par jour, entre 5 et 10 minutes. Ceci a eu pour effet d’amener le patient à demander, pour la première fois, une hospitalisation, mais cette fois-là librement consentie, dans un établissement de son choix. Le processus d’admission dans cet établissement était assez long, articulé autour de la motivation du patient et nos multiples mini-séances ont été l’occasion de préparer cette nouvelle prise en charge qui a inauguré un mouvement fondamental dans le vécu de sa maladie.
Toujours à propos de rythme et de cadence des thérapies, une mère d’une cinquantaine d’années vient me trouver pour évoquer ses relations distantes et douloureuses avec son fils adulte dont elle n’avait pas obtenu la garde dans la petite enfance suite à un divorce. Après deux entretiens où nous évoquons son histoire familiale complexe et difficile, elle me demande d’espacer les séances qu’elle trouve trop denses et qui provoquent trop de tumulte intérieur en elle. Elle demande alors que les séances soient espacées de 6 semaines puis de 8 à 10 semaines. Après deux années de suivi, elle décide que la thérapie ne lui est plus nécessaire : elle a pu nouer enfin des relations avec ce fils et dépasser un conflit majeur avec son propre père. Le succès de cette thérapie peut nous paraître étonnant : il y a eu très peu de séances, environ 5 ou 6 sur une durée de deux ans. Pourtant la problématique était massive et très ancienne. On peut avancer que son succès est lié au moment probablement très fécond lié au rythme intérieur de cette patiente.
Par ailleurs, les thérapies de couple que je continue de faire régulièrement sont maintenant fortement imprégnées des concepts sémiotiques. J’ai pu remarquer que ces prises en charge étaient relativement brèves. Après quelques séances il y a, soit une résolution complète du conflit, soit un apaisement accompagné d’une demande de prise en charge individuelle par l’un des membres du couple et dans quelques rares cas une séparation (ce qui peut être considéré comme une résolution du conflit). J’ai constaté que, très souvent, je ne saisis que très peu de choses de ce qui est en jeu, et je ne peux jamais vraiment élaborer des hypothèses solides sur ce qui se passe. Mais chaque membre du couple trouve manifestement quelque chose dans cet espace de rencontre. On peut penser que dans le croisement des différentes relations transférentielles qui se mettent en place dans de telles thérapies, les concepts sémiotiques sont particulièrement utiles et efficaces dans l’inscription du questionnement du couple.
Un dernier élément temporel dans la technique de la psychothérapie enseignée par la sémiotique est la nécessité de donner la possibilité d’être surpris par le patient, surpris par ce qu’il raconte. Cette position psychique consiste à nouveau à ne pas enfermer le patient dans une temporalité chronologique. De postuler qu’il n’existe pas de lien d’une séance à l’autre. Pour que justement puisse surgir des choses auxquelles on ne s’attend pas. Pour cette raison, je ne relis jamais les notes que j’ai prises lors des séances précédentes. Chaque séance est une nouvelle séance, comme si le patient que j’ai déjà rencontré était un nouveau patient. Et je laisse celui-ci amener ce qui le préoccupe dans l’ici et maintenant, lui demandant de ne rien préparer pour la séance, de ne pas chercher à anticiper sa pensée, de laisser venir ce qui se présentera. Parfois, surtout lorsque la thérapie a commencé depuis peu, il m’arrive d’avoir totalement oublié la teneur des précédents entretiens. Mais cet oubli est souvent utile, car il n’enferme pas le patient dans un attendu psychique. Cette position que l’on pourrait qualifier d’atemporelle est associée à toute une logique sémiotique appelée logique du vague jugée absolument essentielle pour laisser la singularité du patient apparaître.
Pour conclure, on peut donc avancer que toute une partie du travail du psychothérapeute dans une logique sémiotique et psychanalytique est d’organiser le temps dans le processus de la thérapie. Une thérapie est l’inscription de quelque chose, la fabrication d’un concept de pensée. Cette inscription serait comme un bâtiment qu’il faudrait construire. Et pour construire un bâtiment, il est nécessaire d’utiliser un échafaudage. De la même façon, dans une thérapie, l’élément temporel, comme l’échafaudage, est indispensable au déroulement du processus, mais lorsque ce processus est arrivé à son terme et que l’on peut observer à posteriori tout ce qui a été mis en place, ce n’est en aucune façon l’élément temporel qui reste, mais l’inconscient qui a été inscrit. Ainsi on peut affirmer que la fonction de thérapeute est à la fois une fonction scribe mais aussi une fonction d’organisateur du temps.
[1] Psychanalyste, maïtre de conférences de sémiotique et de psychologie à l’Université de Perpignan
[2] Michel Balat, Des fondements sémiotiques de la psychanalyse : Pierce après Lacan et Freud, L’Harmattan, Paris, 2000
[3] Michel Balat, Psychanalyse, Logique, Eveil de Coma Le musement du scribe L’Harmattan, Paris 2000
[4] S. Freud, « Conseils aux médecins » (1912), in La Technique psychanalytique, PUF, 1970.
[5] Jacques Sedat Freud Armand Colin- 2010
[6] Jean Oury « Continuité et discontinuité en psychiatrie ». Intervention à Reus- 30 mars 1994
[7] Hélène Chaigneau, Les institutions à l’épreuve du temps – 7ième journées de psychothérapie institutionelle- Marseille- Novembre 1993
(L’usage sémiotique du temps dans le quotidien d’une psychiatrie de ville).
Au début de mon activité de psychiatre, le concept de temps n’intervenait que très peu dans ma pratique quotidienne. Je faisais une psychiatrie que l’on peut qualifier de « généraliste », basée sur l’enseignement universitaire durant mes années d’internat à Marseille où se mêlaient à la fois des notions phénoménologiques et quelques rudiments psychanalytiques. Une orientation en thérapie systémique m’a conduite à travailler un an à San Francisco sur les thérapies de couple puis trois ans à Paris avec Mony Elkaïm, mais là aussi la notion de temps n’intervenait que très peu dans ma pratique. Si je réfléchissais au temps, c’était celui du temps vécu, concept que j’avais étudié dans le service du Pr Tatossian. On parlait de ralentissement du temps vécu dans les dépressions, d’accélération du temps vécu dans les manies et il nous était demandé à nous, étudiants internes de l’époque, de toujours rechercher cette dimension temporelle dans l’approche clinique des patients.
Après plusieurs années de pratique au sein de différents hôpitaux marseillais, je me suis installée en cabinet de ville à Perpignan. C’est là, que le hasard m’a fait rencontrer la sémiotique qu’enseigne Michel Balat[1] à l’université. Cet enseignement est très original car il mêle à la fois des concepts sémiotiques à ceux de la psychanalyse freudienne et lacanienne. L’abord en est complexe et nécessite une approche à pas mesurés, mais les concepts qu’elle utilise se sont avérés pour moi d’une grande utilité dans la pratique quotidienne. Il me semble que celui du maniement du temps est une dimension majeure et c’est ce dont je vais essayer de vous parler aujourd’hui.
Qu’est ce que la sémiotique ? C’est la science des signes. Le monde est fait de signes et la sémiotique propose des outils afin de pouvoir penser ces signes. La sémiotique qu’aborde Michel Balat[2] est celle développée par Peirce, philosophe et mathématicien américain du XIXème siècle, auteur d’une œuvre absolument majeure. Peirce affirme que la façon dont nous abordons le monde est triadique. Il existe trois façons de rencontrer le monde qu’il nomme la priméité, la secondéité et la tiercéité. La priméité est tout ce que nous rencontrons de manière immédiate, au point où on ne peut presque même pas parler de rencontre, mais une manière d’être là, avec la chose même. On pourrait dire que la priméité est ce qui a trait à l’ambiance, à ce que nous ressentons dans la rencontre avec quelqu’un mais dans une dimension qui est en deçà des mots, quelque chose qui a à voir avec la tonalité. La secondéité est une sorte de rencontre brutale avec le monde, quand quelque chose arrive et provoque en nous une sorte de surprise. La tiercéité est notre rencontre du monde dans la relation. C’est la catégorie du signe. Le signe est quelque chose qui est là pour quelqu’un [un autre signe appelé interprétant]. Il est donc par excellence de l’ordre de la tiercéité. Peirce ajoute que ces trois catégories sont hiérarchisées. Priméité et secondéité sont contenues dans la tiercéité. Mais il n’y a pas de tiercéité dans la priméité, ni dans la secondéité. Par exemple, ce qui a trait à l’ambiance, à la tonalité n’est pas lié à la relation en présence. Ces trois catégories peuvent être rapprochées des trois catégories lacaniennes du psychisme : l’imaginaire serait de l’ordre de la priméité, la secondéité serait ce que Lacan appelle le réel et le symbolique de l’ordre de la tiercéité.
De la même manière et en suivant cette logique, Peirce dit que le signe peut être décomposé en trois pôles : son représentement, son objet et son interprétant. Chaque pôle mériterait un long exposé pour détailler de quoi il est fait, mais ce qui est important à retenir est que cette triade est toujours présente dans une relation. Il y a ce qui se présente, le représentement, ce qui est en question, l’objet et la signification que l’on en donne qui est l’interprétant.
Nous savons tous que quand nous rencontrons quelqu’un, nous interprétons en permanence. Nous attribuons un sens à ce que nous voyons, à ce que nous vivons de cette rencontre. Peirce postule que dans ce fait même d’interpréter ce que se passe dans la rencontre, le représentement qui est présent à l’origine dans le signe va s’en trouver modifié et entraîner une nouvelle interprétation qui va entraîner une nouvelle fabrication de signes. Dès que quelque chose se présente, dans la tentative de saisir sa signification, on voit bien qu’on est confronté à un processus et non à quelque chose de figé. En terme sémiotique, ce processus est nommé une sémiose. Donc dans toute tentative de saisir le signe, on se trouve confronté non seulement à une triadicité, mais aussi à un mouvement lié à la nature même du signe.
Quelles en sont les répercussions sur notre pratique de psychothérapeute ?
Une des pensées majeures de la sémiotique est de dire que l’être humain a besoin d’inscrire son histoire. Et que c’est un défaut d’inscription qui est à l’origine de la souffrance psychique. La répétition que nous constatons dans nos propres vies et dans celles de nos patients serait une tentative d’inscrire ce qui ne l’a pas été. Et aller consulter un thérapeute est une des possibilités d’inscrire cette histoire. L’introspection individuelle ne nous permet pas d’inscrire notre histoire puisqu’elle est de l’ordre de ce que Peirce appelle la priméité, c’est à dire de l’imaginaire. Pour qu’il y ait inscription, il faut qu’il y ait un accès au symbolique, il faut symboliser la chose. Une autre façon d’exprimer les choses pourrait être : pour savoir ce qu’on pense, encore faut-il le dire. On croit que penser les choses est suffisant, mais cela ne suffit pas. Il faut pouvoir s’être exposé à un public, quelque qu’il soit, pour que cela puisse s’inscrire, sinon cela reste en suspens. Etre dans la tiercéité, dans la relation peut permettre cette inscription, cette symbolisation.
Le travail du thérapeute est donc de fabriquer un espace où l’inscription puisse se produire. C’est ce qu’on appelle la fonction scribe[3]. On pourrait croire que ce travail n’est finalement pas si difficile que cela. Qu’il suffit d’écouter le discours du patient pour que son histoire puisse s’écrire. Mais si on a en tête que toute formulation d’un signe est, de fait, un processus triadique dans lequel patient et thérapeute sont pris, on peut mesurer que cette tâche est infiniment complexe.
Un des grands axes sur lequel il est nécessaire de s’appuyer dans ce processus d’inscription, est que ni le patient, ni le thérapeute ne sait ce qui est en train de s’inscrire. Si le patient savait ce qu’il est en train de dire, cela reviendrait à dire qu’il a déjà symbolisé son questionnement et donc que sa démarche serait d’emblée vidée de son sens. Et le thérapeute, bien sûr, ne sait rien du patient. Le scribe écrit ce qu’on lui raconte sans savoir ce qu’il écrit. Il est mis dans une position de supposé savoir par le patient, et c’est probablement un des grands pièges de la relation thérapeutique : de croire que l’on sait de quoi le patient est fait. La relation thérapeutique dans son essence même nous conduit à croire cela. Bien sûr, nous pouvons repérer des choses, rassembler autour de certains indices des éléments qui vont nous permettre d’évoquer un diagnostic, envisager de soulager en proposant certains médicaments, mais le patient qui est en face de nous ne pourra jamais se résumer à ce simple diagnostic. Les choses sont beaucoup plus complexes. Lacan a une formule utile lorsqu’il dit : « Le malentendu est constitutif de l’être parlant ». Dans toute relation humaine, on croit qu’on parle de la même chose, qu’on partage les mêmes objets, mais on se trompe. La vérité ne s’attrape pas. On ne peut jamais dire « voilà, ça y est, c’est ça ! ».
Dans sa découverte de la technique analytique, c’est bien là dessus que Freud insiste : il n’y a aucune domination psychique de l’analyste sur le patient puisque l’analyste ne sait pas de quoi le patient est fait. C’est tout l’art et la technique de l’analyste de venir accueillir ce que le patient lui présente. Freud le décrit ainsi dans les Conseils aux Médecins[4] « Comment faut-il que l’analyste procède ? Il devra se déplacer suivant les besoins du patient, d’une position psychique à une autre, en évitant toute spéculation ». Comme l’explique Jacques Sedat[5] dans un de ses derniers livres, « Freud renonce clairement à la position de pensée intellectualiste qui a été sa première approche du patient. Il adopte et prône désormais une « position psychique » où le psychothérapeute est capable d’osciller d’une position à l’autre, en fonction de ce que lui dicte la demande de chaque patient. (…) Cette parole n’est plus délocutive (parler de quelqu’un) , mais allocutive (parler à quelqu’un) ».
Les concepts de sémiose et de processus triadique de la relation rendent bien compte de la position analytique qui annule la dimension hiérarchique. Jean Oury[6], à propos de psychiatrie institutionnelle, insiste beaucoup sur la nocivité de la hiérarchie dans les processus thérapeutiques et il affirme que cela ne peut, dans le meilleur des cas, qu’obtenir des améliorations temporaires par suggestion. Il affirme que la hiérarchie est ce qui nous reste de l’animalité.
Donc, toute démarche auprès d’un thérapeute est faite pour produire une inscription et dans la nature même de la rencontre se manifeste toujours un processus. Dans ce concept de processus qui se déroule, dans le mouvement inhérent à la recherche de sens, on voit bien que la dimension temporelle est présente. On retrouve toute la notion de l’après-coup développée par Freud. Que ce qui se passe dans le présent ne se dévoilera que dans le futur. Freud dit « l’inconscient est détemporalisé ». Ainsi, ce qui se joue dans la relation psychothérapique, dans la relation transférentielle que le patient met en place, c’est le défaut d’inscription de son histoire qui appartient au passé mais qui ne pourra être saisi que lorsque la chaîne des interprétants se sera déployé dans le futur.. Il existe une logique temporelle à laquelle nous ne pouvons échapper, à laquelle nous sommes soumis dans notre condition d’être humain.
Ce soubassement théorique entraîne plusieurs conséquences concrètes :
Lorsqu’un patient se présente pour une thérapie, on ne peut jamais savoir quelle sera la durée nécessaire pour lui à l’inscription de son histoire. Il est impossible de pouvoir déterminer à l’avance un nombre connu de séances. La prise en charge peut ainsi être de quelques séances, plusieurs semaines, des mois voire des années. Donc, lors d’une première consultation, j’ai toujours en tête que je me dois d’être disponible pour ce patient pour une durée très longue, que je me dois de l’assumer aussi longtemps que celui-ci le nécessite. Mais bien sûr chaque séance est limitée dans le temps. Formée avec un psychanalyste lacanien, je suis adepte des séances plutôt courtes et en règle générale elles sont comprises entre vingt et trente minutes. Donc des séances brèves liées à une possibilité de prise en charge très longue.
Dans la perspective temporelle, il est important de distinguer la cadence du rythme, deux vecteurs qui sont intimement liés.
Au tout début d’une thérapie, on décide ensemble de la cadence à donner au travail. Très souvent une séance tous les quinze jours est suffisante pour que le travail psychique puisse se faire. Mais, cette cadence est à adapter à chaque patient. Certains ont besoin soit d’une cadence plus rapide, parfois une fois par semaine, parfois deux, soit au contraire d’une cadence plus lente, une fois par mois, même une fois tous les deux mois. Cette cadence est donc singulière et modulable. Elle se décide à deux, dans un accord entre le patient et le thérapeute.
La cadence est à distinguer du rythme. Chacun a un rythme intérieur. Il est important de ne pas le négliger afin de ne pas surinterpréter des signes qui ne sont pas des symptômes mais qui sont liés au rythme.
Il y a des moments dans notre vie où nous avons une ouverture intérieure pour examiner de quoi nous sommes faits. Mais ces moments passent et s’ils ne sont pas saisis pour mettre en place un processus de pensée autour de nos questionnements, l’ouverture se referme et quelque soient les efforts fournis ensuite, il n’y a plus d’accès à des choses que l’on a enfouies. On dit que la dépression est un des moments féconds d’ouverture psychique. Elle serait une chance dans la vie de chacun d’entre nous pour examiner de quoi nous sommes faits. Ainsi, dans le traitement d’une dépression, outre l’aspect médicamenteux, l’abord psychothérapique doit toujours être proposé.
Par ailleurs, il est important de souligner que le travail psychique n’est pas linéaire, n’obéit pas à la loi du défilement du chronos. Il y a des moments où rien ne se passe, où dans le déroulement des séances on a l’impression d’une stagnation des choses. Ces moments-là, qu’on pourrait dire liés au rythme, liés à des mouvements intérieurs qui ne se disent pas, sont fondamentaux à respecter. De la même manière qu’il est nécessaire au thérapeute de se sentir tranquille intérieurement pour accueillir le patient, le patient doit pouvoir être tranquille, sentir qu’on lui laisse le temps. Et si ce temps semble vide, ennuyeux, le travail du thérapeute est d’accepter cet ennui, de ne rien bousculer, de ne pas chercher à provoquer des faits, des évènements. Une expression pourrait en rendre compte en disant « on ne peut pas aller plus vite que la musique ». Tenter de provoquer le patient à « sortir quelque chose » entraîne le plus souvent une rupture dans la relation thérapeutique ou malheureusement des dégâts importants. Hélène Chaigneau[7], grande thérapeute institutionnelle, disait qu’il faut traverser l’ennui.
J’ai reçu ainsi pendant plusieurs années une dame d’âge mûr, très introvertie. Elle parlait très peu, quelques phrases prononcées du bout des lèvres mais qu’elle ne sortait qu’après un temps assez long qui pouvait durer plus de 20 minutes. C’est assez long 20 minutes de silence. Pendant longtemps, j’ai donné de multiples interprétations théoriques à ce silence qui provoquait en moi un contre-transfert négatif très important, jusqu’à ce que cette notion de rythme s’impose à moi et que je conçoive qu’elle mettait en place une sorte de sas en début de séance avant de pouvoir verbaliser quelque chose. Le suivi s’est poursuivi plusieurs années avec toujours ce même espace silencieux en début de séance qui lui était nécessaire.
Un autre exemple de suivi illustre aussi l’aspect temporel des séances. Un jeune homme avec un long passé d’hospitalisation psychiatrique, fortement neuroleptisé, vient me demander une prise en charge pour « se sortir de la psychiatrie ». Très rapidement, il nous est apparu à tous les deux qu’une séance par semaine était largement insuffisante. Donc nous avons mis en place pendant quelques semaines une prise en charge une fois par jour, entre 5 et 10 minutes. Ceci a eu pour effet d’amener le patient à demander, pour la première fois, une hospitalisation, mais cette fois-là librement consentie, dans un établissement de son choix. Le processus d’admission dans cet établissement était assez long, articulé autour de la motivation du patient et nos multiples mini-séances ont été l’occasion de préparer cette nouvelle prise en charge qui a inauguré un mouvement fondamental dans le vécu de sa maladie.
Toujours à propos de rythme et de cadence des thérapies, une mère d’une cinquantaine d’années vient me trouver pour évoquer ses relations distantes et douloureuses avec son fils adulte dont elle n’avait pas obtenu la garde dans la petite enfance suite à un divorce. Après deux entretiens où nous évoquons son histoire familiale complexe et difficile, elle me demande d’espacer les séances qu’elle trouve trop denses et qui provoquent trop de tumulte intérieur en elle. Elle demande alors que les séances soient espacées de 6 semaines puis de 8 à 10 semaines. Après deux années de suivi, elle décide que la thérapie ne lui est plus nécessaire : elle a pu nouer enfin des relations avec ce fils et dépasser un conflit majeur avec son propre père. Le succès de cette thérapie peut nous paraître étonnant : il y a eu très peu de séances, environ 5 ou 6 sur une durée de deux ans. Pourtant la problématique était massive et très ancienne. On peut avancer que son succès est lié au moment probablement très fécond lié au rythme intérieur de cette patiente.
Par ailleurs, les thérapies de couple que je continue de faire régulièrement sont maintenant fortement imprégnées des concepts sémiotiques. J’ai pu remarquer que ces prises en charge étaient relativement brèves. Après quelques séances il y a, soit une résolution complète du conflit, soit un apaisement accompagné d’une demande de prise en charge individuelle par l’un des membres du couple et dans quelques rares cas une séparation (ce qui peut être considéré comme une résolution du conflit). J’ai constaté que, très souvent, je ne saisis que très peu de choses de ce qui est en jeu, et je ne peux jamais vraiment élaborer des hypothèses solides sur ce qui se passe. Mais chaque membre du couple trouve manifestement quelque chose dans cet espace de rencontre. On peut penser que dans le croisement des différentes relations transférentielles qui se mettent en place dans de telles thérapies, les concepts sémiotiques sont particulièrement utiles et efficaces dans l’inscription du questionnement du couple.
Un dernier élément temporel dans la technique de la psychothérapie enseignée par la sémiotique est la nécessité de donner la possibilité d’être surpris par le patient, surpris par ce qu’il raconte. Cette position psychique consiste à nouveau à ne pas enfermer le patient dans une temporalité chronologique. De postuler qu’il n’existe pas de lien d’une séance à l’autre. Pour que justement puisse surgir des choses auxquelles on ne s’attend pas. Pour cette raison, je ne relis jamais les notes que j’ai prises lors des séances précédentes. Chaque séance est une nouvelle séance, comme si le patient que j’ai déjà rencontré était un nouveau patient. Et je laisse celui-ci amener ce qui le préoccupe dans l’ici et maintenant, lui demandant de ne rien préparer pour la séance, de ne pas chercher à anticiper sa pensée, de laisser venir ce qui se présentera. Parfois, surtout lorsque la thérapie a commencé depuis peu, il m’arrive d’avoir totalement oublié la teneur des précédents entretiens. Mais cet oubli est souvent utile, car il n’enferme pas le patient dans un attendu psychique. Cette position que l’on pourrait qualifier d’atemporelle est associée à toute une logique sémiotique appelée logique du vague jugée absolument essentielle pour laisser la singularité du patient apparaître.
Pour conclure, on peut donc avancer que toute une partie du travail du psychothérapeute dans une logique sémiotique et psychanalytique est d’organiser le temps dans le processus de la thérapie. Une thérapie est l’inscription de quelque chose, la fabrication d’un concept de pensée. Cette inscription serait comme un bâtiment qu’il faudrait construire. Et pour construire un bâtiment, il est nécessaire d’utiliser un échafaudage. De la même façon, dans une thérapie, l’élément temporel, comme l’échafaudage, est indispensable au déroulement du processus, mais lorsque ce processus est arrivé à son terme et que l’on peut observer à posteriori tout ce qui a été mis en place, ce n’est en aucune façon l’élément temporel qui reste, mais l’inconscient qui a été inscrit. Ainsi on peut affirmer que la fonction de thérapeute est à la fois une fonction scribe mais aussi une fonction d’organisateur du temps.
[1] Psychanalyste, maïtre de conférences de sémiotique et de psychologie à l’Université de Perpignan
[2] Michel Balat, Des fondements sémiotiques de la psychanalyse : Pierce après Lacan et Freud, L’Harmattan, Paris, 2000
[3] Michel Balat, Psychanalyse, Logique, Eveil de Coma Le musement du scribe L’Harmattan, Paris 2000
[4] S. Freud, « Conseils aux médecins » (1912), in La Technique psychanalytique, PUF, 1970.
[5] Jacques Sedat Freud Armand Colin- 2010
[6] Jean Oury « Continuité et discontinuité en psychiatrie ». Intervention à Reus- 30 mars 1994
[7] Hélène Chaigneau, Les institutions à l’épreuve du temps – 7ième journées de psychothérapie institutionelle- Marseille- Novembre 1993
LE SZONDI
LÉOPOLD SZONDI
psychiatre hongrois, a développé intuitivement une théorie pulsionnelle articulée autour d’un fameux test. Celui-ci fut mis au point en 1937 et appelé dans un premier temps « diagnostic expérimental des pulsions » et ensuite malencontreusement « test de Szondi ». Comme le dit Szondi lui-même « je n’avais jamais songé à gratifier du nom de test cette méthode de diagnostic de Psychologie profonde ». Bien plus qu’un outil d’évaluation, le test de Szondi permet l’investigation des processus pulsionnels à l’œuvre chez l’individu. L’idée intuitive de Szondi était que la liberté et la contrainte déterminent le destin de l’homme. La contrainte selon Szondi se trouve selon une prédisposition génétique alors que la liberté se manifeste par la capacité de l’homme de transformer les tâches que lui imposent sa prédisposition et la vie. Ce jeu de destin par la contrainte et la liberté devient manifeste dans des domaines importants de la vie : choix en amour, en amitié, dans la profession, la maladie et la mort. Recherchant une simplification dans la recherche des déterminants familiaux d’une personne, Szondi a développé une méthode basée sur le principe du choix. Dans le test on est invité à exprimer sa sympathie et son antipathie pour la photo de visages dont l’histoire clinique personnifie de manière radicale les facteurs spécifiques de la pulsion de l’homme. Cette théorie a été revisitée par l’école catholique de Louvain autour de Jacques Schotte dans les années 1970 qui a permis de « dégager la structure cachée du schéma pulsionnel szondien ». La base biologique génétique a été mise de côté pour favoriser une autre exploration des fondements analytiques, particulièrement la valeur structurale du schéma pulsionnel (Triebsystem). La conception des grands registres de la nosographie psychiatrique s’y trouve renouvelée : les thymopsychopathies, les perversions, les névroses et les psychoses L’apport de la pensée de philosophes comme Henri Maldiney et la pathosophie de Viktor Von Weizsäcker ont été majeurs dans le développement de ces concepts. MARC LEDOUX
docteur en philosophie, docteur en psychologie et sociologie, psychanalyste. Il enseigne à l’université de Louvain la Neuve, de Gand, à l’hôpital psychiatrique de Bierbeek ainsi qu’à l’université Paris Diderot. Il travaille depuis vingt ans à la clinique de La Borde à Cour-Chevemy et y anime chaque mercredi soir un séminaire autour du test de Szondi. Depuis 2011, il vient régulièrement à Elne parler de Szondi et des différentes théories qui viennent étayer le diagnostic expérimental des pulsions : « Actuellement, quand on aborde la souffrance de l’être humain, on l’aborde chacun à sa manière, chacun avec sa discipline, et finalement, il ne reste plus grand chose pour savoir comment l’homme vit. Pour restituer tout simplement la dimension de l’homme qui vit, l’homme vivant, l’outil szondien essaye de situer l’être humain dans ce qui le pousse ou ce qui l’immobilise dans les différentes dimensions de la vie. L’outil szondien permet de penser le rapport entre ces différentes dimensions. On peut presque dire que tous les secteurs du travail de soin sont caractérisés par l’absence de penser ces rapports, d’où une énorme dispersion, un énorme gaspillage dans les prises en charge. Avec cet outil de Szondi qui permet de penser les rapports entre les différentes dimensions, on arrive à la fois à construire un champ théorique et un champ pratique. Il est finalement une sorte de référence pour « comment prendre soin des gens dans toutes les dimensions ». LAURENCE FANJOUX COHEN J’ai entendu parler de Szondi pour la première fois lors des causeries de Michel (Balat) à Canet. Je crois que c’était en 2005-2006. Pendant presque une année, il nous a parlé des connecteurs logiques articulés avec le schéma pulsionnel szondien et les fantasmes originaires. D’emblée, j’ai accroché. Et je n’ai plus décroché !... Le livre de Lekeuche et Mélon (Dialectique des pulsions) que nous avait conseillé Michel m’a été très utile pour commencer à saisir les concepts szondiens. A l’époque, j’ai cherché ensuite des formations pour approfondir les choses mais je n’ai rien trouvé dans notre région. Lorsque je suis allé faire le stage d’une semaine à La Borde en 2011, j’ai bien sûr assisté au séminaire de Marc (Ledoux) du mercredi soir. C’était passionnant. Il nous a parlé du contact à partir d’un cas clinique et d’un profil. Et tout naturellement, dans la foulée, on a donc organisé une journée à Canet où Marc est venu pour la première fois. Les gens étaient enthousiastes. Je crois qu’il nous avait parlé aussi du contact, de la mélancolie, de Szondi bien sûr… Ensuite plusieurs personnes qui assistent régulièrement tous les lundis aux causeries de Michel ont souhaité que Marc revienne et c’est ainsi que depuis, il vient trois à quatre fois par an nous parler de Szondi, mais aussi de psychothérapie institutionnelle, du travail à La Borde, de Freud, Lacan, Schotte… Dans ma pratique de psychiatre libérale, j’ai progressivement intégré le test de Szondi. Je trouve que c’est un outil fantastique ! La passation du test avec son côté ludique introduit une dimension de jeu qui assouplit la relation. Par exemple pour les adolescents très fermés, hostiles d’emblée à une prise en charge psychiatrique et qui sont amenés par des parents inquiets. De plus, le fait que le test doit être repassé dix fois pour avoir dix profils fait rentrer, de facto, la personne dans un processus. Le thérapeute n’est plus dans une position hiérarchique de supposé savoir qui est souvent si nocive à tout processus thérapeutique. On est penchés, le patient et moi-même sur son profil szondien, on en parle, on en papote, on en joue… voyons, que va dire Szondi aujourd’hui ?... Je n’utilise pas le test pour redresser ou formaliser un diagnostic. Ou en tout cas, pas fréquemment. J’ai en tête quand même quelques adolescents, qui a la suite d’une hospitalisation en psychiatrie étaient surdosés en neuroleptiques et pour qui le diagnostic de schizophrénie avait été posé de façon définitive. Le passage du Szondi a permis pour eux d’ouvrir des possibles et ainsi de diminuer, voire pour certains d’arrêter les neuroleptiques et de modifier le diagnostic. Mais souvent, je ne fais pas d’interprétation intempestive comme le conseille Szondi et le rappelle fréquemment Marc, mais j’utilise les résultats pour pointer certaines accentuations pulsionnelles flagrantes. Je me souviens d’une patiente qui pendant plusieurs années multipliaient les crises que je qualifiais d’hystériques et qui déambulais anarchiquement entre son analyste, des hospitalisations dans tous les établissements de la ville où le diagnostic de bipolarité était retenu, et mes consultations. Je lui ai enfin proposé de faire un test de Szondi qui a montré des accentuations massives dans le vecteur de la toxicomanie. Toxicomanie qu’elle mentionnait parfois mais qu’elle incluait dans une problématique de couple et que j’avais jusque-là toujours minimisée. Le test nous a permis de positionner cette problématique de façon centrale ce qui a complètement modifié les choses pour elle. La complexité du test vient s’opposer à toutes les théories simplistes qui font florès aujourd’hui. L’être humain est complexe. Nous sommes tous soumis à des pulsions contradictoires. Comprendre ce qui nous anime doit être lu dans son ensemble avec ses accentuations, ses zones immobiles. Prendre du temps, prendre son temps, c’est aussi beaucoup ça qu’apporte le passage du test de Szondi. |
2011
Le devenir pathique de l’homme - 2011 -les circuits pulsionnels -le passage du test de Szondi -la logophanie et l’eidologie de Von Weizsäcker -la nécessité de la pathographie de la clinique Marc Ledoux Transcription : Laurence Fanjoux-Cohen Alors, pour commencer, ce n’est pas de la pub mais une invitation à travailler : avec des copains, on a traduit de l’allemand au français le livre de Von Weizsäcker dont Schotte a tiré ses meilleurs cours et que vous pouvez trouver aux éditions Millon. Cela s’appelle Pathosophie. Schotte passe d’une psychiatrie pulsionnelle à une anthropopsychiatrie en posant la question philosophique de ce qu’est l’homme. Von Weizsäcker passe d’une anthropologie médicale à la pathosophie en posant la question d’une prudence, d’un savoir (sophia) du côté d’une méditation de sage par une réflexion centrale sur le pathos au sens de ses catégories pathiques. Dans un de ses livres qui s’appelle Des cas et des problèmes : récit anthropologique dans la clinique médicale (1947), il écrit : Nous ne devons pas expliquer ni comprendre, mais concevoir. Et cela se fait en articulant des concepts pour construire une anthropologie médicale pathosophique. Je puis assurer que je n’ai point abandonné cette tâche, comme homme de laboratoire, comme neurologue, comme médecin généraliste. Je vous invite à suivre ce parti pris et de continuer notre réflexion, c’est à dire comment concevoir et approfondir cette anthropopsychiatrie en rapport avec les catégories pathiques. Depuis longtemps et sous l’impulsion de Maldiney dans le chapitre Le moment pathique dans le texte Le dévoilement et le moment pathique dans la phénoménologie d’Erwin Straus, un texte de 1966, nous avons inscrit le pathique comme dimension intérieure du sentir sensible dans le circuit du contact. Le pathique chez Erwin Straus se réduit à ce rapport au sensible. Dans notre contribution à Lisbonne autour de la rencontre Jacques Schotte/Von Weizsäcker, puis dans les séminaires du samedi à Louvain La Neuve, nous avons essayé des trucs, comme ça et on a inscrit les verbes pathiques dans les circuit : dürfen (oser) dans le contact, müssen (contraindre) et wollen (vouloir) dans le vecteur S, sollen (devoir par obligation morale- le français, c’est très compliqué quand même) dans le vecteur P et können (pouvoir ) dans le Sch. Ensuite on a repensé ces rapports en inscrivant le savoir, mais au sens de cette prudence, de cette méditation du sage dans Pathosophie. Dans le sch et dans le contact avec le couple oser et pouvoir. Les verbes pathiques, comme modalités du pathique, nous ouvrent la voie à un concept pathosophique fondamental, la logophanie. Von Weizsäcker a jusqu’à la fin de sa vie tenté de produire des concepts. Vous pouvez trouver ça en pages 149 à 161 de son livre. La logophanie et l’eidologie sont deux nouveaux concepts pour montrer que tout concept établi, logique, chosifié – quel danger que chosifier un concept! - est dérivé d’un mouvement passionnel, d’un mouvement d’être éprouvé, d’un mouvement antélogique. La logophanie, c’est l’apparaître (phanos) du logos dans le sens du mouvement de répartition, de dispersion et de recueillement. L’eidologie, c’est découvrir que d’être éprouvé, c’est le passionnel qui correspond à une pensée très rigoureuse. Une logique de l’eidos, une logique du voyant. J’ai vu ! Quelle initiation cela suppose de pouvoir voir ! Est-ce que l’anthropopsychiatrie, à partir d’une méditation du sage, peut se concevoir sous l’angle de la logophanie et nous libérer, enfin, d’une approche trop chosifiée et mosaïque ? Je vous donne quelques pistes, simplement. D’abord l’acte même de subir et de faire le passage du Szondi, ensuite l’antélogique du thème phylogenèse/ontogenèse, le mouvement passionnel des circuits puis finalement une écriture pathographique de la clinique. L’acte du passage du Szondi : en pratiquant les concepts pathiques de décision et rencontre de Von Weizsäcker, c’est dans la décision de prendre des photos que se déploient les forces pulsionnelles. Ainsi se transforme le concept de destin articulé dans sa logique philosophico-tragique littéraire en objectalité clinique. La notion de choix comme mouvement passionnel nous permet cette transformation. Dans l’épreuve qu’est le passage du test de Szondi, le matériel des visages humains présente l’humanité elle-même en nous. Le fait de choisir entre le sympathique (se mettre à l’épreuve avec, dire oui) et antipathique, (ne pas se mettre à l’épreuve avec, dire non), est une opération (ein leistung) pathique c’est à dire une opposition en deçà de tout jugement logique ou de valeur morale ou libidinale (il me plait) qui ouvre sur l’antélogique. C’est une opposition, comme dit Von Weizsäcker, pleine de sens. C’est l’évènement du passage, c’est à dire quelque chose qui m’arrive et que je m’approprie. Qui choisit ? c’est l’événement de ce passage qui choisit. Et dans l’interprétation des choix, le sujet s’aperçoit d’avoir choisi et le sens qu’a pris cet acte de choisir. Cet évènement révèle la tension entre liberté et nécessité dit Szondi, entre le vouloir et le devoir dit Von Weizsäcker. Décisif est le rapport entre oser/pouvoir (dürfen/können) et savoir. Se risquer à être choisi dans la vie et assumer le choix. L’antélogique de la phylogénèse et l’ontogenèse : cette logique trouve ces répondants dans l’antélogique de la pathogenèse. Bien sûr que la loi biogénétique fondamentale chère à Hegel trouve un usage fécond chez Freud. Cette loi qui dit que : L’histoire de l’évolution individuelle et de l’ontogénie est une répétition abrégée et rapide, une récapitulation de l’histoire évolutive paléontologique ou de la phylogénie conformément aux lois de l’hérédité et de la confrontation au milieu. On retrouve cette loi dans l’idée de chaine phylogénétique transmise qui réémergerait dans le vécu ontogénétique. Les scènes originaires, la séduction, le coït parental, etc… que Freud trouve à l’origine de sa recherche dans le discours des névrosés, sont considérés finalement comme des fantasmes originaires au même titre que les grands complexes comme l’Œdipe, la castration, etc… Freud dit dans son introduction à la psychanalyse qu’il est possible que tous les fantasmes qu’on nous raconte dans l’analyse aient été, jadis, aux temps originaires de la famille humaine, réalité. Et qu’en créant des fantasmes, l’enfant comble seulement à l’aide de vérités préhistoriques les lacunes de la vérité individuelle. Au point que, dans l’homme aux loups, là où les évènements ne s’adaptent pas aux schémas héréditaires, ils subissent dans le fantasme un remaniement. Toute l’activité fantasmatique s’alimente donc dans ce travail de récapitulation de chaines phylogénétiquement transmises. La fameuse thèse du meurtre du père dans Totem et Tabou prend tout son sens dans cette perspective. Là encore, il y a bien moins invention de Freud que réactualisation d’un schéma d’explications déterminées. On reste dans la logique d’explications. L‘hégelisme sert là encore de référent pour expliquer les mécanismes majeurs du psychisme. Les comparaisons et les différences entre l’hégelisme et Freud nous mèneraient trop loin sauf ceci : pour Hegel, la grande prophétie moniste a sonné la réconciliation de l’homme avec la nature. On y est à nouveau ! de la réconciliation de l’homme avec le grand Tout. L’homme se voit signifié une nouvelle pleine de promesse en lui, en l’homme… en lui l’humanité se réalise avec sans doute quelques promesses de bonheur. La santé mentale vous promet le bonheur. Faites une psychothérapie et vous trouverez le bonheur ! si ce n’est pas ça une prophétie moniste ! Chez Freud, point de pensée de la réconciliation. Non ! L’homme ne se réconcilie pas avec quelque mère Nature, principe de régénération, ni même avec sa nature. Il n’est pas dupe. Il sait, l’homme, qu’il ne peut plus se cacher longtemps, qu’il n’a pas le sens qu’il croyait dans le monde s’il est vivant et dans sa psyché. Et il découvre qu’il n’est pas le centre de tout. Et il doit l’accepter. Et faire son deuil des illusions. Ses illusions sont dangereuses. C’est la méconnaissance de la force de l’étranger en soi qui est le cœur de toute la pathogenèse. Pour Von Weizsäcker, la force de l’étranger, c’est la maladie par excellence et en particulier ce qu’il appelle la biose par laquelle l’homme par définition est malade et dont il veut –ou pas-guérir. L’homme n’est pas, il a à devenir. Dans Etudes et pathogenèse, il dit : Les maladies ne surgissent pas d’un quelconque hasard mais naissent d’un mouvement passionnel de la vie. La compréhension de leur devenir dépend de notre faculté à suivre ce mouvement de la passion. Les maladies sont des évènements qui atteignent une vie qui est toujours en train de s’affecter elle-même, une vie qui n’est pas seulement de l’ordre du fait à expliquer mais toujours aussi de l’ordre du pathir à concevoir. Pour circonscrire comment une maladie nait, évolue, se résout, on ne peut se contenter d’en prélever un fragment, un cliché instantané que l’on amènerait au laboratoire. Il importe aussi bien en clinique de resituer cet instantané dans l’histoire de vie du sujet qui fait (faire-produire) cette maladie. Dans ces mouvements passionnels de la vie, les moments de maladie n’apparaissent pas seulement comme des mouvements défaillants ou déficients, les scléroses, mais bien souvent aussi comme des réponses improvisées par la vie du sujet face à des situations de crises, de mise en question, comme des moments où le sujet vivant cherche une voie pour atteindre un nouvel équilibre, même provisoire, qui mérite d’être évalué de façon nuancée en terme de gains et de sacrifices. Thème très cher à Von Weizsäcker, le sacrifice ! L’autre piste, c’est la logophanie et l’eidologie des circuits. Voilà, on reprend maintenant toute notre tradition de travail avec le Szondi. Allez, on essaye d’approfondir un peu. Quel est le mouvement passionnel, antélogique des circuits ? quelle logique est sous-jacente aux lettres et signes des circuits ? Supposons que les circuits -quand même ! - soient devenus une évidence… l’eidologie, cette logique rigoureuse, se découvre assez vite, -et ça c’est le coup de génie de Schotte même s’il ne l’a jamais nommé eidologie-, dans le tableau de Mandeleev dans lequel la clinique nous montre son mouvement passionnel dans sa pathogenèse. On découvre, par l’éidologie, la pathogenèse des circuits. Un exemple : dans l’écriture esthétique de la formule : « la névrose est le négatif de la perversion comme la psychose est le positif de la psychopathie » où le négatif et le positif se situent dans un rapport au fond inaccessible, de la vie et de la mort, la mort dans la névrose. Par exemple, dans la névrose obsessionnelle, la mort comme accident. Toute la structure obsessionnelle est construite pour ne pas se confronter avec la mise à l’épreuve de mourir comme solidarité de la mort pour tuer. Ou dans l’hystérie, la mort de quelque chose, la mort de l’idéal, la mort d’une place unique. La mort dans la névrose se transforme en guide pour bien vivre dans la perversion. La perversion donne des règles de bien vivre. Et il peut bien les donner puisque c’est lui qui les invente ! La santé mentale est la construction d’un monde pervers. Eh bien, dans cette transformation, la névrose est le négatif de la perversion, se scelle, se cache, ce qui se découvre dans la deuxième partie de la formule : la psychose est le positif de la psychopathie. Et c’est quoi ? Vivre, dit Von Weizsäcker, c’est ce qui bouge. Négatif : sans arrêt, sans pause -Je ne peux pas arrêter de. Positif : en cherchant une pause dans laquelle on peut mourir à, et «de mourir à » donne la vie à la présence de l’absence jusque dans les hallucinations. Le pathique dans son eidologie est cette lutte permanente entre la vie et la mort dans une solidarité réciproque et la santé est une lutte permanente de bien savoir, de bien concevoir cette solidarité. Avec la logophanie, peut-on découvrir la logique passionnelle dans les circuits ? Dans le contact, comment aura lieu la vie de chacun dans la structure universelle du zoe ? Suivons un peu les transformations du bios (la vie de chacun) en zo-os. Ça a commencé avec Foucault, ça a continué avec Agamben et tous les commentaires passionnels, politiques sur la bio-politique. C’est une honte quand on essaye d’être au plus proche de ce qu’est un homme dans sa dimension pathique si on fait de la politique (pas, le politique !). Suivons ces transformations là et cela déclenche des mouvements passionnels extraordinaires. Une de nos réponses à nous : la psychiatrie, c’est la science et la médecine est une spécialité de la psychiatrie. Dans le vecteur sexuel, et ça, c’était l’énorme trouvaille de Szondi quand, à la célèbre maxime de Freud : « Là où ça était, je dois advenir », Von Weizsäcker rajoute : « là où j’étais, le ça doit advenir ». Coup de génie ! Le corps comme réceptacle dans un moment où le je cède le pas dans une inconscience à la mort à une improvisation du sujet charnel. Ce corps à l’œuvre de vie et de mort, dans, par exemple, l’endormissement. Demandez à toutes les mamans du monde qui restent à aider à endormir un petit bébé… ou même des plus grands qui ont besoin parce qu’ils sont trop excités… dans la danse, ou … le geste cède le pas au ça dans le corps. Ou dans l’autisme… ou dans l’accompagnement de comateux végétatifs. Tout le travail de Michel Balat qui parle de son travail à Bordeaux dans son livre, l’éveil du coma. Dans le vecteur P, la logophanie… Comment la violence est fondatrice et pas seulement destructrice, e-. Comment la crise est transformatrice : hy+. Comment la honte est la face noire de la vie qui bouge : hy-. Et comment le pouvoir est l’ontique de la possibilité pathique : e+. Reprenons le circuit des affects dans sa dimension originaire de surprise de pathique et non pas dans l’ontique à maitriser ou à glorifier. Reprenons le circuit des affects dans son agir de ce qu’il pâtie. Et dans le Sch, reprenons les facteurs de travail, k+/k-. Il y a le travail du deuil, il y a le travail du rêve, et avec Von Weizsäcker, on a compris qu’il y a un travail de la maladie. La maladie ne nous tombe pas simplement sur la tête, mais nous la produisons. Donc il y a dans les circuits la possibilité de faire un travail de pontonnier. C’est notre travail finalement à La Borde. Est-ce que tu dois faire de la pêche ? as-tu de la patience ? est-ce que tu es débordé et est-ce que tu dois faire autre chose… pour ne jamais rien foutre… sauf d’être là ? est-ce que tu as une certaine connaissance de garagiste, un petit peu quand même… ? et est-ce que tu es capable de faire des ponts et ne pas rester cloisonné dans tel ou tel service avec une pyramide hiérarchique… est-ce que tu es capable de faire un travail de pontonnier pour permettre dans le Sch que le dilemme moi/autre ne se résout pas à une forteresse du Moi et une transparence de l’autre ? Le dilemme est un mouvement passionnel antélogique où l’autre est l’opacité du Moi et le Moi l’instance du pathir. Comment écrire ça ? … on écrit des petites monographies, quelques feuilles sur les gens dont on s’occupe. Pas une vignette clinique. Non ! ça suffit les vignettes cliniques où la symptomatologie n’est là que pour montrer, démontrer le bien-fondé d’une hypothèse métapsychologique. Non ! Pas un dossier où l’accumulation d’informations a comme fonction de standardiser les faits divers et d’ordonner une transmission transparente et d’offrir une scène d’évaluation. Non ! Pas une biographie où la vie de quelqu’un se construit comme la représentation d’un personnage, l’histoire de sa vie se réalisant dans une mise en scène de personnages. Non ! mais plutôt une pathographie où la vie de quelqu’un se construit comme une mise en forme, une gestaltung, d’une présence pathique. On va essayer d’écrire son antélogique à vivre dans la crise. La vie est crise. Les centres de crise, quelle connerie ! c’est surtout une énorme connerie quand on va mettre ça dans une structure logique. La vie est crise, la vie en crise est le lieu de transformation de la vie et de la mort, de subir et de faire de la maladie accessible dans la réciprocité, et c’est ça la pathographie, de la narration et du savoir médecin/malade. 19 OCTOBRE 2012
Elne, le 19 Octobre 2012. La dimension du moi, le Sch, et le narcissisme du ça. Marc Ledoux Ce soir, j’introduis le Sch, la dimension du moi et la psychose et le narcissisme du ça. Ce sera un peu tralala, un petit peu des mots. Mais vous en entendez toute la journée, des mots. Si vous ne comprenez rien, ça ne fait rien. Ca va venir et si ça ne vient pas, ça ne fait rien. Freud, Szondi, et Schotte, autour du Moi. Je pense que tous les trois, à des époques différentes et dans des constellations différentes, tous les trois ont réagi chacun à leur manière, contre ce qui est à la mode et ce qu’on oublie sans le savoir et sans penser ce qu’on fait autour de la psychologie du moi. C’est quoi ça ? C’est compliqué pour nous dans la langue germanique. C’est compliqué. Pour traduire de notre langue à nous, Ich, Je, vers cette langue française, moi, je. Le moi, cette instance centrale de la personnalité promue par l’homme moderne qui se pense comme moi, c’est-à-dire comme sujet psychologique. Vous savez, en psychologie, il ne faut pas réfléchir pour faire la différence entre je, moi, sujet, etc. L’homme moderne fait de la psychologie dans la façon de considérer ses semblables et de se considérer lui-même. Chacun a sa psychologie. Avoir. Le sujet a une série de caractéristiques mentales ou comportementales, qu’un psychologue peut objectiver. Le moi est sujet et objet de cette vue moderne de l’homme par lui-même. Quelles sont les conséquences de cette idée ? Cette autopromotion produit des sciences techniques modernes centrées sur l’opposition sujet/objet. C’est énorme ce passage dans l’histoire. Le sujet objective la nature pour l’étudier dans une physique et le sujet est étudié au même moment, corrélatif, le sujet est étudié comme un objet. Donc la psychologie est d’une part le corrélat des sciences de la nature et d’autre part, elle est la base de toutes les sciences de l’esprit. Ce mot va revenir chez Kierkegaard, de l’esprit. Avant, cela n’existait pas. Le premier à se penser lui-même, c’est dans la modernité, ça, à se penser lui-même en fonction d’une psychologie. Il y a trois figures complémentaires de cette idée de l’homme moderne. D’abord, une figure – c’est un mot qui revient souvent chez Freud, figure. On va baptiser le sujet cartésien. C’est la première fois chez l’homme moderne qu’un sujet peut douter. Donc le sujet du doute et de la certitude de savoir. Ça veut dire quoi ? La première figure de l’homme moderne, c’est le moi du sujet qui juge. Deuxième configuration : Luther. Il a fait des choses, lui. Les conséquences sont énormes. L’homme de la réforme religieuse. L’homme de la réforme promeut, pour la première fois, l’individualité du sujet comme moi. Ça veut dire quoi ? Comme si cela ne suffisait pas… le sujet, le moi, … et hop, un sujet avec une propre individualité. A partir de là, il ne va pas arrêter de se gonfler, celui-là… qu’est ce qui se passe chez Luther ? Chacun a à faire son expérience personnelle. C’est la première fois que l’accent va être mis sur l’expérience. C’est Luther. Chacun, ayant à faire son expérience personnelle de dieu, sans médiateur. Chacun est aussi proche que chaque autre du message biblique. Dès lors, dit Luther, personne ne peut s’interposer entre ce message biblique et son semblable. Et c’est dans cet article célèbre de Johannes Lohmann, qui est un linguiste et un historien, le rapport de l’homme occidental au langage,— qu’on a traduit —, qui repère que Luther, en traduisant la bible dans la langue allemande, fait subir aux notions grecques un retournement ! Qu’il traduit comme il pense à partir d’un sujet autonome, qui ne connaît qu’un critère pour distinguer le vrai et le faux : c’est-à-dire sa propre expérience. C’est Luther qui a introduit ça en traduisant la bible. Il va promouvoir le sujet autonome, il va promouvoir le moi d’un sujet qui juge. Désormais les critères vont être sa propre expérience dans son rapport à dieu. L’homme moderne, dit Lohmann, est celui qui s’avance comme sujet conscient et qui veut être conscient de ses expériences. Il se veut être le sujet passif et actif de l’expérience qu’il fait. En nous, s’enrichir comme sujet, c’est de faire des expériences. Ça vient de Luther. Et la troisième configuration qui est terrible : Moi, je. Ça se modifie quand on met une virgule, mais la plupart du temps, on ne met même pas une virgule. Moi je. Les grecs, ils tombent des nues quand ils entendent ça. Ça n’existe pas chez les grecs. Le pronom personnel n’est pas explicitement marqué, jamais ! Pour les grecs, c’est le verbe par sa terminaison qui désigne la personne sans que soit avancé le moi. Le moi n’est pas chez les grecs le centre producteur de la pensée. Bien sûr qu’il existe le moi. Mais il existe pour empêcher la pensée. J’explique : s’il y a le moi chez les grecs, c’est parce qu’il se met trop en avant, et à ce moment-là, il devient le sujet de l’opinion. Et de là, Lohmann dit la doxa est l’œuvre du moi : l’opinion. Quand je dis « moi, moi, moi, », on est bien parti dans la doxa, là. C’est bien de faire des groupes de travail, c’est bien de faire des groupes de tout ça… comme ça, chacun peut dire son opinion, moi moi… on est dans la doxa. Plus on avance, et plus le moi s’exprime, et plus il est sujet de l’opinion. « Donne moi ton opinion, ose dire ton opinion…! ». C’est ça pour les grecs. En français, ce redoublement, dit Lohmann, est un paradoxe qui empêche de vivre, dans l’affirmation : moi, j’aime. « Mais, moi, je t’aime ! »… C’est possible, ça ? Que le moi, qui va dominer l’acte d’aimer, est ce que ce n’est pas plutôt un empêchement d’aimer ? … Moi, je… t’aime… Freud avait du génie ! Il souligne, notamment dans l’amour, tout ce que cela comporte, — moi, je — que l’homme moderne, c’est le sujet, le moi c’est le sujet, le je, etc., etc., individualisé, et toutes les connotations modernes. Freud souligne combien tout cela comporte de narcissisme, d’empêchement à cette possibilité d’être lié au pathique de l’amour, à la passion de l’amour. Quel amour ? D’être lié aux illusions, et voilà. Il y est. Et dans la phrase classique, à toutes les sauces : Le Moi n’est pas maître dans sa propre maison. Bien sûr, qu’il y a une énorme évolution avec Freud. Et comme a fait Lacan, de diviser Freud en I II III, qu’on a repris. Freud, dans les trois essais sur la sexualité, jusque là, il ne se pose pas trop de questions sur le moi. Je vais vite, là. C’est une instance un peu conflictuelle, déjà, il utilise le mot « conflit », avec les forces de l’inconscient, la vie sexuelle, etc. mais, pas trop encore. Mais, comme c’est un génie qui va lancer les choses sans les penser directement, ça l’embête, ce moi de la psychologie. Il va essayer de le mettre en mauvaise posture. ‘Non, dit-il, on ne peut pas faire des fonctions du moi, comme la psychologie le fait. Où tout est centré sur le moi… non, on ne peut pas ». Et on voit bien après, avec l’ego psychologie des américains, la psychanalyse, c’est un ensemble de fonctions du moi centrées autour du moi. –ce n’est pas bien. Mais dans la pratique de la thérapie, oui, il y est, c’est là où il est génial. Il va mettre le moi entre parenthèse. Il ne dit jamais « que ton Moi parle ! ». Non, « dis tout ce qui te passe dans la tête ». Et il va réagir contre l’idée de l’homme moderne « ne jugez pas ! » car comme on disait, dans le sujet moderne, c’est le sujet cartésien qui juge… Lui, il dit « ne jugez pas ! » mais il ne savait pas encore trop comment faire, comment construire cette instance qu’il va décentrer. Mais dans la règle, dans quelque chose qui nous pousse pour pouvoir avoir la possibilité d’exister, simplement, il dit « dites ». En plus, il donne un très bon antidépresseur. Il dit « je ne suis pas pour le volontarisme ! ». Il ne dit jamais « allez, je vais t’aider à y arriver, je vais t’aider à parler, je ne sais pas comment… ». Non ! Voilà ! Dans cette intuition qu’il a de décentrer le moi au niveau de la dimension thérapeutique et c’est ça qui va lui apprendre à entrer dans le… narcissisme. Et là, Freud II. Des notions propres qu’il va développer là, et moi, je trouve, qu’on ne peut pas délier les notions du moi de l’identification. Donc au niveau du moi : le narcissisme et l’identification. Dans ce passage entre les trois essais de la sexualité et introduction au narcissisme, ça a du être quelque chose dans sa tête ! Quand on le suit, ah !, il y a un mot qui apparaît, superbe… je suis désolé, les français, mais vous en avez fait n’importe quoi de ce mot… vous êtes tellement intelligents que vous avez oublié la simplicité de ce mot. Le mot : Vorstellung ! Oui, vous l’avez traduit par représentation. Et une fois que vous avez trouvé le mot représentation, vous ne savez plus quoi faire… représentation, représentant, représentatif… et ça commence à être compliqué !... et alors Freud rajoute vorstellung, représentance. Il y a autant de traductions que de gens qui essayent de faire des théories de cette affaire. Ce n’est pas de ma faute, hein ? Comme toujours chez Freud, c’est toujours simple ! C’est la langue dans sa dimension de tous les jours. L’idée de vorstellung. J’explique. Cela doit s’entendre dans le sens théâtral. Une représentation théâtrale. D’une pièce de théâtre ! ça se trouve où ça ? Ah ! Quand on est fidèle à son épistémologie, à sa logique, « il n’y a pas de discontinuité entre le normal et le pathologique et j’utilise l’image du cristal », vous connaissez ? Je ne vais pas répéter ça. C’est quand on tombe malade, quand la maladie nous frappe, elle va nous rendre manifeste quelque chose de présent en nous qui était caché ! c’est comme le principe du cristal, on a le vase, on ne sait pas comment c’est, et on le casse, et on voit la structure, les fissures. C’est pareil, pour l’être humain ! C’est quand ça casse qu’on est témoin de comment on est structuré. C’est dans l’hystérie et dans les rêves que l’on va voir comment les représentations fonctionnent. Et bien sûr qu’il est en train de lutter. Il y avait des empiristes, comme Jung par exemple ! Bien sûr, Jung qui avait déjà utilisé aussi le mot Vorstellung. Il va prendre aussi le terme classique, quotidien « je vais au théâtre », « je vais à une vorstellung » et en même temps, il va voir chez les empiristes qui appellent l’ « atome » de la vie psychique, vorstellung. En disant que la vie psychique n’est pas faite de réalités matérielles mais de représentations. Et c’est justement par l’hystérie et le rêve, et le langage de chacun qui va transformer cette notion d’ « atome » chez les empiristes. C’est sa logique, son épistémologie classique. Il prend le mot « vorstellung », il le transforme des empiristes, il l’utilise dans le langage commun de tous les jours dans le sens théâtral, et il va parler, avant de parler du narcissisme, de la représentation du moi. L’hystérie, dit-il, je cite, apparaît comme un phénomène théâtral, l’hystérique se met en scène dans ses symptômes. La vie onirique montre le moi, se représentant toutes sortes de choses et se représentant lui-même dans les scènes qui se déroulent sous les yeux, tout en se cachant, — on est dans le théâtre ! — derrière l’identité de divers personnages mis en scène. Il y a un très grand Pirandello qui a pris cette phrase comme fil rouge, comme leitmotiv de la construction de cette pièce de théâtre ! « Se représentant soi- même en se cachant derrière l’identité de différents personnages ». Donc le moi se cherche en se représentant de diverses manières. D’où, dit Freud, l’importance de la notion d’identification. L’homme est jeté dans cette tâche de devenir ce qu’il est, de s’identifier à ce qu’il est comme ce qu’il est. Donc de s’identifier tout court. Et on voit tout de suite ce caractère extrêmement problématique de cet être qui n’est qu’en s’identifiant. Devenir, dit la phénoménologie, devenir ce qu’on est, et on est ce qu’on devient. On devient ce qu’on est et on est ce qu’on devient par l’identification. Et c’est cette problématique-là, cette péripétie-là, que Freud, petit à petit, va repérer. Grandes différences dans les verbes. Le moi ne doit pas se conserver, ça c’est Freud I, cette problématique d’autoconservation… Non ! Le moi doit se constituer. Et constituer en allemand, ça veut dire « erhalten», ça ne veut pas dire constituer dans quelque chose de génétique. Vous les français, tout de suite, toujours, non, je n’ai rien contre les français, je m’excuse, mais dans la langue, dès qu’un français entend « constitution », il dit « ouh là là, on est dans quelque chose de génétique… » Mais, non ! Erhalten : cette dynamique de s’obtenir soi-même ! Se constituer… il n’a qu’a s’obtenir, et non pas se conserver, le moi. Je suis désolé mais Freud, pour lui, c’était l’allemand. Donc, quand il dit « se constituer », il veut dire « s’obtenir soi-même, petit à petit à travers cette dialectique narcissisme, identification, etc. ». En jouant du théâtre. En rêvant, etc. Donc le moi doit se constituer et non pas se conserver. Il n’est pas donné d’avance ! Pour se faire, pour pouvoir s’obtenir, j’écris un mot que j’espère que vous allez garder, ... soi… ipséité… très important pour nous, il doit se constituer. Pour se faire, — et c’est là Freud spéculatif, c’est un penseur —, pour se faire, il faut un acte psychique. Il va trouver la nature de cet acte dans le modèle du narcissisme, simplement. Donc, il faut trouver quelque chose, un mot, une scène, pour pouvoir se constituer. Cette scène, il appelle ça un acte, comme Lacan disait « l’acte psychanalytique, c’est une scène ». Pour nous la question est alors comment lier le narcissisme et le vorstellung, la nature représentative du moi. Quand je préparais ça pour vous, je trouvais ça difficile. Je suis désolé, je vous demande pardon. La nature, dit-il, représentative, mais c’est important pour la psychose, parce qu’on y est… Quand le psychotique, dans sa dramatique, vit la déchirure entre « ne pas pouvoir réaliser l’impossible et en même temps, ne jamais pouvoir y renoncer ». C’est quoi l’impossible ? Et bien, chez Freud, on y est déjà. Quand il essaye de faire le lien, dès le début, entre le narcissisme et la nature représentative du moi. Et quand je préparais ça dans un français complètement bidon, mal écrit, mal dit, et je demande pardon, c’était pour essayer de trouver des mots chez lui, de cette dramatique « essayer de réaliser et ne pas pouvoir renoncer à réaliser ». L’identité du sujet, dit-il, et si vous avez suivi, c’est exactement l’inverse de ce que fait la psychologie du moi, l’identité du sujet c’est que son moi est déjà un substitut. Le moi est déjà sa propre représentation comme on disait tout à l’heure. Le moi n’est jamais que son propre substitut. Au moment où il devient saisissable de l’intérieur, il est déjà substitut de quelque chose, qui le précède ! Et alors, il va utiliser un mot, — que j’entends rarement, mais je ne lis peut-être pas les bons livres — il est déjà substitut de quelque chose qui le précède, mais qui n’est pas figurable, et qui ne devient figurable qu’en se perdant. Tout à l’heure, je dirais quelque chose sur le terme de figuration qu’il utilise. Pour lui, le narcissisme, je vous l’avais promis la dernière fois, le narcissisme se substitue, — c’est la terminologie de Freud, il aurait pu en choisir un autre, à la limite, il s’en fiche —, le narcissisme se substitue à une activité auto-érotique où quelque chose est en train de naître. Le moi est constitué par cette activité. Et à un moment donné, au moment de la reconnaissance dans le miroir, — et ça tout le monde connaît — il y a séparation d’un avant et d’un après. Après la reconnaissance, il y a un moi… ça, c’est moi. Avant la reconnaissance, c’est autre chose. C’était déjà moi, mais sans le savoir. Et il dit le mot, non encore figuré/figurable. C’est pour vous dire que Lacan a pris certains passages chez Freud, et d’autres passages qu’il a laissé tomber, autour de figuré/figurable. Donc avant c’était déjà moi, mais sans le savoir, non encore figuré/figurable, et après la reconnaissance, il est déjà substitut d’autre chose. Le moi était déjà en représentation au moment où il arrive à se représenter lui-même. Il est déjà sur la scène, il est déjà en train de jouer son rôle, il est déjà en représentation au moment où il arrive à se représenter lui-même. Et on est exactement dans la logique de la psychose, mais comme un phénomène universel de chacun de nous, qui pour nous n’est pas toujours un échec. Il naît comme substitut de ce qui n’arrivera jamais à récupérer tout à fait lui-même. Peut-être que d’autres vont essayer de récupérer mais on sait ce que ça donne… les autres vont commenter une mise en forme d’une expression de quelque chose qui n’est jamais à récupérer pour quelqu’un… et on va en faire… je ne sais pas quoi… ça… ça c’est un délire de persécution, de grandeur… Donc le moi naît d’un substitut de ce qu’il n’arrivera jamais à récupérer tout à fait lui-même mais il ne pourra jamais renoncer non plus, à essayer de récupérer. Donc, on est dans cette dimension psychotique universellement humaine. On essaye toujours de courir après quelque chose qui est définitivement perdu. Mais qu’on arrête !! Mais non ! On ne peut pas ! Et c’est là qu’il commente le terme de figure et de figuration. C’est la même chose que vorstellung. C’est un terme théâtral. Figuration veut dire l’articulation d’une figure. Par exemple, dans « mais, qu’est ce que vous vous figurez ? » c’est juste ça ! C’est compréhensible ? « Qu’est ce que vous vous figurez ? » C’est la résonnance, dit Freud, d’une illusion. C’est dans de telles figurations, c’est dans de telles résonnances d’apparence d’illusion, que va apparaître le moi. Une souveraineté, je le cite, une souveraineté imaginaire de cette autofiguration. Superbe ! Pourquoi Szondi utilise t-il des images ?... pourquoi ?.... une souveraineté imaginaire, des images ! de cette autofiguration, de se créer des illusions, résonnances d’illusions. Moi, je t’aime ! Mais, c’est fini les illusions, je vais maîtriser… ah, ça ne marche pas l’amour !... mais si on peut rester lié dans l’illusion de courir après quelque chose qu’on ne récupérera jamais mais qu’on n’arrêtera pas non plus d’essayer… même si ça ne marche pas… mais, c’est l’amour ! Pourquoi dit-il que le moi devient objet ? Ce moi qui apparaît, devient objet. Avec Jung. La guerre était là entre les deux. Et Freud va dire que le moi devient objet. Et objectivé plus tard et maintenant, nous toujours, et quand on parle, qu’on s’écoute, si c’est possible, comment on fait pour objectiver le moi ? Comment on fait de la psychologie en étant psychanalyste ou je ne sais pas quoi… pareil ! Parce qu’on va annuler d’où il vient, ce moi ! Et Freud était génial quand même ! Il dit « c’est quoi le moi quand tu deviens objet ? » « C’est quand tu deviens l’idéal ! Il va s’aimer soi même ». C’est quand le moi, dans le modèle du narcissisme dans l’eau, va tomber amoureux de lui-même. Quand il devient objet d’amour propre. C’est à ce moment-là qu’il appelle le moi, un objet. Quand il est idéalisé. C’est parce qu’il y a de la figuration dit-il, cette articulation d’une figure « mais qu’est ce que vous vous figurez ? », c’est par cette thématique de la figuration qui est de l’ordre de l’idéal, que peut se dire que le moi devient un objet. L’homme, dit-il, est un animal pas fixé, à la Nietzche. L’homme pas fixé se constitue selon des idéaux. « Je me figure dans un rôle... d’Isabelle Huppert. Je me figure dans un rôle de … je ne sais pas qui…» Il se constitue selon un idéal. Ce que l’on se figure, c’est toujours ce que l’on aime à se figurer. Narcisse est amoureux de son image sans savoir que c’est son image. Et le plus beau texte, que moi, personnellement, tout petit que je suis, c’est le texte de Gide sur le narcissisme. C’est génial. Il est amoureux de son image sans savoir que c’est son image. Et Freud ose se poser la question la plus difficile au monde : et le rapport moi/l’autre ? Ce rapport est réversible dit Freud. Moi, l’autre, l’autre, moi. Est ce qu’il dit beaucoup plus ? Non, mais il pose la question fondamentale. Le modèle du narcissisme fonctionne à l’intérieur de tous les rapports inter humains, bien sûr. Ça fait couler beaucoup d’encre qu’il n’y a rien de plus dangereux que le face à face dans les rapports interhumains. Quand on est avec les psychotiques et qu’on essaye de vivre avec eux, pas de les recevoir une à deux fois par semaine, ce n’est pas la peine, mais quand on essaye de vivre à côté, ne les regarde jamais ! Cela n’empêche pas que eux, ils vous regardent. Mais, vous, payés pour être à côté d’eux, quand vous essayez de les regarder, ils vont vite se détourner de vous. Parce qu’ils savent ce que c’est, le face à face ! C’est Husserl, le phénoménologue, qui avait parlé avec un thème un peu difficile, la marge… essayez toujours, quand vous êtes avec un psychotique dans la vie quotidienne, d’être à la marge, dans quelque chose de marginal... Pas face à face ! Quand on est avec l’autre comme mon semblable, « ah, celui-ci ressemble à son papa ou à sa maman… » il est à peine né, que déjà il est dans la figure de quelqu’un d’autre ! Le narcissisme du névrosé est déjà là, avec ses grands sabots. Dans nos rapports de face à face avec mes semblables, le narcissisme, dit Freud, superbe, le narcissisme s’introduit par surimpression. Génial ! Mais c’est difficile quand on lit ça pour la première fois ! Qu’est ce que cela veut dire ? Dans mes rapports avec l’autre, il s’introduit par surimpression ! Quand même, il faut quand même une base, on ne peut pas vivre sans narcissisme … Et Freud ne sait pas très bien comment faire. « Je dois l’articuler dans mon rapport avec l’autre, parce que l’autre c’est lui-même, mais comment ? » en surimpression ? Mais alors, ça tue le moi… comment faire ? Et alors, génial, il va appeler la psychopathologie de la vie quotidienne, la vie amoureuse… à travers toute son œuvre, on va toujours retrouver à des moments difficiles, quand il essaye d’articuler quelque chose, il va retomber sur la vie amoureuse… c’est génial ! Les amoureux se regardent dans le miroir des yeux du partenaire. C’est toujours la même phrase qui revient du début jusqu’à la fin de sa vie. Et dans la perversion sadomasochiste, dans la perversion de couplage où le voyeuriste et l’exhibitionniste, où le sadique, toujours cette phrase va revenir, c’est comme un repère pour lui ! J’essaye de me figurer comment il pense, comment il essaye d’articuler ce questionnement impossible. Le sadique jouit aussi bien de sa propre activité que masochiquement à travers le regard de celui dont il fait un voyeur. Il peut trouver une quadripartie. Ou bien dans la mélancolie, c’est la première pathologie qu’il a questionnée jusqu’à la fin, « il s’accuse ! » mais il s’agit d’accuser l’autre en lui. Dans le train, cet après-midi, je me suis amusé un petit peu… je n’avais jamais lu le livre d’Agamben, « Nudités », je pense qu’il vient de paraître… sur la calomnie. Et l’étymologie de calomnie, c’est accuser. Et comment à travers Kafka… ce K ce n’est pas le nom, ce n’est pas la majuscule du personnage, mais c’est la majuscule de calomnie… je ne savais pas ! Je me suis amusé, je rigolais un petit peu. Alors le mélancolique, il s’accuse, mais il accuse l’autre en lui. Et en s’accusant lui-même, il devrait, dit Freud, tirer les conséquences auto-correctrices qui s’imposeraient normalement. Ce dont il s’abstient. Car soi-même est devenu l’autre, et l’autre est devenu soi-même. Et Freud dit que dans la mélancolie, l’autre est devenu le substitut de moi et que moi-même puisse devenir le substitut de l’autre, on est dans l’identification. On va s’identifier à ce que l’on est ! Et Freud oublie quelque chose, et c’est dans cet oubli que Szondi va arriver : au lieu de dire s’identifier à ce que l’on est, Szondi dit : « s’identifier à ce que l’on a. » Le verbe avoir. Nous, hop, comme des…, qu’on guette, qu’on chasse… on va chasser les auteurs… Bloch qui dit : « je suis mais je ne m’ai pas. C’est pourquoi nous devons devenir ! » Mais il n’y a pas que le passage de être à avoir, mais aussi le passage impossible à franchir de je à nous. C’est facile de se moquer du nous, c’est facile de se moquer de Binswanger qui a mis toute une potentialité sur le nous… oh, le nous, le nous, le nous… est-ce qu’il y a un au-delà du narcissisme ? Dans la pratique, je n’en vois pas beaucoup. La question fondamentale pour Binswanger : est-ce qu’on peut être à côté d’un psychotique quand on ne les aime pas ? Dans le je, dit-il, dans le « je suis », le « je » est encore indifférencié, c’est le « je » d’avant la reconnaissance de soi. « Je suis déjà là » mais il est un peu entre parenthèses mais il ne quitte ses parenthèses, dit Bloch, qu’au moment, et là on est dans la perversion, qu’au moment, où il se dédouble et se prend pour objet. C’est-à-dire, « je m’ai en vue… » Dédoublement de la reconnaissance dans le miroir dirait Lacan. « Je m’ai en vue… » Et cet avoir vient différencier l’être indifférencié qui précède. Cela ne peut se faire, ce passage, de être à avoir, qu’à l’intérieur d’une société humaine. Peut-on, dit-il, peut-on traverser le narcissisme ? Lacan avait raison quand il disait que les symboliques sont les idéaux. C’est l’idéal, les idéaux, idéaliser, désidéaliser… c’est peut-être ça traverser le narcissisme avec le peu de moyens qu’on a. Tous les symboliques, c’est cette dynamique là. Et c’est à ce moment là que Freud va utiliser simplement des termes techniques et c’est là qu’il utilise le « narcissisme du ça ». L’acte psychique propre par lequel le moi se constitue, c’est le passage de l’auto-érotisme au fonctionnement narcissique, au narcissisme du moi, qui veut dire la même chose mais qui est un terme technique. Ce qui est en deçà du fonctionnement du moi est « le narcissisme du ça » : c’est l’état de Narcisse qui se contemple dans le miroir aussi longtemps qu’il ne sait pas que c’est son image qu’il contemple. C’est un fonctionnement auto-érotique du sujet jouissant, sans savoir qu’elle, l’image, est productrice de cette jouissance. Et là, coup de génie, et pour nous Szondi, etc., c’est la base de ce qu’est la psychose, je cite Freud : ce sujet jouissant, sans savoir qu’il est producteur de cette jouissance, il s’agit d’une ipséité, d’un soi non encore qualifié de tel, qui n’a pas encore figure du moi, qui n’a pas encore pris figure d’être le moi d’un soi. Ne vous en faites pas, je vais revenir là-dessus. Peut-être est-ce la définition la plus vertigineuse de toute la philosophie quand Kierkegaard a parlé du soi. Et Freud dit sur le narcissisme du ça : c’est l’advenue d’une ipséité d’un soi non encore qualifié de tel, qui n’a pas encore pris figure d’être le moi d’un soi. Retenez le pour le moment, bêtement. L’acte psychique qui va constituer le moi dans cette situation narcissique va, et après c’est Lacan qui arrive et introduire les deux pôles, celui qui regarde, qui est regardé, l’intérieur, l’extérieur, avant, après, des foyers de fonctionnement de reconnaissance, des fonctions de zones érogènes, etc. c’est là où il parle du moi refoulant qui va s’enfermer dans son for intérieur, le moi châtelain, mais en même temps le moi refoulant va être refoulé, il va se produire des contrecoups de refoulements… c’est son vocabulaire technique qu’il va utiliser là. Il va arriver à une spéculation extraordinaire, sur la nécessité du refoulement originaire, cette opération nécessaire pour que le moi puisse se constituer ! Et Szondi, qu’est ce qu’il fait ? Il va regrouper dans cette soupe de Freud un premier schéma, un circuit, un déroulement, un devenir du moi ; ça, il l’avait bien compris, le moi n’est pas défini, le moi n’est pas constitué, le moi n’est pas là, il n’est pas là pour conserver, il n’est pas là pour protéger des ennemis, le moi châtelain,… non ! Le moi sera refoulé. Il va regrouper dans un circuit des notions qu’il avait trouvées chez Freud :
Deuxième chose géniale : ces deux dimensions défensives et identificatoires sont conçues selon le modèle du cristal. La psychopathologie défile sur deux séries de notions, les notions de psychiatrie et de psychanalyse qu’il va regrouper. C’est lui qui dit qu’il n’y a pas de psychiatrie sans psychanalyse et il n’y a pas de psychanalyse sans psychiatrie. Ce n’est pas récemment qu’on a inventé ça. Comme on ne l’a jamais lu, il n’existe pas… et comme ceux qui l’ont lu et les autres ne l’ont pas lu, ceux qui l’ont lu n’existent pas… Donc la psychopathologie défile sur deux axes de notions la psychiatrique : la psychose, la névrose, la perversion, la manie etc. et la psychanalytique, les différents mécanisme constitutifs dans leur fonctionnement de ces états morbides. Je vous donne un exemple : bien sûr qu’on connaît bien, Freud l’a toujours dit, et tous les gens qui ont commenté Freud comme un mécanicien. Ferenczi a commenté Freud comme un mécanicien. Freud a donné cette possibilité, c’est vrai. Par exemple, le rapport entre la névrose et le refoulement. C’est vrai qu’on voit tout près comment ça fonctionne dans la névrose. Dans la névrose obsessionnelle par exemple, on voit tout près le refoulement. Donc le principe de cristal ne fonctionne pas seulement pour les syndromes mais aussi pour les mécanismes, les fonctions k et p k- p0 Le k- fonctionne particulièrement dans la névrose mais c’est aussi une réaction universelle humaine. On le voit bien dans le principe de cristal. C’est très manifeste k- : le négativisme : non, non, non, j’ai bien envie de me risquer mais non, non, non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne peux pas, je n’ose pas… il faut que je m’adapte à ce qu’on attend de moi. Tu t’imagines ce que vont dire mon papa et ma maman quand ils vont apprendre ce que j’ai envie de faire… non, non, non… k- ! On peut en tomber vraiment malade. Un héro de pantoufle ! Quelqu’un qui ne fait que d’adapter, qui correspond au jugement de l’autre. C’est un mécanisme universel, manifeste dans telle ou telle maladie. Donc, Szondi invente le circuit suivant : p- p+ k+ k- : quatre fonctions de l’être humain au niveau de la manière dont le moi va se constituer. Troisième chose que Szondi invente : c’est la dialectique entre être et avoir. Il prend ces termes, je suis désolé, il prend ces termes à la physiologie du cœur : être c’est diastole, et avoir c’est systole. Etre expansif, et avoir contracté. Etre : p. p- p+ c’est dans l’être, quelque chose d’expansif, de participatif, d’indéfini, d’infini. Ce qui doit être, un idéal, ce qui doit être est en danger de ne pas le devenir. Quelle souffrance pour un psychotique ! Je dois être à la hauteur ! ipse. Celui qui a écrit Solness, le constructeur, Henrik Ibsen. Sa pièce qui m’a le plus parlé, Solness. Ce qui doit être est toujours en danger de ne pas le devenir, de se réaliser. Etre quelqu’un… tâche problématique de chaque être humain. Comment peut on devenir ce qu’on doit être ? Et on est dans les verbes pathiques : pouvoir, devoir. C’est dialectique, c’est le drame de l’homme psychotique : comment peut-on devenir ce qu’on doit être ? C’est là où l’être humain est le plus singulier. C’est la raison pour laquelle on a changé le circuit ! Ce n’est pas possible que le circuit finisse avec le k-, avec une position réaliste, une position de s’adapter et de renoncer pour correspondre à ce qu’on attend de moi. Nous on a changé et on a fini le circuit par p+ ! Cette tâche impossible pour chacun de nous, c’est là où il est vraiment humain ! Et c’est là où on le trouve dans sa dimension psychotique, sans nécessairement en tomber malade… bien sûr que les pervers sont là pour le résoudre le problème ! « Comment ça, un problème ? Vous êtes fou ! Vous voyez partout des problèmes… ». Il y a des façons réalistes, pas idéalistes !, de solution à ce problème humain ! On est quelqu’un quand on a quelque chose, quand on fait quelque chose, quand on possède quelque chose, etc. etc. Dis-moi ce que tu as et je te dirais qui tu es, dis-moi ce que tu possèdes etc. Tu as des diplômes ? Tu possèdes une femme, des maisons, des enfants…? Je dirais qui tu es… c’est déjà une perversion de la question. Pour être quelqu’un, d’avoir quelque chose est à la fois résoudre la question et la pervertir, si on oublie tout ce qui dans l’être, transcende l’avoir ! Quand on est devant cette question, être quelqu’un et ne pas l’avoir. Ne pas s’arrêter là, ne pas s’arrêter dans cette transcendance, c’est une perversion. Dans cette dialectique, être et avoir dans la psychopathologie de la psychose, Tosquelles parle d’un collapsus de la transcendance. Et se joue ce collapsus dans la confusion d’être et avoir ! Je pense qu’une définition la plus dramatique de la psychose, c’est : au lieu de pouvoir être, et même pouvoir faire, c’est l’inverse : être pu, être fait. Ou au lieu de posséder, être possédé. Dans le délire de grandeur, par exemple, cette mise en forme de cette expression d’être possédé. Ça c’est pour la psychose. Dans la perversion, c’est dans le registre de l’avoir. La perversion dans le passage de être possédé à possédant. On va trouver toujours comme une forme apaisante de vivre cette déchirure dramatique de la psychose, de vivre des failles perverses. Des moments plus ou moins longs de ritualisation perverse, de langage pervers pour essayer de tranquilliser momentanément cette dramatique psychotique. Je peux dire un dernier mot sur le soi. Quel est l’impératif catégorique du moi ? Il a à devenir personnel. Il a à le devenir. Quel est le mot personnel ? Il y a le chapitre « penser l’homme et sa folie » sur la personne… vous n’avez qu’à le lire… amen. Cette nuit, au lieu de prendre un profil, vous prenez ça. On a inventé un mot : la personnation pour le décaler du mot individuation et surtout du mot autonomisation. Quelle horreur ! et encore pour le mot qui est utilisé à toutes les sauces, sans aucune épistémologie… le mot « séparation ». Non ! Il n’y a jamais de séparation. Sauf dans la mort ! C’est tout. Point final. Qu’on arrête ces conneries de séparation. Donc, on utilise le mot de personnation pour, vraiment, bien le situer en contraste avec individuation, autonomisation, séparation. Se parare. Qu’est ce qu’on fait du se, du soi… ça me fout en rogne. La personnation implique, pour le sujet, la capacité d’instaurer, on s’est inspiré de Kierkegaard, et on a pris deux textes « le traité du désespoir » et « la maladie à la mort ». Donc, aujourd’hui, je ne fais pas la pub pour Dostoïevski mais pour Kierkegaard. Je vous oblige pour la prochaine fois à lire ces deux textes … de Kierkegaard, pas de Marguerite Duras ! Donc, la personnation implique la capacité d’instaurer un rapport réflexif à soi. Et c’est là où ça commence. Et ce soi n’a rien à voir, ni avec Winnicott, ni avec Mélanie Klein, ni avec… Toutes leurs thématiques partent d’un soi figuré. Ils fonctionnent dans la problématique de Freud de la figuration. De quelque chose qu’on peut figurer. Qui est concret. Qui se connaît d’elle-même, il suffit d’aller la chercher. Donc, ça n’a rien à voir avec Winnicott, etc. Donc, c’est quoi, ce rapport réflexif à soi ? Et c’est là où on trouve Kierkegaard, c’est là où on trouve peut-être la définition la plus vertigineuse de toute la philosophie. Le soi, l’ipse, c’est une béance… ce n’est pas quelque chose de donné, ce n’est pas une figure, c’est une béance. C’est le mouvement vers lui-même. Ce mouvement est marqué par une déchirure tragique, pour chacun de nous, mais d’autant plus pour la psychose. On trouve partout dans les structures psychotiques, les profils pour essayer de colmater cette déchirure tragique. Je donne la définition du soi : vous êtes obligés — quelle horreur — notez le : l’esprit est le soi. Qu’est ce que le soi ? Le soi est un rapport qui se rapporte à lui-même. C’est une traduction du danois. C’est intéressant pour la mathématique et la logique. Le soi est un rapport qui se rapporte à lui-même. Il n’est pas le rapport, il est le fait, concernant le rapport, que le rapport se rapporte à lui-même. C’est peut-être la définition la plus vertigineuse de toute la philosophie. Kierkegaard est à la fois, dans une admiration absolue à Hegel mais il avait comme devoir de repenser et d’amener Hegel loin des concepts, mais sur la terre. Donc il va utiliser des termes d’Hegel, mais sans en faire des concepts. Le premier c’est l’esprit. Un mouvement vers l’abstraction absolue c’est l’esprit. Et Kierkegaard utilise l’esprit pour le mettre à l’intérieur de nous-même comme déchirure. Superbe ! Dans son livre « Traité du désespoir ». Kierkegaard, il osait ! Il était très malheureux le pauvre. Donc, l’existant pour lui, c’est l’homme qui vit, qui souffre. L’existant, c’est l’homme réel, singulier. L’homme singulier, qui fait, là, quelque chose, et pas quelque chose d’autre, c’est ça l’esprit. L’homme singulier est marqué par l’esprit, ce par quoi, il participe à un monde qui le transcende. Pensez à nos psychotiques ! Ce n’est pas évident pour eux, de vivre dans un monde qui n’est pas le leur. De participer à quelque chose qui les transcende, qui les dépasse. L’esprit, ce par quoi l’homme singulier participe à un monde qui le transcende et qui le qualifie comme homme. « Là, tu ne te comportes pas vraiment comme un homme, hein ? Tu fais n’importe quoi ! » . L’homme est esprit, dit Kierkegaard, c’est-à-dire soi. L’homme est esprit, synonyme à soi, ipséité, pour Kierkegaard, le monde du « soi ». « Soi » est le terme qui recouvre la mise en place de l’existence humaine comme mode de participation à l’esprit. Maintenant, la définition la plus vertigineuse : Le soi est un rapport, et ce rapport, le fait même que le rapport se rapporte à lui-même. C’est là où Winnicott n’est pas... Le soi n’est pas un rapport figurable extérieurement. Le faux self… ça ne rime à rien. Sauf si on dit « c’est un figurable extérieurement ». il y a des critères pour, des mécanismes. Le soi n’est pas un rapport figurable extérieurement. C’est un rapport qui plus originairement se rapporte à lui-même. Donc, il dit que le soi est le fait, et il souligne, le fait même que le rapport se rapporte à lui-même. Ce n’est pas un fait brut mais c’est quelque chose qui est en train de se faire, le fait même que le rapport se rapporte à lui-même. C’est quelque chose qui est en train de se faire, et ce « en train de se faire » est comme tel, rapport à soi-même. Il continue : le soi est dans son surgissement, le fait, ce qui est en train de se faire, le fait que ce rapport se rapporte à lui-même. Et maintenant pour le rendre plus facile, et pour que ça résonne sur un mode de la doxa, de l’opinion, de nos conneries, bien sûr que l’on peut dire que l’homme est une synthèse. Levez le doigt, combien de synthèses vous faites par an ? à Noël, à Pâques, à la fin de l’année ? c’est exactement le contraire de ce que c’est, le soi. Qu’est-ce qu’on fait quand on fait une synthèse ? C’est Maldiney qui disait que les synthèses sont faites pour ceux qui gouvernent. Va chez Proudhon. Et lui parle très bien de la synthèse. C’est pour les gouverneurs ! Oui, mais comme on est tous gouverneurs quand on s’occupe des gens maintenant… donc on peut dire que l’homme est synthèse… il est synthèse de fini et infini, de temporel et éternel, de liberté et nécessité… synthèse, dit Kierkegaard, est le rapport de deux termes, mais ainsi l’homme n’est pas encore un soi. En effet, dans le rapport entre deux termes, et il prend le plus facile, corps et âme, leib und seele, le rapport est le tiers terme, comme unité négative, comme négation de ce qui était posé, comme préfixé. Et chacun des termes, corps, âme, se rapporte au rapport, c’est-à-dire au troisième, comme unité négative ; si au contraire, le rapport se rapporte à lui-même, ce dernier rapport est un tiers positif et nous avons le soi. Il ne faut pas d’abord poser pour nier, le tiers positif est le rapport originaire et il est sa propre position. Cette structure, mon cher ami, quand tu posais la question sur le saut, cette structure du tiers positif, ce rapport originaire, cette structure se met en mouvement, par la catégorie du saut. C’est toute l’épistémologie de notre circuit ; le saut. Donc, il y a la casse, et le mouvement qui va dépasser, qui va transcender la fracture constituée à travers le saut lui-même. Eh bien, c’est la question du psychotique. Mais la dimension psychotique dans chacun d’entre nous. On devient soi-même en se divisant avec soi-même et en se rapportant à soi à travers cette division même. En nous, et on est toujours fous d’essayer de dépasser toutes les divisions, toutes les dualités, pas de les supprimer, parce qu’on serait dans le tiers négatif, mais dépasser, les transcender ou les creuser jusqu’à ce point originaire du surgissement de l’existence à partir de quoi l’existence va se réfracter dans une série de manifestations contradictoires. Et ça, c’est une phrase de von Weisäcker, la contradiction pleine de sens. Une de ces contradictions impossibles à résoudre, et Freud n’arrêtait pas de chercher et il le cherchait trop… une sorte de logique… est ce qu’on peut dépasser le narcissisme ? ça suffisait de le questionner et Kierkegaard le faisait, c’est génial, parce que l’ipséité, le soi ne s’est pas fondée lui-même, l’homme se trouve fondé par et dans un rapport à lui-même. Donc, il y a une tension constante en nous, insupportable pour le psychotique. Une tension constante entre l’ipséité et la puissance qui l’a fondée. Par exemple, cette pensée se manifeste en l’homme entre ce qu’il est et ce qu’il n’est pas. Pour Szondi, entre le destin et la liberté, entre l’éternité et la temporalité… La question pour le psychotique, h-, « ne va pas me dire que quelqu’un m’a engendré… non, h-.. je suis là depuis l’éternité… » la tension permanente entre l’éternité et la temporalité. Donc, il y aune disproportion, un terme fondamental de Binswanger pour s’approcher de la psychose, la disproportion. La disproportion du temps, de l’espace etc. disproportion entre l’ipséité fondée par une puissance autre et, corollaire, rapport se rapportant à lui-même. C’est le moment le plus compliqué. Pensez aux psychotiques, quand on vit avec, on les voit tout le temps dans cette tragédie terrible, l’homme est soumis à une perpétuelle reconquête, à partir d’une fissure. N’appelez pas ça un traumatisme ! Elle est universelle et c’est ça l’être humain. Une fissure. C’est une structure universelle. Il est contraint à un devenir par saut. L’homme est dans un état de désespoir. Désespoir, en allemand : Verzweiflung, superbe terme en allemand. Il y a le mot ‘deux’ dedans : zwei. Désespérément ne pas vouloir être soi-même et désespérément vouloir être soi-même. Quel est le désespoir du psychotique ? Le soi connaît le désespoir dès qu’il veut exister à la première personne. Cette tâche primordiale de chaque être humain de devenir être et d’être en devenir, singulier, en première personne, quelqu’un, par définition, il est dans le désespoir. En faisant l’expérience de son impossibilité car il est fondé dans un autre qui fait partie de lui et en voulant se désaliéner, c’est encore à lui-même qu’il renonce. Si je veux être libre, si je veux me désaliéner, c’est à moi-même que je renonce ! C’est génial cette double articulation entre l’aliénation sociale et l’aliénation psychotique. Elle est nécessaire, elle est universelle cette aliénation, comme dit mon papa, elle est universelle cette aliénation psychotique ! Moi, je lui ai toujours dis : appelle-la, l’aliénation psychotique, C’est là où on est dans la structure universelle humaine qui est psychotique. Quand on veut se désaliéner, on se désaliène à soi-même. Ce désespoir, qu’il appelle dans un autre texte, la maladie à la mort, c’est le risque suprême du soi. Le schizophrène fait l’épreuve du désespoir, toujours, bien avant l’angoisse. Ça, c’est au niveau de la clinique. Bien avant l’angoisse ! Car à quoi, est-il confronté le schizophrène ? Cette tâche surhumaine à laquelle il est confronté fait courir au sujet le risque de se couper de toute identification au dénominateur commun de l’homme. Si je veux exister en mon nom propre, à la première personne, alors il faut que je m’isole. Que je n’aie pas à m’identifier. Et comme on a vu au début qu’il y a ce lien direct entre le narcissisme et l’identification, alors il va se couper du monde. Si je veux exister en mon nom propre, alors je dois me couper de l’identification au dénominateur commun, d’être un petit peu avec et comme les autres. Je me coupe et je vais vivre dans une solitude sans nom. Hölderlin pendant 37 ans dans sa tour, porté par un monsieur extrêmement simple, ce menuisier, superbe… il n’avait pas besoin de toutes ces conneries de prise en charge, il y avait ce pauvre monsieur, qui coupait du bois et qui s’occupait de Hölderlin. Il ne savait même pas ce qu’il faisait. Heureusement ! Et Nietzche ? Cette tâche surhumaine. Et c’est lui qui dit : exister et ne pas exister, c’est la même chose. Et Szondi va appeler ça, cette puissance du devenir. Il utilise un terme latin : le potestas. Dans le p. Amen ! Michel Balat : reste encore un peu. Marc Ledoux : demain, les protocoles… un petit gâteau, une cigarette. Michel Balat : on peut causer, un peu ? Florence : demain, le repas est prêt. La paëlla Michel Balat : c’est magnifique… il y a tellement de choses. Je m’aperçois que je ne comprends pas le cycle… comment on peut partir de p- ? M Ledoux : cette possibilité de participer au monde MB pourquoi ? ML : parce que sinon on ne peut pas exister. C’est nous dans l’autre, l’autre dans nous MB : it begs the question. C’est un cercle vicieux. ML : la possibilité de participer à, de participer de et Freud met l’accent : par la projection. Ce n’est pas juste que la vie commence avec la projection. C’est à partir de là qu’on a élargit la conception diastolique, être comme participation, à partir par exemple, concrètement, comment un peuple se fonde. En Afrique, un peuple se fonde par la possibilité de participer à. La maman qui participe à la vie du village et de la famille avec son bébé. C’est à partir de là qu’il a construit le concept de la participation. L’être humain a la possibilité d’être expansif, diastolique. Je ne vais pas m’enfermer avec mon bébé, mais je participe à. C’est de là qu’il part, aussi bien Szondi que nous, dans le circuit. p- Michel Balat ; après il y a k+ ML : Non, p+, pour Szondi. Il met p+ mais nous, on met k+. La différence entre le circuit de Szondi et le nôtre, c’est que lui met en deuxième position, le p+, inflatif. Vraiment, il n’a pas pigé de mettre ce passage de Freud I et II, la vorstellung. Là, Szondi était copain, un moment donné, avec Jung… même le terme inflatif est de Jung qui dit que l’être humain est capable de tout posséder, il participe. Tout de suite. Cette possibilité de ‘l’être humain de prendre pour lui ce à quoi il participe’. p+. M Balat ; en principe, ça s’arrête… ML : Exact ; et il se mettait en rogne. Il disait qu’on pouvait s’arrêter là. Mais Jung avait raison en partie. Le moi inflatif. On verra demain avec les profils. Je donne des exemples avec p+ !!! Mais pas celui de la dernière fois, non… Dans la vie quotidienne, dans la psychopathologie, ça s’arrête là. Ils ne peuvent pas produire un k+. C’est eux qui ont résolu toutes les oppositions, toutes les dualités, toutes les fissures. Il n’y en a plus. p+. Ils sont homme/femme, diable/ange, dieu/homme. Ils sont tout. MB : dans les deux schémas, tu parles du possible. Tu parles de la possibilité d’être. Dans le p-. ML : la participation ! MB : On est dans un monde qui est déjà là. ML : oui, oui MB : Un deuxième truc, c’est le verbe être. Il se trouve depuis longtemps, le verbe être est quelque chose dont je me méfie comme de la peste. En particulier, à partir des travaux de Pierce, encore et toujours, il dit que le verbe être est un verbe inconstant dans les langues, et qu’on ne peut pas fonder là dessus une conception. Et c’est quelque chose qui rejoint ce que disait Tosquelles qui disait qu’il ne faudrait pas utiliser le verbe être mais utiliser le verbe posse. Par esse mais posse, ce qui me paraît plus intéressant. Si on suit ce chemin, se repose alors la question du p- ML : non, du p+ MB : oui, et donc du p+. Donc qu’est ce que c’est que l’inflatif quand on est dans la dimension du posse ? Public : posse ? ML : pouvoir. La possibilité, la possibilisation. Le transpossible chez Maldiney. Pas possible dans le sens de quelque chose qui pourrait se réaliser. On n’est pas dans la psychiatrie activiste mais dans le transpossible. Laisser ouvert le possible. Oui, bien sûr. Mais l’inflatif, il a résolu le problème du possible, il est. Je suis. MB : quand tu dis qu’il a résolu le problème du possible, il n’y a plus de possible ? ML : non, il est pu. Comme je disais tout à l’heure, le drame le plus terrible du schizophrène est d’être pu, et de ne plus pouvoir être. Etre fait, au lieu de pouvoir faire. Etre fait par le persécuteur, par tous ceux qui ont le pouvoir sur moi, le pouvoir dans le sens sociologique du terme. Cette réduction du possible par le pouvoir. MB : est ce que tu fais un rapport entre ce que Freud appelle l’auto-érotisme et le narcissisme originaire ? ML : oui, oui ! bien sûr. Freud utilise un vocabulaire technique pour essayer de fonder ce qu’il est en train de construire… et le narcissisme originaire, comme le refoulement originaire, c’est un moment spéculatif technique extraordinaire. Bien sûr, c’est l’originaire, où ça s’origine, le narcissisme. Mais pour quoi faire ? Et là, quand même, je crois qu’il faut aller chez Hölderlin, par exemple, pour essayer de trouver du blanc, pour quelque chose d’insaisissable, qui nous précède, parce que le narcissisme est un substitut de quelque chose qui nous précède et qui est insaisissable. Donc Freud a du donner un nom pour le refoulement pour le narcissisme originaire. Et quand mon papa essaye de le saisir dans le vecteur contactuel, dans le sens de faire le pont entre le moi et le contact dans le rythme de la vie, ce narcissisme originaire. Oui, pourquoi pas ? On peut aussi ne pas le saisir et le laisser blanc. Et toute la thématique du blanc, ou toute la thématique du vide. Et Freud n’en parle pas, non, il ne peut pas tout faire. MB : par exemple, le pré-spéculaire, tu le mets du côté de l’originaire ? ML : oui, dans cette terminologie-là MB : ce qui est extraordinaire chez Schotte, c’est de mettre l’origine du côté de la tiercéité… ML : oui, mais l’origine dans le sens d’un saut. D’un saut originaire. Le saut. MB : mais en même temps, cela constitue la source. ML : oui, oui. La possibilité de transcender ce que je casse MB : le saumon ML : le saumon ? MB : le saumon essaye par des sauts de remonter jusqu’à l’origine. ML : à leurs fissures ? MB : oui, parce que c’est là qu’ils sont nés… dans leurs fissures… ML : ah, oui ! on peut aussi utiliser l’image du saut-mont. MB : oui, parce qu’il est né à la source de la rivière. Là, il y a un petit problème sur le traitement de la tiercéité. Quand tu définis le soi comme ce qu’il y a de plus singulier, c’est le fait du rapport de lui-même qui se rapporte à lui-même. ML : oui MB : là, on peut dire qu’on est entièrement dans le monde de la tiercéité. ML : oui, absolument MB : Donc, ça t’amènerai à concevoir le singulier comme précisément du registre de la tiercéité. Tout ça ne va pas sans quelques difficultés… moi, avec mes histoires de Pierce, mais sans doute, il y a quelque cohérence avec tous les gens que tu as cités, mais il y a là des problèmes de tiercéité et de priméité qui sont posés. Par exemple, bien entendu, je trouve remarquable d’avoir trouvé l’idée qui permet précisément d’introduire la notion de rapport pour instaurer l’origine. De la même façon, le pré-spéculaire dans son ensemble ne peut être atteint que par saut, et encore, tu dis qu’on ne peut pas l’atteindre… ML : Non ! MB : donc, on est tranquille ML Mais on ne peut pas non plus renoncer qu’on ne peut pas l’atteindre ! MB : voilà… en même temps, tu dis qu’Oury essaye de mettre le narcissisme originaire du côté du contact. Le même contact que Schotte met du côté de la priméité. ML : la première position du contact, oui. m+ MB : non, non… le contact ML : Non ! non ! MB : oui, je l’ai vu écrit chez Schotte. le contact est premier, le sexuel et paroxysmal deuxième et le Sch troisième… ML : oui, mais la première position dans chaque vecteur, le contact. La première position dans chaque vecteur est contactuelle de l’ensemble du tableau. Ça, c’est la priméité. Mais il y a aussi la position deuxième. Mais il y a aussi la première position dans le vecteur Sch qui est contactuelle. Par exemple, dans la clinique quotidienne, comment ça, il y a quelqu’un qui m’a produit ? je suis mon propre engendrement. La quatrième position. Comme dans le contact, comme dans le sexuel. Quand on dit la priméité dans le contact, on n’avait pas le tableau de Mendeleïev ; après on s’est corrigé avec Jean Marc. Son article dans le recueil du contact. Donc, p- est la priméité, car c’est le contact dans le moi. C’est contacté l’autre. Il n’y a pas de relation avec l’autre. MB : ça me va très bien. Très bien. Ah, j’ai trouvé un verbe … ML : un verbe ? MB : oui, un verbe formidable. En cherchant l’étymologie de la contamination, j’ai vu que beaucoup de linguistes avaient été obligés de supposer un verbe qui est le verbe taminer. ML : taminer ? MB : tu vois, contaminer, les linguistes disent qu’il y avait probablement eu le verbe taminer, puisqu’on dit contaminer… c’est pas con…si je puis dire. Alors, je me dis c’est très intéressant, et je voulais te l’offrir, parce que je pense que cela devrait t’intéresser. Parce que c’est justement le contact, là où il n’y a pas de sujet, le pur contact, sans quelqu’un pour contacter, sans objet… m+, taminer… ML : … oui, merci ! Taminer… ce mot existe ? MB : il est supposé par les linguistes. Tous les bouquins que j’ai consulté… alors, j’ai pensé bien sûr à Danielle Roulot, et tout ce qu’elle écrit sur l’avec schizophrénique. Où elle dit que l’avec est un avec de secondéité ou de tiercéité, alors que l’avec schizophrénique est un avec de priméité… ML : Oui ! MB : on pourrait très bien avoir cette notion de taminer qui serait très à propos dans ses réflexions. Elle devait consacrer un chapitre au verbe taminer. Dis le lui. Parce que, c’est difficile de parler par téléphone avec elle. ML : mais ça produit quelque chose de taminer. Parce que prendre contact, ça produit quelque chose. Pas quelqu’un, mais à quelque chose… MB : justement taminer permet d’éviter l’idée de contact. Parce que contact, c’est foutu. Il y a con déjà, alors c’est foutu. Il y a des ambiguïtés. LJ : isolement MB : non, on n’est pas dans l’isolement. On est dans quelque chose qui est ML : une couleur MB : oui, une couleur ML : pas mal. C’est quel linguiste. C’est quel linguiste ? MB : dans le Ernoux et Meillet. Le dictionnaire étymologique de la langue latine. Et puis aussi, dans le Robert aussi. ML : demain, je le verrai chez toi. Je te le piquerai. (rires)… 2013
10 - 11 janvier 2014
Elne, le vendredi 10 Janvier 2014 La mélancolie Exposé de Marc Ledoux Je vais faire ce soir une traversée sur la mélancolie. Ce sera impossible d’arriver à la manière de Maldiney… à qui j’aimerais faire un hommage. Il vient de mourir. 102 ans. Mais ce sera trop compliqué je crois pour traverser et arriver à la manière dont Maldiney a essayé d’approcher au plus proche la mélancolie, surtout à travers Binswanger. Je ne sais pas si on aura le temps… on verra… On peut dire que la mélancolie c’est en même temps la folie au sens psychiatrique du terme et l’expression de l’âme humaine dans son noyau le plus profond. C’est un mot, c’est une notion qui rend possible, c’est rare, entre la pensée actuelle et la tradition antique à partir de la question universelle : d’où vient la folie, d’où vient le chagrin profond, la fureur, le suicide et où cela nous amène. En opposition avec ceux qui invoquaient une raison surnaturelle ou une punition divine, la pensée médicale donnait la priorité dès l’antiquité à une cause naturelle. Toute la théorie de la bile noire. Je ne sais pas si je dois m’arrêter là, parce que cela demande beaucoup d’explications autour de Platon… toute cette tradition, mais j’y reviendrai pour dire tout ce qui m’a le plus passionné là-dedans. Donc la théorie de la bile noire est le noyau d’une approche passionnelle de la mélancolie qui s’est transformée plus tard dans une approche nerveuse. Le noir, l’oppressif et la lourdeur restent présents comme un continuum aussi bien dans la clinique que dans la littérature. Et donc, c’est à partir de là que je dois être honnête, c’est un cours que j’ai préparé pour Louvain, que je continue à préparer, à partir de cet axe là avec en première partie, l’antiquité, Platon et la doctrine de la manie, Aristote et la doctrine qui est un peu connue de la génialité et… LFC : génial ? M : oui, génial, l’homme et le génie. C’est déjà plus connu ça, ce rapport dans la mélancolie. C’est un petit texte de ce grand livre d’Aristote. Il y a Jacky Pigeaud qui a fait une traduction et un bon commentaire dans ce petit livre : « l’homme de génie et la mélancolie ». Si ce soir on s’arrête là-dessus, on va faire une heure, j’ai pensé, allez lis Jacky Pigeaud et c’est bon, pour ensuite faire celui-là, ce gros livre. Mais si vous voulez, on peut faire Aristote... En 1621, à la fin de la renaissance, il y a ce livre en deux tomes, le livre de la vie, le livre de l’univers : L’anatomie de la mélancolie de Robert Burton. Là, je vais m’arrêter un peu quand même. Et dans une première partie, je voulais commenter aussi un dialogue avec le livre de Gladys Swaine « Dialogue avec l’insensé », un article magnifique qu’elle a écrit sur « Permanence et transformation de la mélancolie. » Dans la deuxième partie, je vais aborder ce qu’est la pensée psychiatrique autour de la mélancolie, avec deux méthodologies : la méthodologie sémiologique avec Kraepelin et la méthodologie typologique, le classique de Tellenbach La mélancolie. Dans mon cours, je continue tout de suite avec une rencontre entre la psychanalyse et la phénoménologie, et puis aussi Binswanger et son livre difficile Mélancolie et manie. Et surtout Binswanger relu par Maldiney. Je ne sais pas où on arrivera tout à l’heure. Demain, certainement, quand on fera les profils, si vous êtes d’accord, j’aborderai la mélancolie selon Szondi. Alors, je vais vite, je laisse tomber Platon et Aristote, et je viens là, il faut essayer de suivre. Je lis l’introduction de Starobinski, vous connaissez, c’est bien ça, ça fait un an qu’il est là, et c’est un recueil des articles, d’abord sur sa thèse qu’il a fait sur le traitement de la mélancolie et puis après, quand il est devenu critique littéraire et qu’il n’était plus psychiatre, et qu’il a beaucoup écrit sur Burton, et puis aussi sur Baudelaire, Joyce. Qu’est ce que dit Starobinski sur Anatomie de la mélancolie ? Simplement. Pour l’introduire : La publication de Anatomie de la mélancolie, en Angleterre, en 1628,-fin de la renaissance-, à Oxford marque un des grands moments du parcours de la mélancolie. C’est une synthèse géniale qui rassemble tout ce qui a été dit de notable sur la mélancolie en y joignant le rappel des innombrables histoires cliniques, légendaires ou poétiques que cette maladie de l’âme marqua de son ombre et nous offre la somme complète du sujet. … le livre de Burton fut un succès de librairie… c’est l’un des grands textes de la littérature anglaise. Elle se présente comme le livre d’un lecteur –ah ! livre d’un lecteur, pas livre d’un auteur, ça commence-, qui a ouvert une infinité de livres pour composer le sien puis pour le dilater et le compléter. -Il fait partie de la même tradition que Montaigne par exemple.- Ce livre où se déposent tant de mémoires littéraires fut aussi un livre sur ce trésor de langage pour les écrivains –anglais surtout- et surtout un répertoire d’exemples, où dans ce domaine, l’exemple est contagieux. On le sent présent toutes les fois au XVIIIème siècle où il est question de l’English maladie. Keats –superbe- l’a fréquenté et on en a la preuve dans les annotations d’un exemplaire que Keats possédait. L’ode sur la mélancolie de John Keates ! C’est un poème qu’il faut lire ! Superbe. Le traité de Burton appartient à une époque où la langue de la médecine n’était encore qu’une ramification descriptive et spéculative de la physique laquelle se rattachait à la philosophie. Voilà. C’est qui Burton ? Un étudiant, un assistant qui vivait à Oxford. Il a passé toute sa vie dans le collège d’Oxford, il n’en est jamais sorti, il était bibliothécaire et il s’appelle lui même un étudiant éternel qui lit, fait des recherches, qui écrit et qui vit une vie très solitaire. Il le dit « je mène une vie d’étudiant comme Démocrite vivait seul dans son jardin ». Donc, Burton va écrire ce livre sous le pseudonyme de Démocrite. C’est qui Démocrite ? Il y a Démocrite le vieux et Démocrite le jeune. Et Burton écrit sous le pseudo de Démocrite le jeune. Démocrite s’est établi dans la solitude, à l’écart de la ville d’Abdère. Il rit indifféremment de tout. Il y a un grand passage dans la deuxième partie du livre, c’est peut-être le point de rencontre entre la tradition antique et la pensée actuelle : est-ce qu’on rit d’un malade ou est-ce qu’on pleure avec sa souffrance? Les grands fous… est-ce qu’ils nous font rire ou pleurer ? C’était déjà la grande question chez Démocrite. Il rit indifféremment de tout. Ses compatriotes le tiennent pour fou et souhaitant ramener à la raison leur grand homme, ils appellent au secours Hippocrate. Telle est la fiction qui se développe au long les lettres qui nous ont été transmises par le corpus hippocratique. Avant de partir pour Abdère, Hippocrate exprime son opinion sur les deux symptômes qui lui ont été signalés par les citoyens de la ville d’Abdère. Assurément, rire indifféremment de tout sans respecter de distinction entre les biens et les mots, c’est folie. Hippocrate compte le faire savoir à Démocrite en lui disant franchement « tu souffres de mélancolie ». Mais, ajoute Hippocrate, la solitude est un symptôme ambigu. Il faut savoir faire la différence entre la solitude du contemplatif et celle de l’homme que tourmente la bile noire. Les Abdéritains,- les habitants d’Abdère- n’en sont pas capables. L’apparence extérieure est la même, les fous et les contemplatifs se détournent des hommes regardant l’aspect de leurs semblables comme l’aspect d’êtres étrangers. D’avance Hippocrate s’attend à trouver en Démocrite un homme emporté vers une région supérieure par le fait d’une excessive vigueur de l’âme. Hippocrate est résolu à venir examiner le prétendu malade en personne. Il n’accepte aucune rémunération. Il n’a le désir que de regarder, d’écouter celui qu’on croit malade et ainsi d’en arriver au savoir, à la prognosis qui légitimera la décision touchant un éventuel traitement, c’est à dire l’administration d’hellébore (de plantes). L’entrevue d’Hippocrate et de Démocrite dans une lettre fameuse connue sous le nom de « lettre à Damagète… Hippocrate venu pour observer, découvre dans une solitude ombragée un homme studieux qui lit, qui médite, qui observe les entrailles d’animaux entièrement ouverts. Démocrite lui fait savoir qu’il dissèque les animaux pour découvrir le siège de la bile et pour mieux comprendre les causes de la folie. La solitude de Démocrite est donc parfaitement justifiée. Ce n’est pas celle de l’homme que tourmente une humeur corrompue, mais celle du sage qui cherche les causes cachées et qui a entreprit de reconnaître de ses propres yeux la nature et la situation de la bile. Il domine ainsi de toute la hauteur d’une connaissance précise et objective ceux qui ont mis en doute la santé de son esprit. Il sait que la santé et la maladie sont affaires de justes proportions humorales. Etc. etc. etc. Ce qui est très important, et en particulier parce qu’on est à la fin de la renaissance, c’est la construction et la structure de l’œuvre. Ça commence avec le frontispice, comme il appelle ça à l’époque. C’est énorme ! Tout, cette énorme œuvre est résumée dans la page de couverture, le frontispice. Là, voyez ce petit signe ! L’emblème de Saturne ! Vous avez regardé Mélancolie de Lars Von Trier ? Le livre est écrit sous le signe de Saturne. Qui était Saturne pour Burton ? C’était la dernière des planètes, un dieu rejeté, qui pourtant avait gouverné le siècle d’or. Il est, dit Gérard de Nerval, le soleil de la mélancolie. C’est quelqu’un qui possédait une vision immédiate du monde supérieur, et qui s’est glissé dans une pensée mathématico-géométrique jusqu’au désespoir. Il a essayé de penser sur un mode mathématico-géométrique cette vision immédiate du monde supérieur. Et comme il a du constater que ce n’était pas possible, il s’est glissé dans le désespoir, Saturne. Et là, il vit avec les exclus, les errants dans la sécheresse et dans le froid. En haut, … Au milieu, Démocrite le vieux qui lit un livre sous un arbre. En bas, au milieu, c’est Démocrite le Jeune, le pseudonyme de Burton, l’auteur. L’ainé est entouré par des animaux, signe de jalousie et de solitude. A gauche, l’amoureux et les superstitieux, à droite, l’hypochondriaque et le maniaque et en dessous les plantes qui guérissent. Dans la structure même, le titre : Anatomie de la mélancolie. Il va faire allusion à l’étymologie du mot anatomie, c’est à dire mettre à nu, en pleine lumière. La folie de l’homme raisonnable est anatomisée par le clin d’œil d’un fou. C’est presque son leitmotiv à Burton, son fil conducteur. Donc on a le frontispice et puis la dédicace à son maitre Berkeley. Troisième chose, il y a un poème en latin adressé à son livre, puisque lui, Burton, il est le lecteur du livre. C’est très actuel ! Foucault n’a rien inventé en disant qu’il n’y a pas d’auteur de livre. On écrit que ce qu’on a lu. Donc il est lecteur. Burton, dans toute sa génialité, va remercier, dans un poème, son livre. Ensuite, on a un résumé de la mélancolie dans une forme de dialogue. Et ensuite, on a ce qui est devenu célèbre, et je vais un peu insister là dessus : une préface satirique. A partir de la page 165 jusqu’à loin, 442. Une préface satirique. Après, on a un avertissement au lecteur, et surtout au lecteur qui utilise mal son temps, qui s’ennuie, qui ne fait rien, qui est feignant. Au lecteur feignant ! Salaud ! Pendant tout le livre, il n’arrête pas de s’en prendre aux feignants. Des gens qui disent « je ne sais pas quoi faire aujourd’hui… je vais lire un livre ». Il leur en veut. Comme si c’était un divertissement de lire un livre… Public : une occupation ML : alors, là ! Il leur en veut… à mort ! Il faut étudier un livre ! N’importe lequel ! Même une bande dessinée. Tout le temps que ce monsieur a passé à écrire pour pouvoir tout condenser dans un livre, et nous on va s’amuser un peu, comme si c’était… donc, vraiment un avertissement au lecteur. Et ensuite il va écrire un poème satirique, cynique, en dix strophes, superbe : En alternance, pleurer et rire, Héraclite c’est celui qui pleure et Démocrite c’est celui qui rit. Pleure donc Héraclite tes pleurs conviennent au temps Tu ne vois que le laid, tu ne vois que le triste Et toi Démocrite, tu peux rire, tu en as le droit Tu ne vois que vanité tu ne vois que folie L’un comme l’autre dans les pleurs ou le rire Exprime l’effort exprime la douleur Il nous faut à présent hélas ce monde est insensé Mille Héraclite mille Démocrite Il faut aussi si grande est la folie Envoyer tout le monde à … Et enfin, on a le texte lui-même. Première et deuxième parties du texte : c’est une synthèse géniale autour de la mélancolie. D’abord les grandes théories physiques dans lesquelles sont pensés ensemble l’âme et le corps, puis la définition de la mélancolie et leur variation dans leur place dans l’ensemble des maladies, c’et une classification nosologique avant la lettre, puis troisième grand chapitre, c’est l’hygiène. C’est très actuel. Quand on lit ça, c’est comme quand on se trouve dans un supermarché avec une vendeuse et qui nous donne des outils sur la diététique. C’est superbe. Comment arriver à avoir un équilibre alimentaire ? Il appelle ça « l’accent sur le diététique ». Quel est le sens de faire du sport ? Quel est le rapport entre veiller et dormir… Après, on a les moyens thérapeutiques. On peut s’imaginer sur quoi il va mettre l’accent celui-là. Sur le travail ! Un moyen contre la paresse et ne rien faire. C’est vraiment sa bête noire à Burton, ne rien faire… s’il avait lu l’éloge de la paresse, je pense que cela l’aurait rendu complètement fou… Et la dernière partie, superbe, c’est la mélancolie de l’amour, c’est un livre en soi, la mélancolie religieuse, très beau, puis le rapport entre le suicide et le désespoir. Donc, vous avez le choix. Je commente un tout petit peu pour vous montrer comment il travaille, la préface satirique. Si ça vous intéresse. On a pas tout le temps l’occasion d’entendre parler ou de lire l’anatomie de la mélancolie. J’ai un copain qui m’a dit qu’à Londres, il y a une pièce de théâtre qui a été montée à partir de l’anatomie de la mélancolie. Il est allé voir sur internet : deux heures et demie superbes avec des gens qui déclament des extraits du livre et en particulier la préface satirique. Qu’est ce que c’est pour lui une satire ? C’est une forme littéraire qui consiste en des vers et de la prose pour faire une critique de tout. Tout ce qui concerne les saloperies qu’on fait dans la vie et sur des situations ridicules. Et cette critique est moralisante. Et Burton prend le mélancolique comme porte-parole de la satire. C’est quand même extraordinaire. C’est la tonalité du mélancolique qui est le porte-parole, celui qui peut tout critiquer sur un mode moralisant, masqué par sa bile noire qui expulse toute la saleté, qui n’épargne personne et qui n’a pas honte. Fin renaissance dans une préface. Quand j’ai vu ça, j’ai pensé « on n’a rien ajouté ». On a fait une théorie, on a mis ça dans un cadre, il y a des psychanalystes qui se fatiguent en cherchant comment ça se fait que le mélancolique n’a pas de honte, et Burton, je le vois dans sa chambre à Oxford, sous une forme théâtrale, il nous amène tout ça. C’est ça que j’ai trouvé passionnant. Ce coco. Incarné par Démocrite le jeune. Celui qui a été exclu. Il s’est isolé à Abdère et Hippocrate, après l’avoir observé, va dire aux citoyens d’Abdère : « vous me demandez qui est fou ? C’est vous et pas Démocrite. » C’est très actuel quand même. Ce sont qui les fous ? Ceux qui les soignent ou ceux qui sont fous, soi-disant ? La plupart du temps, ce sont ceux qui les soignent qui sont fous. Mais il faut avoir la force de la satire pour oser le dire. Et si on le dit maintenant, on pense que celui qui le dit est fou donc on ne l’écoute pas. Ou c’est peut-être le truc pour aller dans un congrès de psychiatrie institutionnelle pour dire que les malades sont bons et ce sont les soignants qui sont fous, ça va bien… Quelle est la construction de sa préface satirique ? D’abord c’est la lettre qui contient l’entrevue entre Hippocrate et Démocrite. Et puis une utopie qu’il va fabriquer. Comment rendre une société vivable dans laquelle on a nettoyé toutes les saloperies, toutes les piques, toutes les situations ridicules. Il va donc reprendre cette lettre. Ce qui est le plus important si vous avez envie de le lire, vous pouvez prendre n’importe quelle entrée, c’est que Burton se présente comme un acteur qui joue sur une scène. Il fait du théâtre. Il y a tout un développement sur le théâtre. La maladie et le théâtre. C’est un acteur avec un masque qui va se laisser démasquer. Qu’est ce que fait le malade quand il va voir quelqu’un ? Est-il prêt à se laisser démasquer ? Quand je me démasque, je peux me défendre aussi. Je peux me masquer, je peux jouer un rôle. C’est ça, dit-il, la vie : s’adresser à, par la possibilité de se faire démasquer, et nu devant les autres, seul, se doubler. Je donne un exemple : Déjà quand il écrit sous le pseudonyme de Démocrite le jeune, autant de bonnes raisons pour s’envelopper et se cacher comme d’autres l’ont fait avant lui sous le nom de Démocrite. Pour le vieux Démocrite et son cadet, un seul souci, regarder, écouter, comprendre, s’adonner à la vie théorique et un seul projet, parler de la folie et de ses causes dans un grand livre. Or le livre de la folie du vieux Démocrite a été perdu. Quelle perte pour le monde ! Ce livre perdu, sans prétendre l’égaler, on peut rêver de le remplacer. Et Burton se porte volontaire. Au passage, ce masque a glissé. Un prénom, Robert, nous est livré comme le sujet du savoir. Croyez en Robert qui en a fait l’expérience. Donc il se dédouble, et il se parle à lui-même. Déjà on avait la structure de l’auteur et du lecteur, et là aussi Croyez en Robert qui en a fait l’expérience. Plus loin quand il empruntera une ligne d’un ouvrage de son frère ainé, une note nous apprendra que celui-ci s’appelle William Burton et désormais nous savons tout. L’auteur tient son masque à la main. Il évoquera plus loin son lieu natal etc. etc. etc. Burton n’hésite pas. Il décrit Démocrite comme un petit vieillard soucieux très mélancolique de nature, fuyant la société dans ses vieux jours et très adonné à la solitude. Après avoir développé le portrait légendaire du philosophe d’Abdère, Burton trace le sien. Assurément, il n’est pas la réplique exacte de celui dont il usurpe le nom ; il n’a pas voyagé, il n’excelle pas dans les mathématiques et les sciences naturelles, il n’a pas été invité à donner les lois dans une cité. En sa qualité de fellow du collège d’Oxford, il a simplement lu beaucoup de livres sans grande méthode. Mais les similitudes l’emportent et l’autoportrait construit à coup de citations rejoint l’original antique construit lui aussi de citations juxtaposées. Même gout de la solitude, même caractère mélancolique, Saturne fut le maître de ma naissance, même rire sur toutes choses, je ris de tout, même genre de vie privée, même célibat de vieil étudiant. Je mène toujours la vie d’un vieil étudiant, comme on disait au début, dans son collège, comme Démocrite en son jardin, etc. etc. Et à la fin, dans la préface satirique, il donne déjà quelque chose sur la mélancolie : Burton nous apprend que la mélancolie est déjà à elle seule un masque suffisant pour dire son fait au monde. Nul besoin de déposer la défroque du clown, nul besoin d’agiter une marotte et un grelot, Burton pourtant éprouve le besoin de se cacher derrière un pseudonyme. Il dissimule sa mélancolie personnelle sous une mélancolie légendaire et superlative. Il veut être fidèle à l’archétype d’une tristesse exaltée jusqu’au rire et installé dans la plus vigoureuse contradiction. Le philosophe d’Abdère est accusé de folie par ses concitoyens mais Hippocrate salue en lui une sagesse souveraine. Pour dénoncer les maléfices de l’apparence, quel homme aura plus de titres que celui dont l’apparence fut si mal interprétée. Tenu pour délirant, victime exemplaire de l’opinion des hommes, il a le droit d’inverser l’accusation et de proclamer que le monde est fou. Derrière cette apparence de folie que les hommes lui imputent et ce n’est qu’un masque, Démocrite peut rire sous cape, il peut rire aux éclats. Il méprise le monde et sa petite sagesse. Il veut bien être fou et s’ils appellent les médecins pour le guérir, il se met d’accord avec eux pour les juger incurablement stupides. Là, c’est Starobinski : Tel est le personnage que Burton veut jouer sur le théâtre du monde. C’est un guide, un exemple, un modèle. N’oublions pas que dès la première phase du texte, nous avons devant nous une figure d’emprunt, et je cite : « Estimable lecteur, je présume que tu seras fort curieux de savoir quel est ce personnage burlesque ou cet acteur masqué qui s’avance si insolemment sur le commun théâtre à la face de l’univers en se revêtant du nom d’un autre homme ». Celui qui s’adresse à nous parle d’une voix contrefaite. C’est peut-être qu’il n’a peut-être pas de voix ni de ton qui lui soit propre. Sa propre vie, il la voit à distance comme une partie du spectacle universel. La conscience réflexive est merveilleusement neutre et détachée. Pour s’exprimer, il faut qu’elle fabule son image même. N’être rien ou jouer ce qu’on est. Burton . 1621. Or l’image légendaire du mélancolique est un costume seyant pour affirmer la pure négation qui est l’acte fondamental de la conscience. Le vêtement noir dit le deuil et la séparation, le chapeau à larges bords abattu sur le visage interpose une paupière supplémentaire entre le regard et le monde. Le mimétisme à l’égard d’une attitude et d’un type humain préexistant va de pair avec l’insuffisance intérieure. Le mélancolique n’a pas assez de vigueur pour se passer des secours d’une forme établie d’avance. Depuis … , l’idée d’un lien très étroit unissant la mélancolie et le génie et les vertus contemplatives s’est généralisée. Il n’est presque point de grands personnages à la fin du XVIème siècle qui ne revendiquent délibérément ce tempérament comme un privilège et qui ne le signalent que par quelque trait de grimage ou de vêtement. Indice de supériorité intellectuelle, la noire livrée du mélancolique devient l’apanage du diseur de vérité et du démasqueur masqué. Méphistophélès, le mélancolique du romantisme. Il peut reprendre au magasin des accessoires le justaucorps d’Hamlet. Mais à peu de détails près, c’est le costume du clergyman en Angleterre. Et voilà. Et ça continue. Mais j’arrête avec l’Anatomie de la mélancolie. J’espère que ça vous donne envie. Ça coûte 60 euros, les deux ! JA : c’est l’édition Corti ? ML : oui, oui. Après je fais, on arrive bientôt dans … il y a cet article de Gladys Swayne « Permanence et transformation dans la mélancolie ». Qu’est ce qu’elle fait ? Elle fait une lecture transversale de la mélancolie en mettant l’accent sur les ruptures significatives dans la construction de la notion de la mélancolie à travers l’histoire. Il y a 4 ruptures pour elle. D’abord, il y a la rupture avec la théorie humorale d’Hippocrate. On exclut la théorie de la bile noire pour mettre à sa place le nouveau statut de l’homme qui pense et dès que l’homme pense, dit-elle, il y a l’idée d’un mal de la raison. L’homme, comme sujet, doué avec une autonomie propre pour pouvoir se poser vis-à-vis du monde ce statut épistémologique a tout de suite des conséquences autour de l’idée de la folie. Le trouble de l’intelligence remplace le trouble humoral et pour la première fois dans l’histoire la folie est un trouble intime de la pensée. Elle dit la folie est délire et si on ne fait pas attention, on pense toujours ça. Quand il y a quelqu’un qui ne délire pas, on ne dit pas qu’il est fou. Attention. Le psychotique qui ne délire pas, on ne dit pas qu’il est fou. On dit qu’il est fou uniquement quand il délire. Mais, non ! Il y a longtemps qu’on pensait ça. Il y a bien longtemps, avant Descartes, qu’on va dire que l’être humain est un sujet qui peut penser vis-à-vis du monde, qu’il peut placer un objet devant lui. Donc elle dit que c’est à ce moment-là qu’on dit que la folie est le délire, c’est à dire de dire que les idées d’un sujet sont touchées, les qualités, les caractéristiques des idées d’un sujet sont touchées. Qu’est-ce qui est touché profondément ? C’est sa maîtrise vis-à-vis de ses propres idées. Il ne maîtrise plus ses pensées. Il ne maîtrise plus ses idées. Un grand texte de Biswanger s’appelle « Fuite des idées ». On ne maîtrise plus ses idées. Et la mélancolie fonctionne dans ce discours-là sur un échelon des idées de pensée. Donc d’une part on peut être touché dans tout ce qui se présente à l’esprit, et on peut être touché, et c’est là que la mélancolie arrive, autour d’un objet. Souvent très minimal, mais indestructible. Et c’est ça la mélancolie. Je ne peux pas me distancier, je ne peux pas sortir ce qui est dans ma tête et le placer devant moi. Comme un objet à étudier. Ça peut être n’importe quoi. Une poussière. Un crayon. Elle donne des exemples dans l’histoire. Un pot d’encre. Elle ne dit pas obsédé. Il y a un pot d’encre qui est dans mon esprit, j’essaye de le mettre devant moi et je n’y arrive pas. C’est la définition à ce moment-là de la mélancolie comme un trouble intellectuel partiel. L’intelligence est touchée autour d’une idée. Et en contraste avec ça, la manie est d’être touché sur un mode général. La fuite des idées, ce n’est pas une idée qui se ballade partout mais on est touché dans l’ensemble de ce qu’on pense. Et puis ensuite il y a une rupture avec cette idée que c’est un trouble de l’intelligence. Et je suis désolé, c’est un belge, Ghislain. Gladys Swayne en parle et pour nous c’est quelqu’un d’important. Ghislain, vous n’avez sûrement jamais entendu parler du lui. Sûrement pas. L’hôpital Ghislain de Gand. Le musée Ghislain. Et c’est ce psychiatre, un grand clinicien qui avait une passion pour l’architecture, qui a construit le premier hôpital psychiatrique, dans le nord. Dans son livre de 1835 Traité sur les phrénopathies, il dit : je ne dis rien de nouveau, mais j’écoute et je vais essayer de découvrir ce qui se couvre dans les mots. Qu’est-ce qui se couvre dans la mélancolie ? la souffrance. Je ne vous raconte rien de nouveau mais j’essaye d’articuler sur ce quoi vous ne vous êtes pas arrêtés, la souffrance. Et la souffrance qui fait mal et qui produit du chagrin et de la douleur. Ce n’est pas la douleur qui produit la souffrance mais l’inverse. Von Weizsäcker n’était pas né à l’époque ! à l’époque, et on le dit encore, ça permet n’importe quoi, on disait que les fous vivaient enfermés à l’intérieur d’eux, dans leur propre monde et qu’ils n’en souffraient pas ! . C’est très touchant de les voir vivre dans leur propre monde. C’est dans Kant ça. Que ça serait au moment où on les sort de leur propre monde qu’ils en souffrent, donc laisse-les ! Et Ghislain se bat contre ça. Tous ses livres sont là pour se battre contre Kant et contre ces préjugés. Et pour lui la souffrance de l’esprit, c’est le principe de tout trouble et en particulier de la mélancolie. L’homme mélancolique, en opposition avec les schizophrènes, n’est pas irrationnel. Et en opposition avec les normopathes, il n’est pas bête. L’homme normal, l’homme moyen est bête. Pas le mélancolique. Il n’est pas irrationnel comme peut l’être le psychotique et il n’est pas bête comme peut l’être l’homme moyen. Mais sa souffrance produit un tel changement fondamental que des troubles intellectuels peuvent en être une conséquence. Sa souffrance est telle que même des fonctions intellectuelles peuvent être touchées car débordées par le trop de souffrance. Je cite dans Gladys Swayne : « Primitivement, l’aliénation est un état de malaise, d’anxiété et de souffrance, une douleur morale intellectuelle et cérébrale comme on voudra l’entendre. Dire que l’aliénation est un trouble intellectuel et de jugement serait une proposition erronée. Ce serait prendre le symptôme secondaire pour le phénomène fondamental. Vous suivez ? Si vous vous endormez, vous le dites. Beaucoup d’aliénés ne déraisonnent point. Tous, cependant, à de très rares exceptions près souffrent. C’est là l’altération-mère d’où provient le dérangement dans les idées, le trouble de l’intelligence, l’aberration dans les qualités instinctives et toutes la série des actes violents et bizarres qui caractérisent l’aliénation mentale sous ses différentes formes et dans ses diverses combinaisons. Et Ghislain va donc très logiquement décrire des mélancolies sans délire, dont il fera la forme la plus simple sous laquelle le mode souffrant puisse se présenter. Et ainsi Ghislain peut nous donner une bonne description de ce que nous appelons aujourd’hui mélancolie. Troisième rupture : rupture avec le contraste entre délire partiel et délire général. « On n’est pas fou à moitié, on est pas fou au ¾, il y a toujours une dimension saine, il y a toujours un bout de moi qui est sain, et on peut toujours faire des acrobaties pour intégrer les parties non saines dans les parties saines ». On entend ça dans la psychologie du moi dans les versions extrêmement modernes. C’est Ghislain qui s’oppose à ça. Il ne dit pas qu’il y a une partie folle et pas l’autre. Il y a un état général qui est le fond de la maladie. Le délire n’est que partiel dans sa manifestation. Et c’est à partir de ce moment-là, -et là je dois me calmer, à chaque fois ça me fait la même chose, à cet endroit-là, je m’énerve, ça me fait monter au plafond, et ce n’est pas bon… Pour personne… Calme !- Les conséquences de cette idée qu’il existe un état général qui est le fond de la maladie, lié à la souffrance fait que cela devient possible dans l’histoire, mais c’est oublié maintenant, qu’on peut penser la manie et la mélancolie dans une unité, dans une entité nosologique, c’est à dire la folie circulaire. C’est Pierre Falret, merci, qui le premier a utilisé le mot folie circulaire. Ou, c’est la même chose dans la nosologie, ou la folie à double forme. C’est Boulainger. La même affection peut se manifester sous deux formes selon le principe de l’alternance construite à partir de la folie circulaire, du cycle. -Si on était un peu intelligent et si on s’intéressait encore à l’histoire, on ne serait pas tombé, comme on le voit dans certaines revues de psychanalyse, sur ces aberrations, les troubles bipolaires. Cette revue qui est tombée dans mes mains, qui s’appelle je crois Figures de la psychanalyse, il y a les grands noms des psychanalystes parisiens… la critique sur la structure bipolaire, je n’en ai pas trouvé. Nul. Moi, j’étais déçu. Si on regarde l’histoire, qu’est ce qui fait le passage de circulaire, cyclique à bi ? Qu’est ce qui fait qu’on doit penser dans un système binaire et qu’on ne peut pas penser dans un système cyclique. C’est tout bête. Donc, Gladys Swayne nous dit qu’on arrive à une sorte de synthèse où les troubles fondamentaux existent dans un état général qui précède le délire, c’est le fond de la maladie. Cela peut se manifester sous deux formes : un état d’expansion dans la manie et un état de dépression dans la mélancolie… Moi, j’aime bien Kraepelin. Ce n’est pas de ma faute, j’ai une affinité pour Kraepelin. Et lui, il va approfondir cette synthèse. Je peux le faire ? Vite. Mais il est superbe. C’était un homme passionné. C’est pas ce vieux con qui nous a fait des manuels de psychiatrie… pas du tout. Je les hallucine… c’est vrai. Public : rires ML : Kraepelin est le premier qui a essayé de penser de faire une science psychiatrique. Et qui choisit pour construire cette science la sémiologie. L’autre qui va essayer de construire une science psychiatrique c’est Tellenbach qui va lui utiliser la typologie. Donc, d’abord Kraepelin. Qu’est ce qu’il fait ? Je crois que Schotte avait tort, il était prétentieux; il disait que le seul en psychiatrie qui avait essayé de combiner la pratique, la clinique et la théorie avec sa propre vie, c’était Szondi. Qu’on pouvait lire à travers sa vie toute sa théorie. Ce n’est pas vrai. Ce n’est pas le seul. Kraepelin aussi. Il était tellement passionné par son travail, on va voir où cela la menait qu’on ne peut pas penser sa théorie sans voir sa propre vie. Et qui se pose des questions extraordinaires. C’est bizarre mais moi, je l’aime bien. Il a vécu de 1856 jusqu’en 1926. Il a fait des études de médecine, d’abord la psychiatrie chez Wundt à Leibznicht, et ensuite, une épiphanie, il est allé à Munich chez Van Gudden. Vous connaissez ? Public : non. (Rires). ML : vous avez vu le film Ludwig de Visconti ? Van Gudden avait été convoqué par les conseillers de Ludwig pour essayer de le soigner. Mais soigner Ludwig, c’était d’abord l’apprivoiser et essayer d’entrer dans ce monde bizarre et l’on voit bien chez Visconti comment il glisse dans cette sorte d’identification à Wagner, dans cette fureur, dans cette solitude, enfermé dans l’explosion projective, mégalomaniaque. Comment avoir accès à ça ? C’était à un moment où Kraepelin était l’assistant de Van Gudden. Et Van Gudden entre dans la vie de Ludwig et développe à petite dose une folie à deux avec le roi. Et Kraepelin se demande ce qui se passe. Il a essayé en étant élève d’aider son maitre. Impossible ! Plus de prise sur cette folie qu’il voyait se développer. Et c’est à partir de ce moment là que Kraepelin va se questionner jusqu’à la fin de sa vie : mais qu’est ce que c’est que ça, l’être humain ? Qu’y a t-il dans l’être humain pour mener jusque là ? La maladie, peut-être ne faut-il pas l’étudier là où elle se manifeste mais là où elle va nous mener. Je trouve ça génial comme intuition. L’être humain est une énigme. Chez les grecs, il y avait l’oracle. Il y avait des rituels qui pouvaient nous dire « ça t’amènera là ». Maintenant cela n’existe plus. L’oracle, c’est peut-être la maladie. Qui nous montre à quel prix l’énigme en nous peut nous mener. Ça a été le fil conducteur de tout son travail. A partir de là, il est passionné par à la fois, être avec les malades, et en même temps, faire des recherches. Donc il va travailler dans la clinique royale à Munich et il va construire un institut de recherches psychiatriques et toute sa vie, il va la consacrer à ça. Sa grande œuvre est le manuel de psychiatrie. Huit éditions ! Je trouve ça, pas obsessionnel… mais… à chaque fois qu’il édite quelque chose, hop… il repense… pour approfondir… huit fois ! Donc ces différentes éditions connaissent une grande évolution et c’est dans la huitième édition qu’il étudie pour la première fois la psychose maniaco-dépressive. C’est lui qui l’appelle ainsi. Pourquoi a t-il attendu si longtemps pour oser s’attaquer à cette maladie ? Parce que, c’est vrai que ça revient toujours au même point. C’est cyclique. Schuman, il fait des cycles de lieder pour piano, de chants, et hop ça revient toujours au même point. Il n’y a pas d’évolution. Moi qui me demande où cela peut mener, je dois accepter, dans la clinique, qu’il y a quelque chose qui ramène au point de départ. Donc Kraepelin était confronté à cette problématique. Et il attendu jusqu’à la fin pour essayer d’écrire quelque chose sur cette structure cyclique. Pourquoi il est embêté avec cette structure cyclique ? Parce que son but et sa méthode était de délimiter et de regrouper des formes de maladies. Ce qu’on appellera plus tard des classifications. Mais ce qui est plus important c’est de concevoir l’évolution de la maladie. La maladie s’individualise, se singularise et se définit selon l’évolution qui est typique à chacun. Il n’y a pas deux schizophrènes pareils, il n’y a pas deux enfants autistes semblables. Dans la symptomatologie, oui, mais pas dans la manière dont cela évolue. Et Kraepelin dit que le diagnostic à faire est d’essayer de faire un pronostic précis. Ça c’est le diagnostic. Ce n’est que le pronostic qui fonde le diagnostic. On ne peut jamais, dit-il, faire un diagnostic exact. Arrêtons de penser cela. Si la psychiatrie est une science qui se fonde sur l’énigme de l’être humain, elle ne peut pas faire de diagnostic. On peut s’approcher, on peut trouver des possibilités, on peut délimiter, cela peut nous aider pour le travail thérapeutique, mais ne commençons pas avec le diagnostic. C’est nul. C’est Kraepelin qui dit ça. C’est pas mal, non ? On avait pas Laing Cooper et tout ça pour faire de l’antipsychiatrie. Dans les études de psychiatrie, on ne l’étudie pas. C’est dommage. Alors que dit-il sur la maladie maniaco-dépressive ? Il s’inscrit dans la tradition de Falret sur la folie circulaire, et sur Esquirol. Il est mignon Esquirol, enfin, je ne sais pas s’il était mignon, mais pour moi, quand on le lit, je le trouve mignon… il dit que si on veut faire un champ psychiatrique scientifique il faut distinguer la mélancolie des phénomènes littéraires, critiques, et il va donc lui donner un autre nom : la lypémanie. Kraepelin trouve ça superbe, adopte le nom et définit donc la mélancolie comme maladie de la passion où l’excessif de la passion est la cause des faux jugements et des troubles de l’intelligence. Il fait donc une synthèse de ce que dit Ghislain. Et avec son souci de regrouper des formes de maladies, à partir de la folie circulaire, à partir de la lypémanie, il va essayer de faire des formes de maladies. Il arrive à 4 formes cliniques : des états maniaques, avec des sous-rubriques, la manie aigue, la manie délirante, la lypémanie. Et c’est vrai, dans la clinique de tous les jours, on dit « il fait une phase maniaque ». C’est quoi une phase maniaque ? Décrivez-la, est-ce aigu ou pas, est-ce délirant ou pas ? Quand c’est délirant, il n’y a pas grand-chose à faire, mais quand c’est aigu, vas-y vite parce qu’il va courir sous le train ou sous une voiture. Ce n’est pas suicidaire, mais c’est aigu. Rien ne l’arrête, donc il faut l’arrêter. Si c’est délirant, il n’y a rien à faire. Dans les états dépressifs, il situe la mélancolie simple caractérisée par la stupeur. Il était intelligent quand même. Puis, la mélancolie compliquée. Où il n’y a pas seulement l’état stuporeux, mais il y a aussi des mouvements. Troisième forme, la mélancolie délirante qui va aussi avec des hallucinations fantastiques et des idées hypochondriaques, c’est ce qu’on appelle le syndrome de Cottard. C’est vrai, les délires de petitesse, de négation, je ne vaux rien, pour Kraepelin, cela fait partie d’une forme délirante mélancolique. Cottard l’a très bien décrit mais en syndrome. Et Kraepelin, hop, il l’intègre dans la mélancolie délirante. Et il délimite aussi les états fondamentaux avec des périodes stables et des variations de l’humeur qui ont des extrêmes. Et là, c’est tout l’art de la pharmacie, des régulateurs de l’humeur, comment varier la posologie, ce sont des gens que l’on doit voir tous les jours. Si vous avez quelqu’un qui est en phase maniaque, il faut le voir tous les jours. Et si vous travaillez en ville, trois, quatre fois par semaine. Il ne faut pas faire payer à chaque fois. Et maintenant on peut prolonger les intervalles. Mais quand les gens vieillissent, les intervalles sont de plus en plus courts. Allez, on fait Freud. Si vous pouvez vous concentrer encore un petit peu, sur Freud. Dans quel contexte a-t-il écrit « Deuil et mélancolie » ? Dans Totem et Tabou, on avait vu quand on avait étudié la phobie, le problème de la mort et en particulier la mort du père constitue le matériau psychique et il découvre dans l’anthropologie l’identification totémique et cela va lui offrir une élaboration idéale. Il dit que le problème de la mort du père est un problème car il y a là une collusion de la mort et du désir. Seulement là, se demande t-il ? Non, et tout de suite, la possibilité de tomber malade par cette sorte de collusion entre le désir et la mort trouve aussi des témoignages dans le chagrin pathologique, dans la nostalgie des névrosés comme l’homme aux rats ou dans la nostalgie des paranoïaques comme Schreber. Schreber est un homme nostalgique. Et dans le système des élaborations morbides de la mort, de la perte, comme sont la phobie, l’obsession, la paranoïa, il manque une pièce clinique très importante, la mélancolie. Donc, il passe de la mort du père à la mort de l’objet d’amour en général et en particulier, de la perte et de la mort du premier objet : le sein de la mère. Centré sur la perte de l’objet, cette réflexion sur la collusion entre le désir et la mort s’écrit dans quelques œuvres, dont « Deuil et mélancolie » est le noyau et on doit, je pense, le lire avec Métapsychologie, son texte sur l’inconscient et surtout le complément métapsychologie de la théorie du rêve. Donc des textes écrits entre 14 et 18. Ça, c’est le contexte. Quel est le sort de l’objet perdu ? C’est à Abraham que Freud doit le point de départ de « Deuil et mélancolie ». Abraham était le premier à essayer de donner une méthodologie de la clinique de la structure maniacodépressive et des états voisins. Ses états voisins étaient pour Abraham, l’état de deuil et l’état de dépression de la névrose obsessionnelle. Pour nous qui sommes intéressés dans l’anthropopsychiatrie, comment situer les maladies en rapport les unes avec les autres, Abraham est important quand il essaye de faire un rapport entre la dépression, la névrose obsessionnelle, le deuil et cette maladie cyclique, la structure maniaco-dépressive. Freud aussi ! Et donc, Abraham écrit son texte en 1912, Freud écrit « Deuil et Mélancolie » en 1915 et Abraham reprend ensuite ses premières investigations avec les apports de Freud dans son texte superbe de 1924 : les états maniaco-dépressifs et les états prégénitaux de l’organisation de la libido qui va connaître une suite chez Mélanie Klein : le deuil et ses rapports avec les états maniacodépressifs. Chez Freud : il commence, c’est ma lecture de ce texte « Deuil et Mélancolie », par des rapports entre le rêve et le deuil. Le rêve est le modèle normal des troubles psychiques par lesquels on peut tomber malade et qu’on retrouve dans les hallucinations psychotiques. Donc, les hallucinations psychotiques sont la pathologie du rêve. Et le deuil, qui est un affect normal, à comparer avec sa psychopathologie : la névrose narcissique que Freud appelle la mélancolie. Pour lui, c’est une névrose narcissique. Je cite un texte, mais Michel n’est pas là et je ne vais pas vous emmerder de le dire en allemand : Deuil et Mélancolie, Amen !, p 429 pour ceux qui l’ont en allemand : Le deuil est régulièrement la réaction à la perte d’une personne aimée ou d’un substitut dans une abstraction comme il y a la patrie, la liberté, un idéal, etc. Souvent, chez de nombreuses personnes, se manifestent comme conséquences importantes et immédiates, l’existence d’une mélancolie à la place d’un deuil, chez ces personnes, on suppose l’existence d’une prédisposition morbide. Les deux réactions lors de la perte de l’objet d’amour ont en commun une dépression profondément douloureuse, une perte d’intérêt pour le monde extérieur, dans la mesure- et c’est toujours dans les petits détails qu’on doit lire Freud-, dans la mesure où il ne rappelle pas le défunt. Donc, il y a un énorme intérêt quand cette personne peut parler ou se rappeler le défunt. Troisième perte de la capacité d’aimer, c’est-à-dire de choisir un nouvel objet d’amour, est l’inhibition de toute activité. La mélancolie présente un trait supplémentaire qui lui est propre : la diminution du sentiment d’estime de soi qui peut aller des autoreproches jusqu’aux auto injures. Jusqu’à l’attente délirante du châtiment. Voilà, ça c’est descriptif. En quoi consiste ce travail que produit le deuil, le travail de deuil ? Qu’est-ce qui fait que c’est si douloureux, le deuil ? C’est une question que Freud s’est toujours posée et à laquelle il n’a jamais pu répondre. Qu’est-ce qui fait que c’est si douloureux, le deuil ? C’est un travail dit-il commandé par l’épreuve de réalité. L’objet aimé n’est plus. Il faut retirer toute la libido des liens qui la retiennent à l’objet. Contre cette exigence, il se lève une rébellion – c’est souvent quelque chose qu’on oublie quand on lit deuil et mélancolie- l’homme n’abandonne pas volontairement une position libidinale. La rébellion peut aller jusqu’à un délaissement de la réalité et au maintien de l’objet. Qu’on va retrouver dans la psychose hallucinatoire. Normalement, le respect de la réalité l’emporte et quelqu’un qui est en deuil ne glisse pas nécessairement vers une psychose hallucinatoire, il peut s’arrêter auprès des monologues intérieurs ou du dialogue-monologue et il décrit dans compléments théoriques des moments dépressifs. Kuhn va le reprendre : le carrousel des pensées le soir. Il y a des monologues où on parle avec celui ou celle dont on doit retirer la libido. On parle à l’objet qui m’a quitté, on parle à l’objet d’amour qui est mort. Donc, cela ne glisse pas nécessairement vers une psychose hallucinatoire mais vers des monologues intérieurs, vers des dialogues-monologues. C’est très bien décrit par Kuhn. Donc, normalement la réalité l’emporte, mais ces tâches de respect de réalité s’accompagnent, je le cite- je l’ai travaillé en flamand donc je traduis-, s’accompagne en détail avec une grande dépense de temps et d’énergie d’investissement de l’objet et pendant ce temps l’existence de l’objet perdu se poursuit psychiquement. Chacun des souvenirs, chacun des espoirs qui attachaient la libido à l’objet est instable et surinvesti et c’est quand même là que le détachement de la libido doit s’accomplir. L’accomplissement du commandement de la réalité, de ne pas glisser dans une psychose hallucinatoire, est un compromis douloureux et inexplicable. La douleur est une énigme. Comme à l’envers la joie triomphale du maniaque est aussi une énigme. Je n’arrive pas expliquer cela. Il va réessayer plusieurs fois. Il n’y arrive pas. Qu’est ce qui se passe dans la mélancolie ? Ce trouble de sentiment de soi est différent du deuil parce qu’il est basé sur le statut même de l’événement que constitue la perte de l’objet aimé. Ça on connaît, c’est une phrase qu’on devait apprendre par cœur dans les cours de psychopathologie : l’homme en deuil sait ce qu’il a perdu à la mort de la personne aimée, le mélancolique sait qui il a perdu mais non ce qu’il a perdu en cette personne. Ça, c’est la grande différence pour lui, à ce moment-là. La perte du mélancolique est plus morale que dans le deuil. Dans le deuil c’est le monde qui est devenu vide et dans la mélancolie, c’est le moi qui est vide. Ce vide affecte le moi lui-même et c’est pourquoi ce travail du mélancolique reste énigmatique et extrêmement intérieur, beaucoup plus que le travail de deuil. Et là, c’est un coup de génie de Freud, il va s’arrêter auprès de cette énigme. Moi, j’aimerais bien de temps en temps, ne pas avoir ce texte de Freud et être dans sa tête, et … comment il a pu trouver ça ! Après coup, c’est facile, quand on le lit. Et il dit : ce trait énigmatique dans le travail du mélancolique se comprend dans l’écoute des plaintes, des autoreproches et qu’on les prend au sérieux. Et il y a un texte de Biswanger, dans Mélancolie et manie, où à Bellevue, la clinique où il travaille, il y a un malade David Bürge qui est dans un monde d’autoreproches et du jour au lendemain, ce dont il se plaint est résolu. Les infirmières, les médecins avaient une patience extrême avec lui, pendant un an, tous ces autoreproches, toujours les mêmes, et eux ils écoutaient, patiemment. Et du jour au lendemain, c’est résolu. Et hop, il y a une autre plainte qui arrive, un autre autoreproche. Et Binswanger explique bien, il dit, on est humains, on ne peut pas s’empêcher d’être irrités contre lui. Et c’est là qu’il dit que le délire mélancolique est interchangeable, ce n’est pas le thème qui est important. Mais on verra ça demain. Mais Freud, lui, dit donc que ce trait énigmatique se comprend dans l’écoute des plaintes et des autoreproches et il fait tout un paragraphe pour dire qu’il faut les prendre au sérieux. C’est quoi, l’écoute psychanalytique ? C’est pas écouter avec une oreille flottante!.... on écoute quelque chose, des mots, on écoute pas des phrases. On écoute des mots. C’est là ce paragraphe célèbre sur écouter les plaintes. Et pourtant, dit-il, le mélancolique ne se comporte pas comme quelqu’un qui serait plein de remords, qui serait gêné de se plaindre, ah j’en ai marre de me plaindre, ce n’est pas hystérique, mais pourtant il y a une dimension hystérique dans ces plaintes, mais c’est sans remords. Il se proclame à grand bruit le plus monstrueux des hommes, il s’exhibe, il jouit à importuner autrui de ses lamentations. Pas de honte. Burton l’avait déjà dit. Il a perdu le respect de soi. Mais pour quelle raison ? Ce n’est pas une perte de l’objet qu’il aurait subi mais une perte concernant son propre moi, ce vide affecte le moi, cette perte de respect concerne son propre moi. Puis il analyse les plaintes. Les plaintes s’appliquent à une autre personne qu’il aime et qu’il a aimée. Les autoreproches sont les reproches adressés à un objet d’amour, à quelqu’un d’autre, reproches renversés de celui-ci sur le moi propre. C’est toute la mécanique de ce texte. Se plaindre, c’est accuser. Et son comportement est celui d’un révolté. Et on voit chez Freud toujours cette structure : une constellation psychique qui est celle de la révolte, il est révolté contre quelqu’un. Mais qu’est ce qui fait qu’il va évoluer vers l’accablement mélancolique ? Donc de la révolte à l’accablement. Qu’est ce qui se passe dans ce passage ? Quel est le processus de ce passage, quelles sont les conditions qui rendent ce passage possible ? Et hop, deuxième coup de génie ! Une identification inconsciente. Et là, le texte devient difficile. Pour cela, il faut étudier, dit-il, la relation du moi avec l’objet d’amour et la perte de cet objet et il faut étudier, à nouveau, encore une fois, et à partir d’Introduction au narcissisme, quelle est l’étoffe du moi. Et on suit Freud, à partir de là, je vais un peu vite là : il dit, c’est presque un conte, qu’il existait un choix d’objet et sous l’influence d’une blessure ou d’une déception, il y a eu un choc. Je le cite. Le résultat n’est pas un retrait normal mais un autre qui exige quelque chose. L’investissement de l’objet était très peu résistant. Et la libido retirée dans le moi servait à établir une identification du moi avec l’objet abandonné. Et à partir de là, l’ombre de l’objet tombe sur le moi. Ça, c’est la phrase que tout le monde connaît. Troisième coup de génie. Ça, c’est le processus. L’ombre de l’objet tombe sur le moi. Et qu’est ce qui va se passer dans la libido ? Tu n’es pas trop intéressé dans l’autre quand même, il aimait l’autre pour soi-même. Donc, si l’autre s’en va, la libido n’est pas très résistante, il se retire dans son propre moi et voilà. L’ombre de l’objet tombe sur le moi et ça fait une instance du moi clivée en deux. Le moi peut être jugé à l’intérieur de lui même comme une instance particulière, comme un objet, comme un objet abandonné. Donc, il y a le moi, et il y a une instance du moi qui juge. De cette façon là, la perte de l’objet s’est transformée en une perte du moi et le résultat est que le conflit entre le moi et la personne aimée s’est transformé dans une scission entre une critique du moi et le moi modifié par l’identification. Ça va ? Donc, on est parti de la relation entre le moi et l’objet, et puis on est passé à l’étoffe du moi où à l’intérieur du moi, il y a une scission entre une critique et l’objet critiqué. Je me punis moi-même. Et là, on est dans une mélancolie délirante. Le moi qui critique l’objet à l’intérieur du moi. C’est ça que va prendre Szondi. Et là, on est dans l’approche d’Abraham, la dimension cannibalique du moi. Donc le processus énigmatique de Freud de la mélancolie est éclairé en partie par ce mécanisme de l’identification. Et là, il donne une définition de l’identification qui est géniale, je trouve, notez-là, Amen ! on ne la trouve pas dans les cours de psychopathologie : c’est un mode de transformation de l’investissement d’objet peu résistant. Un tel investissement qui fait le tour dans le moi, va justement, éclairer la nature narcissique du moi. Donc, on ne part pas du narcissisme qui serait déjà là, et on mettrait des couches dessus et ça va se complexifier, non ! C’est grâce à l’identification qu’il y a le narcissisme. La nature narcissique du moi se produit par l’identification. Qu’est ce qui fait que je choisis quelqu’un comme l’amour-propre ? Qu’est ce qui fait que je choisis l’objet d’amour comme un choix d’étayage, un choix ancestral ? Je choisis dans l’autre avec qui je vis mon arrière grand-mère ou mon arrière grand-père ? Ou qu’est ce qui fait que je choisis moi-même ? Moi d’accord, mais le fait que je peux choisir quelqu’un ? Et bien ça, c’est l’identification ! Et cet autre-là, ce n’est pas énorme, mais c’est important qu’il soit là sinon je ne peux plus m’aimer moi-même. S’il n’est plus là, je ne vaux plus rien, et tant qu’il est là, je peux faire la parade. C’est ça que Freud dit. Donc un tel investissement qui fait retour dans le moi manifeste sa nature narcissique et sa régression vers cette nature narcissique nous renvoie au choix d’objet narcissique et ancestral. Le bénéfice de cette opération narcissique est que le choix d’objet n’a pas à être abandonné. Il y a une faible résistance de l’investissement, il revient toujours sur ce mot resistenz, et il y a une forte fixation à l’objet, bien sûr. Donc, paradoxalement, le mélancolique est à la fois très dépendant de son objet et très narcissique. C’est du béton, le mélancolique. Moi, moi moi moi moi. Mais ce moi justement, ne peut fonctionner que dans cette fixation à l’objet mais l’objet n’est pas très important. Il est seulement important pour fixer son narcissisme. Et il dit : si l’identification narcissique avec l’objet devient le substitut de l’investissement d’amour, c’est que l’objet était un double narcissique du moi. A travers l’autre, je n’aime que moi-même. Finalement, je n’aime que moi-même. GF : oui, et deux fois ! ML : oui, deux fois. Et c’est ça pour Szondi. On va voir. C’est la première fois qu’il utilise cette terminologie dans deuil et mélancolie. Il va, et ça c’est important dans la clinique, quand on travaille avec des gens qui ont des tendances mélancoliques, ou qui sont dans un deuil douloureux, il fait la différence dans ce texte entre l’identification narcissique et l’identification hystérique. Il dit que dans l’identification hystérique, elle se manifeste cliniquement dans un mime qui condense le désir de l’hystérique, c’est à dire le désir inconscient d’une identité sexuelle et la défense. Dans l’hystérie, la relation d’objet se maintient mais elle est interdite, et seul le symptôme, dans ce mime, et le rêve en sont des traces. L’identification hystérique ne touche pas le moi, ne transforme pas le moi. Au contraire, elle le protège. Elle permet que le moi reste intact. Elle le protège de l’angoisse. Et c’est souvent dans ces moments-là, au moment de tomber amoureux, au moment d’un événement où monte le désir, mais de quel ordre est cet objet ? L’investissement libidinal, etc, etc. Tandis que l’identification narcissique transforme le moi parce qu’elle amène la relation perdue et son conflit à l’intérieur du moi où il n’y a plus de protection. Et la conséquence de porter à l’intérieur du moi cette relation perdue et son conflit, c’est un clivage douloureux et c’est ça que va prendre Szondi de Freud. Un clivage douloureux entre l’instauration d’un tribunal intériorisé qui prononce un verdict, une impardonnable culpabilité du moi. Mais comment, tu oses dire que tu as aimé l’autre ? Paf, je constate que l’autre n’était là que pour moi-même parce que sans lui, je ne serais pas grand-chose. Mais, lui, l’autre, il n’a servi que pour moi, pour gonfler mon moi. Alors, là, si tu fais un accès mélancolique, je n’ai pas besoin de porter plainte contre toi, tu portes plainte toi-même, et le verdict est vite fait. Une impardonnable culpabilité. Et on imagine bien que Szondi a pris ça, lui l’homme paroxysmal, l’homme du juge, du tribunal. Il va prendre ça chez Freud. L’identification narcissique, dit Freud, altère le moi, transforme le moi mais le salaud de mélancolique, c’est un salaud le mélancolique, il préserve l’objet auquel il ne renonce pas. Il ne peut pas renoncer à l’objet et tant mieux qu’il ne peut pas, sinon il se tue… mais, dit Freud, pour son malheur. SD : il est compatissant ML : Non !! Je ne sais pas s’il compatit. Il ne comprend pas la douleur. L’identification narcissique et l’identification mélancolique sont synonymes et il va le développer en mettant en rapport le type du choix de la maladie. Et Abraham développe cette étape du développement libidinal et surtout la phase cannibalique. Je dévore l’autre, je le prends en moi. Les crimes passionnels sont souvent des crimes mélancoliques. Comme ça il m’appartiendra toujours et il ne bougera pas. Sauf quand moi je veux. Je peux le vomir. Là, il bouge. Donc il dit qu’il existe un moi qui choisit son objet, ça veut dire quoi, qu’il le dévore, qu’il l’incorpore, qu’il le transforme dans le moi. Pour Szondi, c’est très important. Choisir quelqu’un. Est-ce cannibalique ou pas ? Est ce sadique ou pas ? Il doit donc y avoir dit-il quelque chose de plus pour pouvoir l’incorporer. JA : gardes-en pour demain. rires ML : oui. Vous êtes fatigués ? Pourquoi je le garde en moi, pourquoi je ne peux pas le lâcher ? Parce qu’il y a de l’ambivalence. Si je ne le garde pas, l’autre peut me taper dessus, donc je le fais à mon image. Bon, et voilà, c’est tout. On verra ce qu’on fait demain matin. Samedi 11 Janvier 2014 Georges a demandé de reprendre au point où Freud rajoute quelque chose. Et c’est vrai… là, j’ai pataugé. C’est la première fois que Freud utilise cette notion-carrefour, l’identification inconsciente, l’identification narcissique ou l’identification mélancolique et comme toujours, pour essayer de mieux cerner l’identification narcissique, il la compare à l’identification hystérique. L’identification narcissique provoque une transformation du moi. Et dans la mélancolie, cette transformation du moi se produit en important la relation perdue et son conflit à l’intérieur du moi. Il va y avoir dans le moi ce clivage douloureux et ce tribunal intériorisé prononce un verdict, c’est à dire cette impardonnable culpabilité du moi. LFC : Dans la mélancolie de Burton, il n’y a pas du tout cette notion de culpabilité ? ML : Non, il dit très bien qu’il n’y a pas du tout de honte. LFC : donc, là, on ne parle pas de la même mélancolie. ML : mais le coup de génie de Burton, à la fin de la renaissance, c’est de décrire par la forme satyrique cette folie. Et chez nos peintres flamands, à la même époque, il y a cette monstruosité sans aucune honte. LJ : il y a ce musée à Bruges qui est époustouflant DP : Il faudrait aussi bien distinguer la honte de la culpabilité, en particulier chez Herman. ML : Oui ! Et on disait hier que Freud n’avait rien inventé quand il écrit qu’il n’y a pas de honte dans la mélancolie. LFC : Tu disais hier que Burton évoquait les critiques vis-à-vis du monde de la mélancolie, mais qu’il ne parlait pas des autoreproches tels qu’ils sont décrits par Freud. ML : Oui, mais la manière dont Burton présente le mélancolique comme un acteur/auteur masqué qui se présente ainsi doublé, il existe toutes ces critiques qu’il se fait à lui même, à l’auteur, mais c’est lui l’acteur. Dans le moi mélancolique chez Freud, il y a aussi un doublement, cette instance critique divisée en deux, cette scission… GP : D’où nait la culpabilité ? ML : il n’y a pas de culpabilité en soi, mais cela peut aller jusqu’au délire de culpabilité ! GP : Et l’autocritique ? ML : dans la mélancolie simple, non, il n’y a pas de culpabilité. LFC : Mais quand le mélancolique tient des propos comme « et si je n’avais pas fais ceci ou cela, cela ne se serait pas produit » ML : ah, ça, c’est la phénoménologie. C’est autre chose. C’est à partir du temps. Freud ne parle pas de ça. LFC : Mais l’autoreproche ? ML : L’autoreproche chez Freud est un reproche adressé à l’autre. Il y a deux instances dans le moi. Cette scission du moi. Le moi qui se reproche par le moi qui juge. Public : c’est un jeu Public : c’est un reproche à lui qui n’est pas lui ML : c’est le moi. C’est un jeu d’acteur. GP : Quand on dit « l’ombre de l’objet qui tombe sur le moi », en quoi consiste l’ombre ? ML : L’ombre ? On ne sait pas. C’est par l’identification. Freud dit qu’on ne sait pas. C’est un travail très énigmatique. On ne sait pas comment on peut l’aborder. C’est qui l’autre ? C’est à partir de là qu’il va dire que le narcissisme existe par le mécanisme de l’identification. Il n’y a pas le narcissisme puis l’identification. C’est l’inverse. Il y a l’objet aimé et perdu qui va constituer le narcissisme. Et l’ombre de l’objet c’est cette combinaison entre le moi qui émerge à partir de cette identification. Mais on ne sait pas. Il dit en même temps que la libido qui est investit dans l’autre est peu résistante. Il n’y a pas grand-chose. C’est pour ça qu’il peut tomber sur le moi. Donc c’est une partie énigmatique de l’objet. Le mélancolique sait qui il a perdu, mais il ne sait pas ce qu’il a perdu. C’est quoi « ce » qu’il a perdu ? C’est ça qu’il a perdu. LJ : L’autre il est juste là un peu présent ? ML : Il est dévoré. C’est là où on va. Il est incorporé. Il ne reste rien. LFC : l’objet peut changer ? ML : le thème peut changer. Mais on reprendra ça plus tard. C’est une toute autre approche de Binswanger. Il a dit à Freud qu’il n’était pas allé assez loin. Mais revenons à Freud. C’est crucial de bien comprendre ce qu’est l’identification. Si l’identification est le stade préliminaire qui rend possible le choix d’objet – l’ombre de l’objet a à voir avec le choix de l’objet qu’on fait. Et on avait dit hier soir, que le choix d’objet était ancestral… pour m’aimer moi-même, quelle est la trace de l’arrière grand-père ou de l’arrière grand-mère dans mon choix d’objet ? Déjà dans le choix d’objet d’amour, il y a une ombre de l’ancestral. Mais on n’en sait rien. Même douze ans d’analyse sur le divan ne va pas découvrir nécessairement la trace de l’arrière-arrière grand-père ou grand-mère dans notre choix d’amour. GP : ça sert à quoi alors ? ML : à rien ! (rires) à s’occuper un peu ! Public : à s’endormir ! (rires) ML : à payer sa culpabilité qu’on s’endort auprès de quelqu’un sans plus ! (rires) DP : qu’on s’endort à l’ombre ! (rires) ML : si l’identification, dit Freud, est la première manière dont le moi élit son objet, alors elle est l’œuvre du narcissisme puisqu’il existe un moi qui élit son objet. Et c’est toute cette dialectique chez Freud ! L’identification manifeste fait apparaître le moi. Sans le mécanisme de l’identification, on ne peut pas parler du Moi. Aimer l’objet dit-il, c’est le dévorer, c’est l’incorporer, c’est le transformer dans le moi. Et il ajoute qu’une telle incorporation n’entraine pas, pour chacun de nous, une mélancolie. Cette incorporation est nécessaire pour nous tous, mais cela n’entraîne pas pour nous tous une mélancolie, ou une position dépressive, comme chez Mélanie Klein. Freud dit qu’il doit y avoir dans la relation narcissique du mélancolique quelque chose de plus que l’incorporation pour provoquer la mélancolie. Et c’est là qu’il parle de l’ambivalence, de l’intensité de l’ambivalence. Et il va, pour une fois, être d’accord avec un élève, Karl Abraham. Il va se référer explicitement à Karl Abraham et à ce qu’il avait élaboré autour de la dépression névrotico-obsessionnelle. On connaît bien l’ambivalence obsessionnelle mais qu’est ce qui fait qu’il y a cette dimension dépressive dans la névrose obsessionnelle ? Freud dit que le deuil pathologique de l’obsessionnel a un lien avec les autoreproches qu’il se fait. Il se sent responsable de la mort de l’objet. Après la mort, nous sommes en présence de ce que le conflit d’ambivalence produit à lui seul. Il n’y a pas de retrait de la libido dans le moi et les autoreproches se produisent tout seuls. Les autoreproches procèdent du retournement des pulsions sadiques et haineuses sur le moi mais le moi ne disparaît pas. Ce retournement s’opère par identification à l’objet mais le moi reste intact dans la névrose obsessionnelle. C’est une scène. Il va jouer sur la scène devant lui cette structure d’ambivalence de la haine et de l’amour mais le moi reste spectateur. Ça, c’est l’approche de Lacan de la névrose obsessionnelle. Il va se mettre dans les gradins d’une arène et il se regarde sans savoir que c’est lui qui est dans l’arène en train de tuer l’autre. Personne ne sait que c’est lui et lui d’abord mais il n’empêche que lui, il regarde bien. GP : oui, comme tous les névrosés ML : oui, exact GP : comment peut-on entendre la dimension du sevrage par rapport à la perte de l’objet? ML : dans le deuil, comment je peux me sevrer de quelqu’un ? GP : comment une crise vitale se résout en intention mentale ? Tout à l’heure, tu parlais d’incorporation d’objet, c’est un objet réel qui est incorporé. Le lait… il est arrêté… le lait est au bébé mais le sein est à la mère... Tu parles de la dimension cannibalique… c’est parce que l’enfant refuse de perdre le sein qu’il va le représenter. Donc la dimension cannibalique… ML : mais Freud dit : qu’est ce qui fait que cette incorporation n’entraîne pas pour chacun d’entre nous une mélancolie ? C’est là où il dit qu’il faut quelque chose de plus. Et donc, il prend Abraham et dit qu’il ne faut pas seulement une dimension orale mais aussi une dimension anale. Cette ambivalence, ce conflit, cette haine sont nécessaires pour déclencher une mélancolie. GP : le corps est orienté alors ML : je ne sais pas si le corps est orienté, ça c’est un autre langage GP : il y a la bouche d’en haut et la bouche d’en bas. ML : oui, ça, ce sont des images du corps. En tout cas, ce n’est pas le langage de Freud. GP : non, mais c’est pour voir s’il y a des liens, pour pouvoir l’articuler. ML : quel est le langage d’Aulagnier ? Là, c’est presque des pictogrammes. Peut-être que c’est à partir de là, des textes de Métapsychologie et les autres, ce qu’on expulse et ce qu’on garde. GP : quand tu parles de l’ombre de l’objet, cela me fait penser à comment cela tombe dans le corps. ML : oui, mais, ce n’est pas le langage de Freud, ça. GP : le moi n’est pas constitué, il est en phase de constitution ML : moi, j’aime bien quand Freud dit que le moi n’existe pas. C’est par l’identification qu’on voit que le moi marche. S’il n’y avait pas d’identification, il n’y aurait pas de moi. Il y a cette dialectique entre l’identification et le moi. L’un ne va pas sans l’autre. Le narcissisme ne fonctionne que s’il y a identification. Ça, c’est la trouvaille de Freud. Le moi se constitue par l’identification. Et on voit bien dans les névroses et surtout dans la névrose obsessionnelle où il y a la question de la haine et du sadisme plus que dans les autres névroses, -la haine n’est pas primordiale dans l’hystérie, au contraire c’est plutôt l’idéal-, on voit bien que le moi n’est pas touché, il n’est pas transformé. Il regarde, intact. Il va rester intact. Et personne ne s’aperçoit que c’est lui qui est en question. Il peut projeter dans l’arène ce qui se passe. Lacan utilise l’image de l’arène pour rendre compte de ce qui est énigmatique pour Freud, ce travail intérieur. GP : l’arène intérieure a son pourtour de gravats ML : je ne sais pas GP : c’est Lacan, quand il parle du moi. ML : Ah bon ? GP : Oui, pour Lacan, le stade du miroir, c’est dans les 6-18 mois ML : Oui, oui, oui… mais il a toujours dit que c’était pour faire plaisir à je ne sais qui…. GP : c’est d’abord dans l’autre que je me reconnais. C’est le premier temps. ML : oui, la me-connaissance est une méconnaissance, oui. GP : c’est propre à l’être humain ML : ce qui est important pour Freud et je ne sais pas s’il aurait été d’accord avec Lacan, c’est « explique-moi ce moment jubilatoire ». Il constate chez le petit, quand il va s’aliéner dans cette image, que cela provoque un moment jubilatoire. Ce qui intéresse Freud c’est ça. « Qu’est ce que c’est ce moment jubilatoire ? » « je ne peux pas expliquer la joie triomphante du maniaque ni la douleur du deuil. ». Qu’est ce qui est de la joie dans l’aliénation ? JA : sur la figuration de la mort, est ce qu’on a des petits mélancoliques ? Cela arrive plus tard la mélancolie. ML : je ne crois pas. Il y a profondément des structures maniaco-dépressives chez tout le monde mais il n’y a pas de mélancolie chez tout le monde. Freud dit que la mélancolie est un trouble du moi. C’est un trouble du SCH dans le Szondi. Il y a des dépressions partout, c’est universel, mais pas de mélancolie. Non, il n’y a pas de petits mélancoliques. Dans la littérature peut-être… Baudelaire appelle sa maladie une petite mélancolie. JA : à l’adolescence, c’est une étape quand même… ML : non, ce n’est pas une étape. Il y a des moments de joie, il y a des moments de vide, on ne peut jamais expliquer pourquoi, c’est ça qui donne le rythme de la vie. Quand il n’y a plus ces alternances, cela peut s’immobiliser et devenir une maladie. Mais cela n’a rien à voir avec l’adolescence ou les petits… en tout cas, les petits, les ados, les adultes sont des coupures qui ont été introduites à la fin du XIXème, avant cela n’existait pas. Donc, il faut arrêter de dire que cette classe d’âge correspond à quelque chose de spécifique… JA : c’est quand l’enfant commence à penser la mort. ML : c’est quoi la mort pour un enfant ? C’est quelque chose qui ne continue pas à naître. « Mon lapin qui meurt, c’est plus important que la mort d’un grand parent qui a vécu 100 000 ans… tout le monde pleure le grand-père et personne ne s’intéresse à moi qui pleure mon lapin qui a vécu 2 jours. » ça marque un petit. C’est ça la mort pour un petit. C’est de ne pas pouvoir continuer à naître. « Ah, vous avez tous un délire d’immortalité, vous ! » Le mortel est impossible pour le petit. « Mais vous êtes impossibles ! » C’est ça la mort pour le petit. « Laissez le grand-père ou le grand-mère tranquilles, ils ont fait plein d’enfants, ils peuvent être tranquilles maintenant ». Ce qui intéresse l’enfant dans un petit oiseau qui est mort, c’est comment le faire renaître. Et Freud demande ce qu’est le suicide. Hier on posait la question pourquoi la mélancolie fascinait tant les gens. Parce qu’il y a cette question de la fureur, de la haine, du chagrin et le mystère du suicide. Pourquoi on ne peut pas attendre la mort ? Pourquoi on se la donne ? Pourquoi on est impatient avec quelque chose qui est là ? Qui ne s’est jamais trompé dans l’histoire. Personne n’est jamais devenu immortel. GP : le germen est immortel dit Freud dans Introduction au narcissisme. ML : ah peut-être… oui… elles ne peuvent pas se suicider. Le retournement de cette haine peut avoir dans la mélancolie des effets catastrophiques. Et c’est ça qu’explique bien la phénoménologie. Et c’est peut-être cette approche-là du suicide qui a ouvert le champ de la phénoménologie. Il n’y a qu’un acte, et je trouve ça terrible, qu’un acte transcendantal vital du mélancolique, c’est le suicide. C’est ça qu’a abordé la phénoménologie. Freud dit que c’est le sadisme qui fournit l’explication de cette énigmatique tendance au suicide. Freud dit, et je lis : « L’analyse de la mélancolie nous enseigne que le moi ne peut se tuer que lorsqu’il peut, de par le retour de l’investissement d’objet, se traiter lui-même comme un objet, lorsqu’il lui est loisible de diriger contre soi l’hostilité qui concerne un objet et qui représente la réaction originelle du moi contre des objets du monde extérieur. » Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il peut se tuer. Et on retrouve ça chez Abraham. Cette tendance énigmatique au suicide. Pour Abraham, et moi j’aime bien ça, la mélancolie est la forme archaïque du deuil. Il y a un moment introjectif cannibalique dans le deuil. Il n’y a qu’à regarder les rites funéraires. Il va mettre l’accent sur le lien entre le cannibalisme, le deuil et la mélancolie. Il va développer quelque chose que Freud n’avait pas vu, c’est l’introjection du mort. Pourquoi on garde le mort. L’introjection du mort qui assure la pérennité du mort à l’intérieur du moi. L’objet aimé qui meurt survit dans le moi. C’est très actuel. Par exemple, cette énigme de ceux qui ont survécus dans les camps et qui se sont suicidés comme Primo Lévi, Bettelheim. L’objet aimé métabolisé dans le moi est le seul moyen que le moi puisse continuer à vivre. Abraham dit que le moi ne dispose que de cette seule ressource narcissique, l’introjection métabolisée pour garder l’objet et pour se maintenir en vie. Si on va se sevrer de l’objet aimé, on meurt. Public : Le moi meurt. ML : On meurt ! Le suicide peut arriver ! Moi, j’adore faire des entretiens avec des gens à qui on peut demander, sans qu’on nous prenne pour des fous, d’aller chercher une chaise pour les morts. Et on peut ainsi avoir 6 ou 8 chaises, comme ça, autour de nous et comme le dit von Weizsäcker, on fait le tour, on demande la permission pour faire la conversation. Au lieu de les éliminer, de dire qu’on va les oublier ! C’est ça qu’il dit Abraham. Le moi ne dispose que de cette ressource narcissique pour se maintenir en vie. Mais mon cœur gonfle. Tu t’imagines tous ces morts qui sont là ! Et là-dedans, il peut y avoir des gens que j’ai beaucoup aimés, une arrière grand-mère par exemple... Et il dit que dans la mélancolie, à travers les autoreproches, dans le fait de dire que je suis un monstre, que je ne vaux rien, que je suis le plus mauvais, etc., etc., et bien, dans ces autoreproches, il y a une énorme toute-puissance. Il y a une surestimation de soi. Et c’est là-dessus que Szondi continue. Il y a une toute-puissance inversée. Et celui qui se prend pour rien du tout ne se prend pas pour rien. La part du moi qui est ainsi surestimée, c’est la haine. C’est la haine qui est énorme. Cette démesure en négatif dit Freud, cette démesure de la haine, -qui touche le moi bien sûr-, cette démesure démoniaque laisse percer le narcissisme mélancolique. Abraham dit qu’il y a souvent chez le mélancolique quelque chose de Faust. Un des plus grands textes de la littérature, c’est Faust. Le pacte avec le diable. A Louvain, il y a un prof, qui est mort maintenant, qui a consacré toute sa vie à un petit texte de Freud sur un peintre « La névrose démoniaque au XIXème siècle ». C’est un tout petit texte d’une dizaine de pages. Et ce prof a consacré toute sa vie aux archives de ce texte. Quel était ce peintre, quel était son délire, et quel était ce pacte avec le diable, le contexte de Faust, quand Starobinski décrit Méphistophélès comme un grand mélancolique, c’est parce qu’il s’identifie au diable. Cette haine diabolique ! ça c’est le rapport de Abraham à la mélancolie. Cette ambivalence qui va aller jusqu’au délire démoniaque ! Voilà. C’est un peu plus clair qu’hier soir ? On passe à qui ? Tellenbach ? Cette pensée psychiatrique qui passe par la sémiologie chez Kraepelin, passe aussi par une méthodologie typologique. Et Tellenbach va constituer une méthodologie centrée autour du type mélancolique. Mais qu’est ce que ça veut dire « type »? Son livre La mélancolie n’est plus édité. La première édition était en 1961 et la troisième en 1976. Il a aussi écrit un livre « Goût et atmosphère ». Donc on va aller dans un monde qui n’est plus du tout un monde mécanique. On peut dire tout ce qu’on veut, que la logique psychanalytique est géniale, mais cela reste un peu mécanique. On va substantifier des termes et on va essayer de les associer l’un à l’autre par des mécaniques. La phénoménologie, elle, va essayer de rendre possible toutes ces mécaniques. Ils sont bien ces concepts, mais ils viennent d’où ? Qu’est ce qui les rend possibles ? On arrive dans cette zone-là. On doit faire un tour dans la tête et passer d’une pensée mécanique à une pensée de possibilité. Tellenbach fait la différence entre un symptôme et un phénomène. Il part d’un exemple très simple : le névrosé obsessionnel est hanté par la propreté et le symptôme est toujours le même ; par exemple il passe son temps à se laver. C’est un symptôme. Mais l’analyse phénoménologique met en évidence une intentionnalité tout à fait divergente du même symptôme. L’analyse phénoménologique n’explique pas le symptôme mais essaye de voir quelles sont ses possibilités. Dans un cas, c’est possible que cela soit pour éviter de salir les autres et dans un autre cas, c’est pour se débarrasser de la saleté qui est sur lui. Ce sont deux phénomènes très différents. C’est à partir de là qu’il fait la différence entre le symptôme et le phénomène. La phénoménologie étudie les phénomènes et pas les symptômes. Dans mélancolie et manie, Binswanger dit qu’il faut dépasser la symptomatologie. D’accord Freud, d’accord les autoreproches, l’absence de honte, d’accord l’objet perdu. Mais ce qui intéresse les phénoménologues sont les conditions de possibilité de la thématique. Ce qu’il va appeler la thématique. Ce qui se détache du thème pour nous ouvrir un autre espace. Dans un premier temps, on laisse les symptômes et on va étudier ce qui les rend possibles. Phénomène. L’analyse phénoménologique s’occupe des phénomènes. C’est ce qui est le plus souvent caché, l’intentionnalité est le plus souvent cachée : il ne peut pas s’empêcher de se laver mais on ne sait pas son intentionnalité. Le symptôme nous montre quelque chose qu’on est tenté d’expliquer parce qu’on a toute une conceptualisation d’avance, un modèle théorique, nosologique, comportementaliste, psychanalytique, etc. qui nous donne un moyen pour interpréter le symptôme. Je ne peux pas arrêter de me laver. Le comportementaliste va donner un sens complètement différent d’une approche psychanalytique ou interactionnelle ou je ne sais pas quoi. Donc, le symptôme qui nous tombe dessus est interprété selon une afférence diagnostique. Cela n’intéresse pas la phénoménologie. Elle étudie seulement le phénomène. Ce n’est pas un indice de maladie comme dans la symptomatologie mais c’est une manière d’être qui est directement liée à l’expérience phénoménologique. Ça, c’est la première chose, la différence entre symptôme et phénomène. Deuxième chose : Tellenbach va approfondir un vieux concept qui reprend Platon, Aristote, il reprend cette idée fondamentale, la physis et il va donner ce concept profond qui englobe tout : l’endon. Qui va donner endogène. Pourquoi il fait cette sorte de métaphysique ? On lui reproche. Comment ! Tu fais de la philosophie, tu ne fais pas de la clinique. Il dit qu’il utilise ce terme car toutes les explications somatiques, biologiques, psychologiques, psychanalytiques sont insuffisantes. Parce que cela ne peut pas expliquer la globalité de la maladie. Il constate que Freud, dans « Deuil et mélancolie », en faisant un tableau de la symptomatologie de l’être humain dans un état dépressif n’explique pas. Il n’explique pas pourquoi le dépressif ne peut pas se lever et fait la fête le soir. Il ne peut pas l’expliquer. Il le constate. Pourquoi il y a cette asthénie ? Pourquoi il y a cette lourdeur? Freud dit bien que la douleur, la joie, il ne peut pas l’expliquer. Tellenbach plaide pour une approche endogène, c’est à dire pour penser ensemble les modifications nycthémérales, c’est à dire les troubles de rythme et les mécanismes psychiques. Le processus endogène, l’endokinèse, le mouvement de cet ensemble pour pouvoir penser tous ces phénomènes ensemble. La mélancolie de Tellenbach est un grand classique. Moi, je l’aime beaucoup. Donc il reprend ce concept grec de physis, la nature d’Aristote et il traduit physis par endon pour décrire le processus comme source d’énergie, energeia, le processus de nature qui rend cohérent dans un ensemble le moi et le monde. On ne va couper le dedans et le dehors. En psychanalyse, souvent on coupe le dedans et le dehors. Il n’y a pas de coupure. Il y a toujours une réciprocité entre le dedans et le dehors. Chez Lacan aussi ! La bande de Moebius, c’est bien pour dire qu’il n’y a pas de coupure entre le dehors et le dedans. La mélancolie chez Tellenbach est une révélation de cette liaison originaire du moi et du monde et du monde et du moi qui se manifeste sous des formes spécifiques dans des situations spécifiques. On quitte le mot objet. On quitte la logique de l’objet et on passe à une logique de la situation. Il ne parle plus de l’objet. Oublions le mot objet. Et Lacan, il est mignon avec son objet a ! C’est une trouvaille mais… pfff… il faut chercher sa queue à l’objet a, hein ! Là, la phénoménologie dit fini l’objet ! Fini ! On parle de la situation. Et bien, ces formes et ces situations est ce qu’il appelle endogène. Cette liaison originaire du monde et du moi se montre dans la mélancolie sous des formes spécifiques dans des situations spécifiques. Ça, c’est la deuxième chose. Première distinction symptôme/phénomène, deuxième distinction, objet/situation. Bon, c’est ainsi que j’ai abordé la mélancolie. C’est un livre difficile et je l’ai abordé ainsi pour que vous puissiez le travailler, le concept d’endon. Troisième chose : la description d’une structure typique. Le type mélancolique qui vit dans des situations caractéristiques, on donnera des exemples, ces types mélancoliques qui ont un vécu qu’il ne faut pas bouger. J’anticipe : quand vous travaillez en psychiatrie ou dans la santé mentale, toutes ces conneries, on entend : « on a un projet pour lui ! Il va se déplacer. Il va venir à un atelier. ou si on est un peu pervers, il a 25 ans, il pourrait sortir de la maison familiale, de la niche, il faut qu’il déménage ! ». Aaaah. Quand quelqu’un est touché par le type mélancolique, attention ! Il peut là, glisser inévitablement vers un état mélancolique. Et Tellenbach dit que deux concepts sont importants : situation et type. Qu’est ce que la situation ? Comment dit-on que l’homme n’est pas un objet mais en situation ? L’être humain est lié aux autres par être en situation de. Une relation originaire entre une personne et le monde qui n’est pas statique et qui produit. La relation est une production constante de l’être au monde. En français, ils ont forcé le mot : l’être au monde situationne constamment le monde. Il n’est pas objet, il situationne toujours. Et cette situation qu’il situationne, elle est vécue. Et Tellenbach dit que la vie humaine et une succession permanente de vivre des situations. On utilise ce mot tout le temps et on ne s’y arrête pas. La phénoménologie le fait et s’arrête sur les mots qu’on utilise souvent et auxquels on ne fait pas attention. « Il est dans une situation difficile ! ». Si on fait attention, on peut voir que l’on utilise énormément ce mot « situation ». Il dit : « la situation du type est quelque chose qui se laisse appréhender comme produit par la typique d’une personne. » dans le commerce les uns avec les autres, comment je peux situer le par rapport à l’autre ? Parce que sa situation est typique. Le type constitue le contexte de renvoi aux autres hommes comme telle ou telle situation de telle ou telle personne. Je cite Tellenbach : « Le type situationne ceux-ci selon leur spécificité propre. » Cela arrive, quand on dit qu’on reconnaît telle ou telle personne à sa façon de marcher, à son pas. Il n’a même pas besoin de parler. On le reconnaît. C’est typiquement lui. Le « typiquement » renvoie à la situation du sujet d’être au monde. LJ : est ce qu’on peut parler de singularité ? ML : c’est plus large, car la singularité, on ne peut pas en faire un ensemble. Le type situationne selon leur spécificité. Tout le monde est singulier mais ce n’est pas pour autant qu’on peut le nommer. La méthodologie de la typologie renvoie aux autres. De se situer dans un ensemble. Et la connexion entre type et situation se montre, dit-il, dans deux mécanismes fondamentaux de la mélancolie : l’includence et la rémanence regroupés dans le mot intraduisible, je ne sais pas comment ils l’ont traduit… ordentichkleit, l’esprit d’ordre. Ordentichkleit est le mot fondamental, difficile à traduire : c’est quelqu’un qui vit selon un ordre dans le temps et dans l’espace mais aussi la manière. Il vit selon la morale. Il faut vivre comme il faut. Il faut s’adapter aux convenances, selon le sens du devoir. « Mets-toi correctement à table. Quand on est en famille, tu peux laisser rouler ton tracteur sur la table, mais quand il y a des gens qui viennent, il faut être convenable. Les convenances c’est pour le public. » « Je ne comprends plus rien. Pourquoi faut-il être comme ça quand quelqu’un vient ? Est-ce le représentant de la morale ? Il y a le représentant des machines à laver et le représentant de la morale. ! » Pour le petit, c’est quelque chose ! Cela s’apprend mais ne se comprend pas. Le texte de Maldiney, Comprendre, parle de ça : il y a en nous, dans notre vie, une césure, entre apprendre et comprendre. J’apprends des choses que je ne comprends pas. Et je peux demander à mes parents, mais ils sont bouche bée : « c’est comme ça ! Tu te tiens droit quand les grands parents viennent ! ». Tout cela est inclus dans le concept ordentichkleit. Au niveau de l’espace, Tellenbach dit qu’il y a une tendance au maintien de tout ce qui est donné : le d-. Il y a quelque chose qui est là, qui est donné. Vous êtes mariés, vous êtes heureux. Qu’est ce que vous avez encore à faire dans votre vie ? Le garder ! d- ! Retenir, garder, conserver. Cette tendance à maintenir ce qui est donné. Ce peut être toute la vie. Et quand il y a un mort ou une maladie dans une famille où je m’épanouis, ça peut glisser vers la mélancolie. Donc, quand on travaille en clinique, c’est très important de toujours tenir compte de la situation qui peut changer d’un jour à l’autre. Au niveau du temps, ce sont des gens qui sont des fanatiques du programme. Le goût de ce qui est programmé, de tout ce qui peut se programmer. En 1961, il donne l’exemple prophétique des programmes de télévision. Depuis les années 60 ils se sont multipliés ! Enormément ! Il y en a maintenant une quarantaine. On les trouve près de la caissière dans les supermarchés. Et ça touche profondément l’esprit d‘ordre, l’ordentichkleit. Donc ils vont jouer avec ça, et ça produit des conneries ! J’ai demandé à la caissière : mais vous en vendez combien ? Elle m’a répondu : énormément ! Et il paraît qu’il y a une lutte terrible pour celui qui sera proposé juste à côté de la caissière. Vous ne vous êtes pas aperçus ? Et bien, je crois que si on veut faire de la recherche clinique, ce sont les endroits où il faut aller, où les gens sont en situation. On ne va pas étudier quelqu’un mais on va étudier le vécu dans telle ou telle situation. Et quand on regarde des personnes qui vivent leur petite vie dans leur petite maison, on n’a pas à juger, il y a toujours tout près, la télécommande et un programme TV. Ça fait de l’ordre dans leur vie. C’est ça le travail clinique ! Il dit ça en 62, Tellenbach ! Cet esprit spéculatif, il était un homme très grand, imposant, sérieux. Et il racontait ces histoires là au bistrot, il prenait un Schweppes… il avait un humour… Chaleureux, très chaleureux, timide, et qui raconte qu’il avait été voir des caissières de supermarchés pour demander… et moi j’étais jaloux, et j’ai fait la même chose. Et c’était aussi pour organiser à La Borde un atelier télé et pour ne pas qu’il y ait le soir la bagarre pour regarder les programmes. Il y avait un petit gamin que je suivais, et son paroxysme montait, montait parce qu’il cachait la télécommande… la dernière fois, je lui ai dis : je vais trouver pour toi, pour Noel, une télé doudou. Mais je n’en ai pas encore trouvé. D’ailleurs, j’en profite pour vous demander : est-ce que vous savez où je pourrais trouver une télé doudou ? GP : il te faut aussi un plaid… et un oreiller… ML : oui, c’est ça que je cherche… allez tu me le donnes Public… rires ML : donc l’esprit d’ordre au niveau de l’espace et du temps donne aussi d’autres traits de ce type mélancolique : un degré élevé d’auto exigence, bien sûr. C’est une sur-identification au rôle social, professionnel, ou intime. Il n’y a pas de distance entre le moi et le rôle. Il n’y a rien de pire pour quelqu’un qui est touché dans cette zone de la vie de l’esprit et de l’ordre, il n’y a rien de pire que d’être dans la solitude. Il n’y a rien de pire parce qu’ils ne peuvent pas s’identifier à un rôle. Ils sont seuls. La vie du type mélancolique est donc, dit-il, une vie qui est soumise au travail, au devoir et à une conscience morale pour garder l’ordre pré-donné. Le travail, le devoir, la conscience morale sont les gardiens de l’ordre pré-donné. Que cela ne bouge pas. Si ça bouge, si il y a un changement, il y a peut-être quelque chose qu’il n’a pas bien fait. Il est en faute. Il y a chez ces types mélancoliques, toujours une menace de la faute. Ils prennent tout au sérieux. Et c’est par là qu’il aborde Kierkegaard. Il a écrit un livre sur Goethe et Kierkegaard pour préparer son livre sur la mélancolie. Il a fait une sorte de pathographie de Kierkegaard et de Goethe comme tous les deux types mélancoliques en disant que tous les deux prennent tout au sérieux. Il donne plein d’exemples. Et il y a le texte de Kierkegaard sur le sérieux. Il n’avait pas le choix de ne pas travailler. Il dit par exemple de Kierkegaard qu’il met en question toutes ses constructions de système qu’il brise. Pourquoi ? Pour délimiter autrement. C’est ça le sérieux. Tout ce que je vis doit être délimité. Avec des limites très précises. Et c’est là-dedans qu’il s’enferme dans les limites et c’est à l’intérieur de ces limites qu’il peut trouver un équilibre et une certaine indépendance. Je suis même indépendant de Dieu, dit Kierkegaard. Je suis dans la foi mais je fais des péchés pour montrer mon indépendance par rapport à Dieu. Parce que je l’ai délimité dans ma vie. Ce n’est pas celui-là, ce n’est pas celui-là, ni celui-ci… mais celui-là. Donc cet équilibre et cette indépendance sont extrêmement fragile parce qu’il n’y a pas d’ouverture au changement. Et quand il y a un changement, c’est un changement pour pouvoir le délimiter tout de suite. Il n’y a jamais que des buts proches et il ne peut pas vivre dans la perspective. Ça, c’est la première grande chose, c’est la grande auto exigence. La deuxième tendance est la tendance à la communication symbiotique. Pour Tellenbach, communication symbiotique c’est faire pour autrui. Il fait pour autrui, il fait à la place de l’autre, pas comme un masochiste mais pour ne pas être en faute ou en dette. Si l’autre fait quelque chose pour moi, je pourrai lui être redevable. Non ! Pas de dette ! Surtout vers l’autre familial. Alors, dette. C’est difficile en français. Pour nous c’est facile. Debet. Débit. Dans le sens financier. C’est dans ce sens là. JA : parfois, on vient au secours des surendettés et on leur raye leur ardoise ML : ça, c’est terrifiant pour le mélancolique. Toutes ces conneries sont terribles pour le mélancolique, c’est invivable. GP : on n’en voit plus des mélancoliques ! ML : on n’en voit pas parce qu’ils sont trop proches. Ils sont là ! SD : ils sont partout ! (rires) ML : ils sont là ! Viens un peu à La Borde. Il y en a qui tombent profondément malades et qui sont dans une souffrance suicidaire, dans une souffrance d’errance… comment se fait-il qu’ils n’arrivent pas à faire les formalités administratives ? C’est parce que leur spécificité typique est interpellée et ils ne peuvent pas faire les changements. Va à la préfecture pour faire ton passeport. C’est rien du tout mais c’est énorme ! Le type mélancolique qui peut glisser à ce moment là… Donc, faire pour autrui ou ne pas rester en faute dans le sens du débit, et c’est une terminologie de Heidegger, une sollicitude particulière. J’assume à la place de l’autre toutes ses tâches. Tous ses besoins, tout ce qu’il a à faire… je le fais à la place de l’autre. Cette sollicitude, fürsorge, j’anticipe, la protention du souci. Tous ces traits reposent sur une double négation : ne pas être non-ordonné, ne pas être non-actif. Ne demande pas à un type mélancolique de ne rien faire aujourd’hui ! Rien faire ? Aaaaaah ! C’est une catastrophe. Ne pas être indifférent. Ne pas être non-parfait. Tu t’imagines la souffrance ? Et c’est là que Tellenbach arrive avec les deux concepts : l’includence et la rémanence. C’est quoi l’includence ? Les limites, comme on l’a dit, sont capitales et elles protègent de ce qui peut compromettre l’ordre. Le type mélancolique, et là on arrive petit à petit dans le paradoxe, dans la contradiction insupportable qui va amener la crise, et qui va glisser inévitablement à l’état mélancolique, donc, le type mélancolique doit être séparé de ce qui peut le menacer mais en même temps il exige la proximité des autres et la proximité aux autres. Et là, -c’est le noyau de son raisonnement et là il donne plein d’exemples-, cette antinomie interne est toujours dans un équilibre critique. Il est toujours plus ou moins en crise. Et la crise devient vraiment menaçante, peut exploser quand il s’enferme dans des limites qu’il aurait à dépasser pour réaliser ses autoexigences. Il ne peut pas arrêter de travailler et quand il travaille, il doit bien faire. Il est trois heures de l’après-midi, il a fini ce qu’il devait faire. C’est parfait. Aaaaaah… il reste jusqu’à 11h du soir. Pour pouvoir continuer ses autoexigences, il doit dépasser ses limites. Donc tous les jours, il y a une possibilité de crise. Donc il doit programmer, et on doit le laisser pour qu’il puisse programmer un travail jusqu’au soir. A La Borde, ce n’est pas grave si la vaisselle est finie à 5h. Enfin, ça dépend avec qui ! Si certains sont touchés par ce situationnel mélancolique, ce n’est pas grave s’ils finissent la vaisselle vers 5-6 h de l’après-midi. Ce n’est pas grave. Mais il y a des obsessionnels et ce n’est pas du tout la même chose que le type mélancolique. Ils veulent que cela soit propre à 2h parce que sinon les microbes vont se balader, jusqu’à 5 h ça va pas non ? Et il y a de la viande de porc qui traîne encore à 4 h de l’après midi et qu’on doit remettre le couvert à 7h, tu t’imagines le bordel ? Mais ça soigne le type mélancolique ! Ce n’est pas cher pour la sécurité sociale. LFC : On pourrait dire que chez l’obsessionnel, il n’y a pas cette notion de sérieux ? ML : oui, tout à fait. Exact ! Il y a cette délimitation mais pour ne pas tuer. Il ne faut pas laisser trainer les microbes, car ils peuvent tuer quand même, et en même temps, c’est ça que je veux, mais de façon cachée. Cette collusion, comme dit Freud, entre le désir et la mort. Je désire qu’il crève, mais quand même, non… ! Je ne peux pas le montrer ! Tout ce travail paroxysmal qui peut amener jusqu’à la crise. C’est le phénoménologue Kuhn qui parle de l’includence et de sa pathogénie dans la dépression du déménagement. C’est un phénomène qui a été très étudié par Kuhn, Zutt, etc. : ils situationne le monde comme maison. Et s’y enferme en lui donnant de l’espace et en s’y fixant. Très sensible à ce qui est changement de maison, au déménagement, au changement dans l’aménagement. Dis-moi comment ta chambre est aménagée et je te dirai qui tu es. Qu’est-ce que le travail thérapeutique, le prendre soin de ? Ce n’est pas de creuser son âme, c’est mettre de l’ordre dans sa maison, dans sa manière de situationner son monde. Donc, on fait le ménage dans sa chambre. Et plus personne n’accepte de faire ça. Les infirmiers ne le font pas, les aides-soignants ne le font pas parce qu’ils donnent le bain, il faut des équipes d’entretien, des techniciens de surface, ou quelques âmes qui se dévouent pour faire le ménage, mais ça devient de plus en plus dramatique à La Borde. Il y a des gens qui viennent en stage et des gens les manipulent vite, ils sont superbement touchés et ils prennent le balai. Ou des gens passionnés… GP : vous ne faites pas l’analyse des pratiques ? ML : Mais justement ils en font trop. La pratique, c’est la pratique de la clinique et pas la pratique professionnelle. Et dans l’analyse des pratiques, on fait de l’analyse institutionnelle, et là, bien dis donc, bravo ! On peut en parler ! Il situationne le monde comme maison. Quand il déménage, il doit dépasser des limites de l’ordre de l’habitat, et cela ne passe plus. Ça, c’est l’includence. La rémanence, au niveau du temps. Ça, c’est la phrase, superbe, peut-être la plus originale du livre de Tellenbach : la menace de rester derrière soi. De rester derrière ses exigences à soi, mais surtout de rester derrière soi. Il est dans tous les cas, dit Tellenbach, l’être en faute quant à ses exigences, en ce qui concerne l’autre, la coexistence avec l’autre, les tâches à faire. Il est toujours derrière. Trop tard, en faute ! Le sentiment de faute apparaît comme le facteur décisif de la rémanence. Qu’est ce que ça veut dire ? Il donne deux exemples. Le premier dans le domaine professionnel : où est-il structuralement toujours en faute ? Il doit être, - ça, c’est totalement spéculatif de la part de Tellenbach, mais on le reconnaît tout le temps dans la vie quotidienne-, il doit être constamment actif, sans jamais remettre au lendemain. La perspective du type mélancolique est limitée à la journée présente, mais il exige en même temps l’exactitude et la justesse de ce qu’il fait. LFC : l’includence est à l’espace ce que la rémanence est au temps. ML : oui. donc il est toujours dans cette antinomie et à un moment, ça explose et il glisse dans l’état mélancolique. Dans la relation à l’autre, il se fixe le devoir d’être correct, il se fixe la tâche d’assurer la vie de ses proches. Et là, la perversion de la société… les assurances-vie. Bien sûr que c’est une clientèle énorme les types mélancoliques ! Qui ne va pas à la banque se faire une assurance vie ? S’assurer la vie ? C’est à dire se fixer, dans une délimitation donnée, la mort ? Il se fixe donc la tâche d’assurer la vie de ses proches. Ce qui exige, entre autres, l’indépendance matérielle. « J’ai ma cagnotte sous ma couette, et personne ne sait combien et ma tendre épouse me soupçonne que je vais voir les putes, parce que je lui cache, mais cela est pour s’assurer que je pourrais payer demain l’hôpital ou les lunettes… et quand elle dit que je vais voir les putes… » tchack… catastrophe mélancolique. Il ne comprend pas. Donc cela conduit à la surestimation de l’argent. Et toi, quand tu dis qu’il n’y a plus de mélancoliques, tu parles ! Ceux qui sont touchés, qui situationnent l’argent. Quand il tombe malade, c’est la première chose à laquelle il pense : mais comment assurer ? Comment je vais trouver un substitut de mon salaire ? C’est un souci ! Comment se fait-il qu’il n’y a pas de mélancolie en Afrique ? Il y a une solidarité qui se joue autrement ! Nous, on est des connards et on le sait même pas. Donc, conséquence, dit Tellenbach, cette menace d’être en faute, de ne pas être à la hauteur de l’autoexigence, peut faire passer du débit à la culpabilité qui ne peut pas être déchargée. Je suis toujours potentiellement en faute. Par exemple : Combien je paye la nourrice, celle qui va s’occuper de ma famille ? Quand on s’en va, on ne sait jamais ce qui peut se passer. La baby-sitter, on devrait la payer une fortune. Mais quand même, on va chercher quelqu’un qu’on ne va pas payer très cher, ou alors on va demander à des amis qu’on ne va pas payer… mais qu’on va payer quand même… Mais combien ? Pas le même prix qu’un ticket de cinéma ? Oh, peut-être quand même… on peut peut-être trouver un équilibre critique… je vais payer la nourrice 8 euros, 9 euros par heure et comme ça, on peut se permettre, comme couple de sortir au cinéma… voilà, cela le travaille toute la journée. Cet être en faute qui peut à certains moments se trouver en dette. La culpabilité ne peut jamais être déchargée, et elle est immanente jusqu’au délire parfois. Pour le type mélancolique, la faute même ne fait pas partie de la quotidienneté de la vie. Pourtant, ce n’est pas grave de se tromper, ce n’est pas grave de faire une connerie. Ça fait partie de la vie. On ne doit pas apprendre à faire des choses bien, on doit apprendre à faire des conneries. Ah, c’est rigolo les conneries ! La faute et la connerie sont immanentes à la vie. Pour le type mélancolique, non ! La faute est toujours transcendante, au delà de la simplicité de la vie quotidienne. J’aime bien cette approche. Donc le mélancolique rate la mort immanente qui fait partie de la vie, la mort comme sacrifice, la mort comme quelque chose où on ne peut pas tout faire, la mort comme finitude, la mort dans tous les sens du terme. Il rate ça. Je ne peux pas tout avoir. Il y a des gens qui ont plus d’argent que moi, mais ce n’est pas possible, comment ils font ? J’ai cinq enfants, je n’ai pas encore cinq appartements pour chacun des enfants. Aaaaah… donc, il y a la mort dans l’avoir. La mort ne fait pas partie de l’immanence de la vie. C’est pourquoi Tellenbach dit que c’est dans le suicide qu’il atteint ce dont tout le monde parle : la mort. Et c’est ça qui est terrible. Je n’ai accès à la vie, c’est à dire à la mort immanente que dans le suicide. Cette antinomie de la mort, cette antinomie du suicide. Comme je le disais tout à l’heure, le suicide, pour lui, c’est la vie. Et quand il est décidé, c’est impossible de le raisonner. C’est la raison pour laquelle, et j’avais donné l’exemple il y a longtemps mais je vais le refaire dans l’hommage à Maldiney, dans Ouvrir le livre, p 36, l’exemple de son copain Kuhn qui dit à un patient : « je vous donne rendez-vous lundi, je vous propose d’aller à Paris ce week-end, allez dimanche matin sur le pont à côté du grand palais et s’il fait beau, il y a le ciel bleu et les nuages qui bougent, c’est un Rorschach vivant. Vous allez à pied jusqu’à Beaubourg voir l’exposition permanente de Mondrian ». Ce type l’a fait et il est revenu le lundi chez Kuhn en disant: « mais ça existe, un mouvement de la vie chez un peintre qui peut se condenser dans une immobilité mouvante ! J’ai découvert que la mort fait partie du mouvement de la vie condensée dans cette immobilité rayonnante de Mondrian ». Voilà il avait découvert la mort immanente dans la vie… Bon, ça c’était Tellenbach. Maintenant, on va voir Mélancolie et Manie de Binswanger. Je trouve ce livre le plus difficile au monde. Moi, je n’arrive pas à distinguer ce livre de ce qu’en a dit Maldiney. J’ai toujours lu Binswanger par le regard de Maldiney. Mais ça va. Je l’aime beaucoup. C’est facile. Quand je me suis mis à travailler Binswanger lui-même… pffff… Et j’avais demandé à Maldiney, je lui avais demandé à la fin de sa vie, mais enfin mon coco, les passages les plus difficiles de Binswanger, tu ne les commentes pas ! Et il me répondait : mais non, c’est trop compliqué. Voilà, c’est un défi et je vous fais part de ce défi là. Ce n’est pas un texte clinique mais un texte méthodologique. Il a édité ce texte en 1960, il avait déjà 80 ans. Ce n’est pas le titre qui est important, Mélancolie et Manie, mais le sous-titre Etudes phénoménologiques. Il inscrit son texte dans son évolution de penseur. C’est un approfondissement de sa pensée à partir de la clinique, à partir de ce que ça lui fait d’être touché par les gens malades. Les gens malades il les connaît depuis tout petit Binswanger, à Bellevue, où il vivait avec ses parents, ses grands-parents. Là-bas, les petits, beaucoup plus qu’à La Borde, vivaient avec et entre les malades. Et il y a ce témoignage prenant, je trouve, à la page 30 : « durant toute ma vie, j’ai revu la figure gémissante et le regard profondément mélancolique de cette femme si nettement devant moi, que j’étais extrêmement surpris de constater, au cours de mes recherches, qu’au moment de son séjour je n’avais que dix ans. Que j’aie pu être si profondément impressionné par cette figure, par ce destin, vient de ce qu’encore enfants nous étions souvent avec nos malades et nous apprenions beaucoup sur leur histoire au travers des discussions des adultes. Si cette figure humaine, en tant que première impression de la menace intérieure et extérieure qui pèse sur notre vie, a représenté un repère précoce de mon expérience au sens de la connaissance pratique de l’homme, maintenant à la fin de ma vie elle apparaît aussi comme une figure de réalité transcendantale objective du point de vue de mon expérience scientifique. Devant ce cas clinique de mélancolie nous ne posons donc pas la question de savoir comment la symptomatologie clinique et donc l’autoreproche mélancolique sont dérivables « des dominantes de la structure de personnalité », de la constitution caractérologique et morphologique, du tempérament, de l’hérédité, etc., -ce n’est pas ma question, je vais plus loin que Freud- mais nous posons la question, qu’est-il survenu effectivement ici ?- Que s’est-il produit ici dans le survenir transcendantal du Dasein ? J’ai dit « concentration extrême, ne comprend rien et essaye de suivre ! » (rires), avec mes excuses, pour moi-même, ce n’est pas évident. Je donne brièvement quelques éléments de l’évolution de sa pensée : en 1930 il écrit son texte Rêve et existence. C’est là qu’il prend pour thème quelque chose qui a une objectivité délimitée, qu’on peut se représenter devant nous, comme un problème, la direction de sens. Le mot sens a trois couches : il y a le sens comme direction, dans quel sens je vais, le sens dans le sens de la signification, et le sens qui trouve sa base dans la structure sensorielle. Ces trois dimensions sont condensées dans direction-sens. Par exemple dans les rêves. Binswanger et la phénoménologie ne va pas s’arrêter aux associations des mots qui sont des contenus, il va détacher des mots l’espace dans lesquels ils fonctionnent. Et quel sens prend le mot dans les trois couches. Donc, il va thématiser dans des verbes moteurs, dans des mots qui ouvrent un mouvement, il va thématiser dans des contrastes : loin/proche, haut/bas, étroit/large, gauche/droite avec la signification haut/élévation par exemple, bas/la chute. loin/proche, proximité/distance. Donc, il y a tout un travail de métaphorisation Dans Rêves et existence et dans des ouvrages qui suivent, la différence entre la schizophrénie et la mélancolie, c’est qu’il y a trop de proximité, une surproximité dans la schizophrénie et dans la mélancolie, une non-proximité. Deuxième étape dans son évolution : il y a les thèmes. Il y a le thème du reproche dans la mélancolie, la plainte. Il a été en dialogue permanent avec Freud avec des hauts et des bas. Qu’est ce qui est à thématiser dans ces thèmes et que Freud n’a pas fait, dit-il. Qu’est ce que le mélancolique thématise ? Il joue sur les mots, il y a quelque chose à thématiser, il y a quelque chose athématique, quelque chose qui rend ces thèmes possibles. Les conditions de possibilités de ces thèmes, qu’il va développer dans des textes de 35 dans la fuite des idées, dans les études sur la schizophrénie en 57, dans mélancolie et manie en 60 et dans le délire en 1965. Donc il avait 85 ans quand il a une dernière fois essayé de trouver un espace en deçà des thématiques. Ce qui les rend possibles. Comment, dit-il, inclure les thèmes, par exemple, le thème de l’autoreproche « si je n’avais pas… » « si j’avais fait ceci ou cela… ». Vous connaissez l’exemple : un dimanche après-midi, il fait beau, on prend le petit train jaune avec des amis, et je propose à quelqu’un de changer de place dans le compartiment. Deux minutes après il y a un accident, et celui qui a changé de place est mort. « Si je n’avais pas proposé l’excursion », ou bien – « si seulement il n’avait pas changé de place avec mon mari » etc., etc. du si, du si ne pas, du « si j’avais » « si je n’avais pas ». Comment inclure les thèmes des autoreproches dans les conditions de possibilité s de ces thèmes ? C’est ça la question. Comment il travaille ? Il avait toujours comme base de travail Husserl. Il est ensuite passé au Dasein de Heidegger. Les existentiaux du Dasein, les thématiques, les caractéristiques pour ainsi dire brièvement de l’existence humaine, l’existence humaine qui est marquée par le souci, par l’angoisse de mort, par la facticité. Je suis là et pas ailleurs. Comment arriver à être là et pas ailleurs ? Comme ce patient que nous avons vu hier après-midi : mais comment ça se fait que je suis ailleurs ? Il y a des moments où je suis déconnecté ! je suis ailleurs ! oh là là ! Comment me rattraper et redevenir là ? Qu’est ce que ça veut dire l’être-là ? Le Dasein ? A partir d’ici, je suis là ? A partir de là, je suis ici ? Toutes ces thématiques là… Donc il passe de Husserl à Heidegger et il revient sur Husserl. Il passe de la Daseinanalyse à l’analyse de l’existence humaine tout court d’Husserl dans un texte extrêmement difficile : Logique formelle et logique transcendantale. Moi, j’ai essayé et je suis trop bête et je ne le comprends pas et je l’ai abandonné. Et je me suis facilité la vie avec un texte auquel il se réfère : c’est un texte de Szilasi qui était un assistant de Heidegger et Husserl : Introduction à la philosophie de Husserl. Et il se réfère lui aussi à un texte de Fink que j’ai commandé par Amazon et auquel je ne comprends rien : Introduction à la 6ième méditation cartésienne de Husserl. Bon. Je lis ce texte de Szilasi « Pendant que je parle, donc dans la présentation, j’ai déjà des protentions, sinon je ne pourrais pas terminer la phrase – on pourrait traduire dans Lacan, avec les points de capiton etc., ce serait peut-être plus accessible, mais laissons tomber et continuer avec Szilasi– de même, je dispose, dans le « pendant » de la présentation, également de la rétention, sinon je ne saurais à propos de quoi je parle. D’accord ? Binswanger, pour nous faire comprendre, reprend souvent cet exemple simple de Szilasi. Il dit : Tout trouble, toute maladie renvoie à une forme essentielle d’intentionnalité. AAAH ! Donc il y a une forme essentielle d’intentionnalité qui correspond à la schizophrénie, il y a une forme essentielle d’intentionnalité qui correspond à la mélancolie, il y a une forme essentielle d’intentionnalité qui correspond à la dépression, il y a une forme essentielle d’intentionnalité qui correspond à la névrose obsessionnelle, à la manie. Et la forme essentielle de l’intentionnalité consiste dans sa mise en forme. Ce qu’il appelle aussi la forme constitutive. Constitutive n’a rien à voir avec la constitution mais avec ce qui la constitue, ce qui met en forme. D’accord ? Il part de Cécile Münsch[1]. « si je n’avais pas ». Et là, il dit : « Pour comprendre de quoi il s’agit, il faut se référer à Husserl Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps. » (Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins). Quand Husserl parle du temps, c’est beaucoup plus logique qu’une description des caractéristiques du temps de Heidegger. C’est la conscience intime du temps et pas ses caractéristiques. Comment la conscience a conscience du temps ? Le pas historique marqué par cet exposé apparaît dans le fait qu’Husserl comprend « le temps » à partir de l’intentionnalité, plus précisément qu’il développe sa recherche dans la constitution, dans la mise en forme de la conscience subjective du temps, de l’objectivité temporelle. C’est quoi ? Ce n’est pas le temps objectif. Ce n’est pas le temps de l’horloge. L’objectivité temporelle n’a rien à voir avec ça. Il va à partir de l’intentionnalité vers la mise en forme des objets temporels intentionnels. Qu’est ce qui met en forme le passé, le présent et l’avenir ? Je suis dirigé vers l’avenir à partir du passé. Je ne m’occupe pas de ça mais de ce qui les rend possibles, ce temps divisible en passé, présent, à-venir. Il s’agit donc de mettre en évidence les vérités aprioriques qui appartiennent aux moments de la mise en forme de l’objectivité temporelle. Quels sont les moments aprioriques de l’objectivité temporelle ? C’est ça la conscience intime du temps. Je dois découvrir les vérités aprioriques, à la Kant, de l’objectivité temporelle. Ça va ? Husserl désigne les moments structuraux intentionnels constitutifs des objets temporels, avenir, passé, présent, comme protentio, retentio et præsentatio. Normalement ces moments s’intriquent constamment entre eux et se retrouvent ensemble autour de la structure du « à propos de quoi » (Worüber), du thème actuel. A propos de cet accident de train, se constituent ces vérités aprioriques de l’objectivité temporelle, passé présent avenir, cette mise en forme, c’est quoi, qu’est ce qui va émerger, pourquoi je suis collé au passé ? ça ne sert à rien de dire que le mélancolique vit dans le passé, que l’avenir est barré parce qu’il se retrouve dans le passé, que le présent est submergé par le passé qui ne peut pas aller vers l’avenir. Cela ne sert à rien de dire ça. Il s’agit donc pour nous de dévoiler les « modes déficients » de ces trois dimensions protentio, retentio et præsentatio et de leur interaction. Cela est naturellement tout autre chose que de constater que les mélancoliques « n’arrivent pas à se détacher du passé », « collent au passé », « sont entièrement dominés par le passé », tout autre chose que de constater qu’ils « sont coupés de l’avenir », « ne voient aucun avenir devant eux », ou encore que pour eux « le présent ne signifie rien » ou « qu’il est totalement vide ». Nous ne devons pas partir non plus de la douleur à propos de la mort du mari,-Freud, ce n’est pas la peine de te casser la tête sur le pourquoi de la douleur- ni de la « figure gémissante » que prennent ici la patiente et cette douleur elle même car ce sont des données « intuitives » (einfühlbar) – que je peux ressentir-. Je disais bien que quand il était petit, il a été marqué toute sa vie par cette figure gémissante, toute sa vie, il était marqué. Non je ne dois pas partir de ces données intuitives, qu’on peut ressentir et qui sont acquises dans la connaissance pratique de l’homme. Ce qu’il a fait pendant longtemps. Il en va différemment de l’autoreproche permanent d’être coupable. … Même si nous pouvons encore « pénétrer par intropathie » cet autoreproche nous ne pouvons plus le faire – et ça, c’est nouveau !- pour ce qui s’y impose cliniquement pour nous comme mélancolique. Il y a aussi des autoreproches dans la névrose obsessionnelle. Ça, on l’avait dit. L’explication de Freud et d’Abraham ne suffit pas pour vraiment saisir à sa racine cette possibilité de cet autoreproche « si je n’avais pas ». L’exemple le plus clair, c’est David Bürge[2] : « si je n’avais pas versé cette caution » et une fois que la caution est versée et donc que le problème semble résolu, ça ne sert à rien, rien n’est résolu parce qu’il reprend avec une autre thématique. Donc, ce n’est pas le thème qui est important en soi. Je dois aller plus loin. Qu’est ce qui fait que je ne peux pas me détacher et que je reste dans cette vérité apriorique de l’objectivité temporelle ? ça va ? Quand j’en parle pour la 10 millième fois, dans ma tête, ça devient plus clair. En tant que psychose, la manie et la mélancolie sont tout aussi peu pénétrables sur le fondement de la connaissance pratique que la schizophrénie. N’essaye pas de comprendre. Mais il n’en résulte nullement, comme ce serait le cas chez Jaspers, qu’en tant que non pénétrables (…) et par là non compréhensibles elles pourraient et devraient être seulement expliquées causalement ou génétiquement. Ces études prouvent le contraire. Alors, comment je peux articuler ces conditions de possibilités ? Si vous avez compris jusque là, c’est bon. Dans le discours, « si je n’avais pas proposé l’excursion » ou alors dans le cas de David Bürge « si je n’avais pas fait la bêtise d’assumer cette caution je ne serais pas tombé malade ». Il était persuadé de ne jamais récupérer son argent et par conséquent de devoir toujours rester malade… toute une années durant il se plaignit quotidiennement devant nous médecins de ce que sa dépression venait seulement du fait de s’être porté caution peu de temps auparavant d’une somme de 40 000F, somme considérable, mais cependant nullement ruineuse dans sa situation et ne pouvant conduire objectivement à un délire de ruine. Et donc, il arrive à, dans le discours, « si je n’avais pas fait la bêtise d’assumer cette caution », « si je n’avais pas fait ceci, cela ne serait pas arrivé» Cela nous apprend que dans le discours du si, du si ne pas, si j’avais, si je n’avais pas, on passe du passé, présent, avenir, on passe à protentio, retentio, præsentatio. Ça veut dire quoi ? Il s’agit manifestement de possibilités vides. Et ça, c’est le point de départ de Maldiney. J’extrapole énormément, mais dans la mélancolie il y a un trouble du transpossible et dans la schizophrénie, il y a un trouble du transpassible. C’est extrêmement difficile. Mais, c’est à partir de là. Donc, il s’agit manifestement de possibilités vides. En général, où il y a question de possibilités, je peux finir ma phrase. Une protention. D’accord ? Là où il est question de possibilités, il s’agit d’actes protentifs – le passé ne contient pas de possibilités. Mais ici ce qui est possibilité libre « si… » se retire dans le passé « si je n’avais pas... » . Donc, Maldiney va aborder ça par la linguistique de Gustave Guillaume. Dans la grammaire, -pas la grand-mère hein !, allez aide moi, comment on dit ?-, dans la grammaire même, il y a cette possibilité de se retirer dans le passé. C’est la grammaire même. Ça il le prouve avec Gustave Guillaume. Ça, je pourrai vous le faire, c’est plus quotidien pour moi, mais il faudrait toute une journée. Là, Binswanger, il ne parle pas de ça. Il dit : ce qui est possibilité libre se retire dans le passé. Cela signifie que les actes protentifs constitutifs doivent devenir des intentions vides. La protention devient de ce fait autonome dans la mesure où elle n’a plus de « à propos de quoi »,- l’à propos de quoi n’est plus en question, c’est pourquoi elle est interchangeable. Si la caution est payée, on peut dire, c’est résolu. Il passe tout de suite à un autre thème. Et pour la femme Cécile Münch qui n’arrive pas à faire le deuil de son mari, elle n’y est pour rien dans cet accident, et pourtant, elle n’arrive pas à s’en sortir – la protention devient de ce fait autonome – dans une phrase, je dis et je suis lié par ce que je dis pour pouvoir terminer la phrase. Il y a une logique de la phrase. Je peux même la comprendre. Il y a de la communication possible si les vérités aprioriques marchent. Je peux comprendre cette phrase. Là, non. La protention devient autonome. Elle n’a plus rien à voir avec l’ « à propos de ». Plus rien qu’il lui resterait à « produire » si ce n’est l’objectivité temporelle du vide « à venir » ou du vide « en tant qu’avenir ». Quand la possibilité libre se retire dans le passé ou plus exactement quand la rétention se confond avec la protention, on ne débouche plus sur un « à propos de quoi » authentique mais seulement sur une discussion vide. Ceci est le signe qu’avec l’altération de la protention, le « processus » tout entier, le caractère tout entier de flux ou de continuité non seulement de la temporalisation, mais de « la pensée » en général, est altéré ! Ce n’est pas seulement le temps mais à partir des vérités aprioriques du temps que l’ensemble de la vie qui est altérée. De ce point de vue la mélancolie est une maladie bien plus « grave », une altération « bien plus profonde » que nous ne le supposons généralement au vu de sa curabilité. Et quand j’ai dit hier soir, avec l’exemple de David Bürge, que les thèmes étaient interchangeables, donc qu’il y a avait quelque chose en deçà des thèmes. Tout ce qui se dit n’a de place nulle part. Voilà, ça c’est ce qui est le plus important. Ça va ? Vous avez suivi la ligne ? Oui, c’est compliqué. Cliniquement, ça ne sert à rien de discuter avec les mélancoliques. GP : comme avec tout le monde. ML : non. GP : essaye de convaincre l’autre et tu verras ce que ça donne. ML : c’est vrai. [1] Le cas Cécile Münsch : patiente mélancolique suite à la mort de son mari dans un accident de train. Le point central de ses plaintes était qu’elle avait proposé l’excursion au cours de laquelle l’accident avait eu lieu. [2] Patient de 45 ans, commerçant qui toute une année durant, se plaignait devant les médecins de ce que sa dépression venait seulement du fait de s’être porté caution peu de temps auparavant. 11 - 12 avril 2014
Maldiney, le transpossible et le transpassible. Exposé de Marc Ledoux Elne, le 11 avril 2014 Marc Ledoux : Bon allez, sur Maldiney. La dernière fois, j’en ai un peu parlé, il venait de mourir et je vous ai demandé si c’est possible de se réunir autour de lui. Et dans un élan maniaque, j’avais proposé le transpossible et le transpassible, mais c’est extrêmement difficile et comme je suis très attaché à lui, je veux le respecter et à partir de moi même, essayer d’aller au fond de ses textes, d’autant plus que plus je le lis, plus c’est difficile. Alors je ne sais pas, si je le fais comme je l’ai préparé, c’est terriblement compliqué, Laurence m’a dit tout à l’heure de raconter des anecdotes, mais quoi, je raconte quoi ? Il a souvent raconté, c’était un homme très sérieux. Georges Perez : Comment vous êtes vous rencontrés ? ML : Moi ? Laurence Fanjoux Cohen : Oui, toi ! ML : Mais, moi, je ne suis personne ! LFC : Justement ML : je ne sais plus. Michel Balat : Il faudrait avoir les interviews d’Oury. On a entendu hier sur France Culture, les cris de Marc. ML : je ne sais plus où je l’ai rencontré la première fois… c’était à Louvain… avec Schotte. (allume un cigare) GP : C’est interdit de fumer Marc MB : tu es gonflé ! ML : (éteint son cigare) Non, non. Il a raison. Je sais qu’il m’a dit un jour, c’était un colloque qu’on faisait sur le Szondi, Schotte était là et comme à chaque fois on essayait d’aborder chaque vecteur de manière la plus large possible. C’était sur le vecteur C et c’est un texte qu’on peut retrouver dans le livre Le contact et dans le livre L’homme et sa folie et j’avais fait quelque chose sur Schuman. Et plus tard, à Budapest, sur le vecteur P, c’était un moment superbe, comme on était dans la ville de Bartók, j’avais fait quelque chose sur Bartók et lui, on se connaissait déjà, il disait c’est bien. Moi, j’ai abordé la peinture par l’œuvre-même et jamais par le peintre, ni par l’histoire. Ça, c’est sa phrase célèbre : « il n’y a pas d’histoire de l’art ». Il n’y en a pas. Même quand ils ont fait il y a 5 ans une journée pour lui à Royaumont, il y avait Didi-Huberman qui avait été son élève à Lyon, et qui avait écrit tout et n’importe quoi, et là, il avait essayé de tuer son maitre en disant « il y a bien une histoire de l’art ! ». Mais, là, Maldiney était encore très vif, et il a bien réagi contre ça. Il disait qu’il abordait la peinture par la peinture même, de la même façon que moi Marc, je pouvais aborder Bartók et Schumann par leur musique et non par leur biographie. C’est vrai que j’avais essayé de faire apparaître la psychopathologie ou la structure existentielle de ces musiciens à travers une analyse de leur musique. Donc, ça, c’est quelque chose qui nous a lié. Je l’aimais beaucoup. Et à chaque fois qu’il venait chez nous, avec sa femme qui est peintre, on se retrouvait. Il racontait des histoires. Par exemple sur ses dernières œuvres. Ouvrir le rien. L’art nu. « Marc, tu l’as lu ? Je te le donne. Parce que pour la première fois, j’ai écrit ma propre vision sur la peinture. Jusque là, c’était à propos de, où je pouvais développer des petites choses. Mais là, c’est ma grande œuvre. Des gens me demandent pourquoi je parle toujours des mêmes peintres. Cézanne, Mondrian, même un flamand… surtout sa sculpture, il aimait beaucoup le baroque. Mais il disait qu’il n’y a pas de baroque en Europe mais au Brésil où je l’ai accompagné une fois. Ça c’était impressionnant quand même… dans L’art nu, il y a un monsieur dont j’ai oublié le nom qui a fait une sculpture devant une église, sur cette grande esplanade. Là dessus, il a beaucoup écrit. Kandinsky, Delaunay, Bazaine, Van Gogh bien sûr, Nicolas de Staël. Les gens demandaient donc, pourquoi toujours les mêmes, pourquoi pas sur Gauguin ? Il était très hostile aux musées, au comment les musées étaient conçus, et à quoi ils servent… il était très hostile et il y allait quand même. C’était très parlant pour moi qui n’y connais rien, de l’accompagner quand il allait voir une expo. Courbet par exemple à Paris. Il disait « j’écris sur les peintres qui me regardent. Qui me touchent. Et ce sont les peintures qui me regardent. Et il y en a qui m’ont regardé, qui m’ont touché et c’est là dessus que je travaille. » C’est une petite anecdote qui est restée. Son grand ami peintre, Tal Coat… il faisait de la montagne avec lui. Quand je l’ai eu au téléphone un mois avant sa mort, il allait bien, il attendait la mort mais sa tête allait bien et il écrivait encore, il lisait encore, Hegel, toujours le même… il me disait qu’il y avait une chose qu’il regrettait, c’est de ne plus pouvoir monter le Cervin, il le faisait maintenant dans sa tête. C’était une des premières montagnes qu’il avait montée. Il était alpiniste. IL parle souvent à partir de son vécu, quand il est sur la crête du Cervin avec Tal Coat, quand il voit soudainement non pas un objet apparaître mais à la fois dans cette opposition du ciel et la terre, il y a l’apparaître. Et cette sensation, il va l’utiliser souvent pour essayer d’approfondir sa phénoménologie. De la même façon, ce n’est qu’à la fin de sa vie qu’il a écrit un texte de son expérience des camps de concentration, son vécu. Tout à l’heure, on verra ce que c’était pour lui l’expérience. C’était pas loin de Besançon, Notre …ch’est pas quoi, où il a d’abord été mis dans un camp de travail puis ensuite dans un camp de concentration. Il a écrit un tout petit texte après sa libération La porte ouverte. Quand on était ensemble avec Schotte, Roland Kuhn et Jean-Marc Poulard, il aimait bien Jean Marc Poulard aussi, il racontait : « qu’est ce qui fait que Primo Lévi, Bettelheim n’ont pas pu survivre ? » et là-dedans aussi, Szondi. C’est par Schotte que Maldiney a rencontré la psychiatrie. Après la libération, il n’y avait pas de poste pour Maldiney pour enseigner en France et donc il est venu à Gand qui à l’époque était une ville francophone, et c’est là où il a enseigné à l’école des Hautes Etudes. Il a enseigné Malebranche surtout. Et c’est là qu’on avait envoyé Schotte suivre un séminaire de quelqu’un dont on ne comprend rien, -c’est peut-être ça que j’imite, ce n’est pas la peine quand on parle de Maldiney de le comprendre, on a parlé de Maldiney, on a compris, et alors ?... donc c’est cette phrase à laquelle je me suis identifié, il faut être un peu turlutte quand même…- donc Schotte est allé écouter un séminaire de Maldiney sur Malebranche et en sortant il a dit « mais je ne comprends rien, mais un jour je vais le comprendre », ça c’était la phrase de leur première rencontre. Et une amitié s’est liée entre eux. Surtout dans l’essayer de comprendre ce que Maldiney écrivait. Et Maldiney venait nous écouter et… hop, de temps en temps, il y avait quelque chose qui le frappait et cela l’aidait à continuer à développer ses trucs. Par exemple, sur le contact, il avait lu des textes de Philippe (Lekeuche) et de Mélon, et hop, voilà, ça l’a aidé à approfondir la dimension de l’humeur et du contact dans son développement du moi par exemple. Et c’était là aussi que Schotte a pris cette phrase de Maldiney, qu’il disait souvent : « quand je vais essayer de faire des cours, je vais essayer que les gens soient intéressés mais qu’ils ne comprennent pas. Pour leur donner envie de travailler. Pour leur donner envie d’aller travailler les textes que je cite ». Voilà, il nous invite à continuer à le lire et à le travailler. Ce n’est pas simplement lire. Mais de travailler. Voilà, cet axe là vient de Schotte et de Maldiney. Il y a eu un moment, c’était à Lyon où il repris ça : il m’a dit, -alors Marc, tu n’es pas français ? Non, je ne suis pas français. -Mais essaye quand même. Essaye de suivre, je t’emmène, essaye de suivre un atelier de poésie d’André du Bouchet. André du Bouchet qui était marié à la fille de Nicolas de Staël faisait un atelier de poésie à Avignon. Moi, j’avais essayé de lire des phrases d’André du Bouchet et… rien, rien, rien… Il me disait « c’est pas grave, c’est le rien ! ». Bon, alors tu m’emmerdes avec ton rien. Mais si on regarde, c’est toujours la même thématique du rien. Le blanc, le vide, chez André du Bouchet. Et donc, il m’avait emmené suivre un atelier de poésie d’André du Bouchet à Avignon. Et dans la voiture, il essayait de trouver des mots pour que je puisse trouver l’espace dans lequel André du Bouchet travaillait. La même chose avec Oury. On retrouve un témoignage dans l’annexe de Création et schizophrénie, leur dialogue à Beaubourg. C’était lors d’une exposition que l’atelier peinture des pensionnaires de La Borde avait organisé à Beaubourg, et Maldiney avait demandé d’exposer les œuvres d’un pensionnaire dans un espace uniquement à lui. Avec de l’espace autour des oeuvres pour circuler. C’est à dire pour pouvoir tourner autour de la peinture. Et quand on lit ses textes, il va souvent entrer dans la peinture, la sculpture, les masques, par le contraste entre la face et le profil. Et donc, dans cette expo à Beaubourg, le soir il a dialogué avec le Dr Oury, et l’après midi il avait demandé d’être seul pendant trois heures pour aller marcher autour de ces peintures. Et au bout de deux heures, il m’avait proposé d’y aller avec lui. Allez Marc, veux-tu venir avec moi ? Avec lui, je me sentais toujours tout petit, mais en même temps fier, bien sûr, et j’ai donc pu marcher une heure avec lui, -et ce n’était pas difficile pour me taire !- et il commençait à rassembler ses mots, -lui, il n’improvisait jamais un texte, jamais, le contraire de Schotte- quand il faisait un texte, il l’avait écrit son texte, comme pour sa femme quand elle faisait une peinture. Donc, il allait s’asseoir et il essayait de rassembler des mots qui venaient quand il était touché par tel ou tel détail d’une peinture. C’est aussi par Schotte qu’il a rencontré Roland Kuhn et Binswanger... Et Roland Kuhn était le grand spécialiste du Rorschach et le lui avait expliqué, et un peu comme il a utilisé le Szondi, il va stratégiquement faire appel au Rorschach. Quand il analyse un Rorschach, et ça il savait très bien le faire, alors qu’il n’arrivait pas à lire un profil, mais il analysait bien un Rorschach comme la peinture. Donc je me souviens, il analysait la peinture de la même façon qu’il pouvait le faire avec une tache du Rorschach. Et donc, voilà, le soir, et ça, c’était un moment superbe je trouve, ce dialogue entre lui et Oury pour essayer à partir d’une articulation avec la peinture, de faire le passage avec ce qui se passe dans la psychopathologie. C’est quelque chose qu’il a toujours essayé de faire. Comment la peinture ou la psychopathologie ou la dialectique entre la psychopathologie et l’art nous ouvre, nous permet de mieux approfondir qu’est ce que c’est l’homme ? C’était sa question tout le temps. C’était la question pour le philosophe. C’était un philosophe et rien d’autre qu’un philosophe, mais bon, qu’est ce que ça veut dire rien d’autre ? Qu’est ce que c’est l’homme ? Qu’est ce que c’est être ? Il a abordé cette question par énormément de champs dont la peinture, la psychopathologie et on peut dire par la philosophie même. Chacune de ses œuvres est un recueil de textes. Il y a trois semaines, j’avais fait à Louvain « Maldiney et Szondi » et je ne m’en sortais pas de la chronologie, non pas que je sois obsessionnel mais je disais que j’aurais aimé travailler chez lui comment les concepts se sont construits et s’il y avait une possibilité d’avoir une certaine chronologie. Nulle part on ne trouve une chronologie de ses textes. Une fois, je lui avais demandé. Il m’a dit « ouiii Marc, je vais chercher, mais là, je ne sais plus… ». Une de ses œuvres la plus difficile, c’est le livre Aîtres de la langue et demeures de la pensée, ça alors mes amis, si vous pouvez lire ça, on se revoit dans dix ans. Où la question de l’être humain est abordée surtout par la philosophie grecque concentrée sur la linguistique. Quelle est la philosophie de la langue chez les grecs, reprise par deux grands spécialistes, d’une part l’historien que Schotte a traduit, Johanns Lohmann, et d’autre part ce linguiste inconnu jusque ce que Maldiney l’a fait connaître : Gustave Guillaume. Gustave Guillaume qui va de Paris jusqu’à Laval et qui n’a jamais réuni ses textes. Et maintenant il y a plusieurs personnes de l’ULB à Bruxelles qui travaillent pour rassembler les textes de Gustave Guillaume. Pour Maldiney, Guillaume est le linguiste beaucoup plus important que de Saussure par exemple. Et donc dans ce livre, Maldiney aborde l’être humain d’une part par la philosophie grecque concentrée sur la linguistique et d’autre part par, ….brrrrrrrr.., la musique ! La base mathématique de la musique comme elle a été à l’origine chez Pythagore, etc, etc… et par exemple, lors d’une journée à Royaumont il y a 5-6 ans, il y avait un ensemble qui a joué de la musique très ancienne qui a été reconstruite pour pouvoir la jouer comme on pouvait le faire dans la Grèce Antique. Et moi, j’étais à côté de lui, il était extrêmement surpris. C’était pour lui quelque chose de l’événement. Ils avaient trouvé un ensemble qui fait cette musique-là avec les mêmes éléments de construction musicale. Moi, quand j’étais petit, j’avais fait du solfège et de l’harmonie, et je croyais que je connaissais quelque chose à la musique, … tu parles ! Donc, ça aussi, ça ne m’a pas déprimé, c’est un grand mot mais, … un peu quand même… ah là là là là… je lisais ce texte sur la musique dans ce livre et je ne comprenais plus rien ! à quoi ça sert d’avoir fait de l’harmonie ? Quoi d’autre comme anecdote ? Ah oui ! C’est qui Tosquellas ? Oury m’a dit un jour qu’il était en voyage avec Tosquellas, de St Alban à Marvejols, c’est une anecdote que tout le monde connait… Tosquellas disait à Oury « tu sais ce que c’est la schizophrénie ? C’est un collapsus de la transcendance ». Oury raconte ça à Maldiney. Et hop ! ça aussi c’est une phrase qu’on va retrouver tout le temps. Cette phrase ne l’a plus jamais quitté. Et il me disait : « mais, Marc, toi qui travaille à La Borde, c’est qui Tosquellas ? Et toi, tu es allé avec Oury et Schotte chez Tosquellas après le 1er janvier, -il faisait très froid, c’est vrai, j’avais été là-bas-, toi qui connaît Tosquellas, c’est qui Tosquellas, où est-ce qu’il a trouvé cette phrase ? Elle est géniale ! » A chaque fois qu’on va trouver quelque chose qu’il développe à partir de la transcendance comme concept philosophique, la transcendance chez Kant, l’ego transcendantal chez Husserl, des textes qu’il connaissait par cœur, -enfin par cœur, je n’en sais rien, mais en tout cas qu’il a travaillé toute sa vie-, et tout d’un coup il y a quelqu’un qui va extrapoler ce concept fondamental de la philosophie pour essayer de circonscrire ce qu’est la schizophrénie. Alors, c’est une phrase qui a eu l’effet d’un événement. C’est vrai. Il a toujours dit ça. « Marc, ça c’est un événement dans ma pensée qui n’arrête pas de se penser ». Toujours, on va retrouver un commentaire sur la transcendance. Il va toujours l’appliquer à propos de la schizophrénie. Il était lecteur permanent d’un couple de philosophes Husserl et Heidegger. Il n’a jamais arrêté, pas un jour dit-il, d’avoir lu Heidegger. Au début, il ne pouvait pas le lire dans le texte. Donc, il lisait les peu de traductions. Et nous, on avait un prof à Louvain, de Waelhens qui avait traduit Heidegger. Et de Waelhens et Schotte étaient bon copains et donc, c’est aussi par Schotte, que Maldiney a poussé de Waelhens à traduire Heidegger. Sein und zeit, l’être et le temps, une des premières traductions a été faite par de Waelhens, un de nos flamands. De Waelhens et Von Breda, qui était un curé. C’est lui qui a été un gardien extrêmement veillant des oeuvres de Husserl. Quand Husserl a été déporté, sa femme a pu rassembler quelques textes, fuir jusqu’à Louvain et là, elle a été protégée par Von Breda. C’est là que l’institut Husserl a été édifié et a stocké ses œuvres. Et plein de gens comme Derrida, Levinas, etc etc… sont venus travailler là les textes de Husserl. Maldiney aussi. Voilà. Ils étaient tout le temps ensemble. Maldiney et de Waelhens. De Waelhens allait au foot et buvait du whisky et Maldiney travaillait. Et quand il en avait marre de voir de Waelhens boire du whisky, il rentrait chez lui faire de la montagne. Et puis il revenait à l’institut travailler sur les archives. Pendant trois ans. Comme Ricoeur a pu le faire aussi plus tard. Derrida aussi venait. Ça existe toujours les archives de Husserl. On est fiers un peu quand même ! Pas Louvain La Neuve ! Pas chez les wallons ! Chez nous ! Ils sont là ! Après, petit à petit, Maldiney a appris l’allemand, il a suivi des cours d’allemand, mais il a surtout appris dans les textes, et puis ensuite, à la fin, les trente dernières années, il a toujours lu Heidegger et Husserl dans le texte. Ce qu’on ne sait pas très bien, c’est que pendant des années, quand il a commencé son enseignement à Lyon, il a beaucoup commenté Freud et Lacan. Il a pendant une vingtaine d’années fait deux séminaires, un sur Freud où il commentait surtout les textes qui étaient les plus importants pour Lacan, Psychopathologie de la vie quotidienne et Die Traumdeutung et les cas cliniques. Il faisait aussi un séminaire par semaine sur Lacan où il a surtout commenté le premier Lacan, le stade du miroir, la parole, l’agressivité en psychanalyse, le rapport de Daniel Lagache, et c’est au moment, ça va presque ensemble, où il a rencontré Szondi, qu’il dit, - et on peut le lire à travers ses textes- « je suis plus en affinité avec le concept et la dynamique de la pulsion qu’avec l’axe « l’inconscient et le langage . D’accord Lacan, mais ce n’est pas mon affinité. Mon affinité est beaucoup plus szondienne ». Parce que Szondi va essayer tous les clivages qui existent, et ça commençait à cette époque, -maintenant, qu’est ce que c’est maintenant ? c’est du morcellement, c’est de la dissociation à l’intérieur de la psychanalyse, il y a des chapelles partout, il y a des je ne sais pas quoi, comment on peut appeler ça, chaque psychanalyste est sa propre école…etc…- c’était au début de toute cette querelle à l’intérieur de la psychanalyse et Maldiney disait : mon affinité va avec la théorie des pulsions de Szondi parce que cette théorie peut rassembler tout ce qui est dissocié à l’intérieur de la psychanalyse. C’était au moment où Lacan était très hostile vis à vis de Ich analyse, analyse du moi, qu’est ce que c’est le moi, et lalala… tout ce truc là qu’on connaît… et lui dit : non, non, non, on va sauver le moi, le vecteur du moi. Mais ce n’est pas du tout le même statut logique que chez Lacan. Et on peut donner une autre structure à ce moi à partir de mon affinité avec la pulsionnalité. Il faisait Freud et Lacan, et hop, il rencontre Schotte qui lui fait rencontrer Szondi et c’est là, que hop… et c’est après que Maldiney va se spécialiser dans des textes comme psychose et présence d’où vient le concept de la pulsion. Ce n’est pas Freud qui a conceptualisé la pulsion. C’est Fitche, c’est Schering, et c’est Freud qui a pris chez ces philosophes là, à sa sauce, la pulsion. Une des premières choses que j’avais faites, mais je ne l’ai pas fait tout seul, avec quelqu’un qui faisait sa thèse sur la pulsion, on a creusé un peu comme des pervers, qu’est ce que Freud a laissé tomber et qu’est ce qu’il a pris chez Fitche, chez Schering. Un peu une lecture perverse de ça… Bon voilà pour les anecdotes. Est ce que maintenant je peux travailler sur son concept qu’il a développé à la fin ? Schotte dit que c’est peut-être le concept le plus difficile et le plus important pour toute la psychiatrie. Et quand Schotte dit psychiatrie, c’est l’anthropopsychiatrie. C’est peut-être le concept qui nous aidera à aller le plus loin. Ce n’est pas un concept, mais deux ! Le transpossible et le transpassible. Bon, si vous en avez marre, levez vous et partez ! rires… Parce que c’est difficile. J’ai essayé d’aborder ça à travers tout son travail. J’essaye de le construire petit à petit. Ces deux concepts, le transpossible et le transpassible. C’est à partir aussi de de Waelhens et de Schotte avec le Pathei mathos : apprendre par l’épreuve. Et seulement par elle. Maldiney disait que cela pouvait être l’épigraphe de tout son travail. C’était le nom d’une collection dans laquelle est paru l’analyse du destin de Szondi. GP : ça s’écrit comment ? ML : ça s’écrit en grec. P-a-t-h-e-i m-a-t-h-o-s GP : non, mais je demande comment tu l’écris l’épreuve ? les preuves ? ML : apprendre par l’épreuve ! Pathei mathos ! Eprouver ! une souffrance, une épreuve ! LFC : ne me regarde pas comme ça. Ce n’est pas moi qui ai demandé ! C’est celui qui ne veut pas qu’on fume qui demande ! DS : il ne veut pas comprendre. Rires ML : Francis Ponge auquel Maldiney a consacré deux livres, Le legs des choses et Le vouloir dire de Francis Ponge. Quand on connaît un peu Von Weizsäcker, je ne peux pas trop le dire, mais on est entre nous, j’étais content quand on a pu traduire Pathosophie… juste avant de mourir il m’a dit « mais Marc, tu l’as fait sortir trop tard la traduction. Je n’ai pas eu le courage de le lire –c’est vrai, c’est terrible en allemand- je suis fatigué maintenant pour vraiment travailler jour et nuit ce livre en français. Tu l’as fait sortir trop tard. Pourquoi tu as attendu tant d’années – il m’engueulait un peu- c’est vrai, tu l’avais commencé, tu me l’as dit, et puis ensuite tu l’as laissé tomber, pourquoi tu as attendu ? ». Donc, voilà, on trouvait Von Weizsäcker, mais pas Pathosophie. Donc, Le vouloir dire de Francis Ponge, son deuxième livre. Un autre, mais on pourrait en parler des heures, le linguiste de Rennes, Gagnepain. Pour nous, en psychiatrie institutionnelle, les plans qu’il a dessinés sont importants. Maldiney l’utilise beaucoup moins. Schotte, à certains moments, a beaucoup utilisé ce modèle de Gagnepain. Et un des titres de livres de Gagnepain s’appelle Du vouloir dire. Mais donc, pathei mathos, apprendre par l’épreuve, qui est repris par Francis Ponge par l’intermédiaire de Maldiney pour définir son œuvre… Francis Ponge va circonscrire tout son travail de poète comme pathéimathique, il disait « si vous voulez savoir ce que j’ai fais, et bien je n’ai fais que de la pathéimathique ». Comme en réponse à la phénoménologie classique, surtout la version française… c’est une raison pour laquelle Maldiney est très peu cité par les philosophes français, sauf par Deleuze, parce que Deleuze était un de ses élèves à Lyon et quand il prend la phénoménologie par exemple de Sartre, pour dire que la philosophie n’est pas quelque chose d’académique, la philosophie n’est pas de la littérature, c’est une épreuve, la phénoménologie, c’est l’épreuve d’apprendre qu’est ce qui se donne à voir. Les phénomènes, l’apparaître. Retour aux choses mêmes, dit Husserl. Mais qu’est ce que ça veut dire ? Qu’est ce que ça implique ? ça implique une épreuve ! Quand on fait de la clinique, est ce que c’est notre a priori, est ce que c’est notre savoir qu’on va appliquer ? C’est ça la clinique ? ça va pas, non ! Mais qu’est ce que c’est alors ? Et bien, c’est une épreuve d’apprendre à être ouvert à ce qui se donne à voir. Et il va à ce moment là, c’est sa manière de penser, chez les gens qui l’accompagnent toujours et qu’il lit tout le temps… Hegel. Est ce qu’il y a quelque chose dans cet apprentissage à m’apprendre ? Dans cette dialectique entre l’esclave et le maitre : est ce qu’il y a quelque chose de l’épreuve ? Oui. l’esclave, aussi, vit la mort, mais à la différence du maitre, - si on l’entend bien, moi ça m’a demandé des années, je peux vous demander de … je ne sais pas… de l’entendre, où ça sort et ça prend tout de suite cet accent Maldiney-, l’esclave vit la mort, mais à la différence du maitre, l’esclave apprend à mourir, -apprendre, à ce moment là, qu’on trouve aussi dans le texte de Hegel, s’appelle erfarhen,- l’esclave l’apprend toujours la mort, mais il ne le sait pas. Et pour lui, apprendre par l’épreuve est beaucoup plus basal, fondamental que le savoir. Mais lui disait toujours « ne mélangeons pas les deux registres ! Quand je dis beaucoup plus basal que le savoir- il était très respectueux, il était hostile pour certaines choses, mais pour des auteurs qui réfléchissent, il était très respectueux- ne viens pas faire de commentaires avec Lacan, on doit extrapoler, on ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. » Après il part du mot erfahren. Farhen, c’est comme en flamand, ça veut dire voyager, traverser, faire route. Voyager, c’est – on trouve ça dans un texte magnifique, dans un recueil qui a été fait pour un hommage à de Waelhens qui s’appelle Qu’est ce que c’est l’homme, c’est paru à Bruxelles et Maldiney a écrit là-dedans un texte magnifique qui s’appelle La prise. Je vous l’ai déjà dit. Mais je suis sûr que vous ne l’avez pas lu. Encore une fois, essayez. Trouvez le, photocopiez le et lisez-le. Donc, dans la prise : Voyager, c’est traverser, passer au-delà, passer de l’autre côté, -j’ai utilisé cette phrase dans le livre Qu’est-ce que je fous là pour commenter la traversée de Tosquelles- voyager c’est traverser, passer au-delà, de l’autre côté, franchir, apprendre, c’est intégrer à l’état d’acquis, -le préfixe er de erfahren-, tout ce qui se découvre au cours de cette traversée où on fait route à travers le monde. Mais cet acquis ne forme véritablement un acquis si nous ne cessons d’être en partance. Il disait que tous les jours il commence à penser. Cela ne s’arrête jamais de penser. Jamais, il ne fait un système. Jamais. On va trouver des articles. Un livre est une sorte de testament, mais ce sont des chapitres sur des peintres. Mais il n’a jamais écrit sa philosophie comme Heidegger La philosophie de l’esprit, ce sont des articles, c’est toujours en train de se penser. C’est pourquoi il ne s’agit jamais de prendre pied. Tout est impossible. On ne peut pas parler de transpossible et de transpassible sans parler de l’impossible. Tout est impossible. Et d’abord, qu’est ce qui est impossible ? Exister ! Et ça aussi, ça été un peu virulent entre moi et lui. Lui, il faisait l’opposition entre le vivant et l’existant. Il disait toujours que Von Weizsäcker avait très bien décrit le vivant mais ça restait trop biologique, ce n’était pas suffisant pour approfondir l’homme et il faut passer par l’existant. Moi, je disais que Von Weizsäcker avec d’autres mots parlait de l’existant ! Mais, bon… bon, alors, tout est impossible et d’abord exister… il faut partir pour avoir lieu. De temps en temps, je vais vous jeter des phrases qui sont des phrases de Maldiney. Mais n’essaye pas de comprendre. Que ça résonne ! Mais pas comme la poésie. Et c’est peut-être là, dans cette marge, entre ne pas comprendre et le pas de poésie, qu’il y a quelque chose comme la philosophie. Il faut partir pour avoir lieu. L’itinéraire philosophique de Maldiney est de commencer et de recommencer, ce en quoi c’est une marche. Lui, il aimait bien marcher. C’était un alpiniste et un marcheur. Souvent il marchait avec Tal Coat, et il marchait aussi seul. Une marche véritable. Il accomplit souvent ce que lui-même dit de la forme artistique. Tout à l’heure je disais qu’il n’y a pas d’histoire de l’art, la forme artistique, elle est là quand elle se forme, se formant elle-même. Le départ de la forme artistique est partout et pas à certains moments. Chaque phrase dit-il, -et ça c’est dans son premier livre, quand il analyse la philosophie de la langue et quand il va commenter les premiers linguistes grecs, les philosophes de la langue grecque, qu’est ce que c’est une phrase, qu’est ce que c’est un mot, qu’on va retrouver chez Gustave Guillaume, qu’est ce que c’est un mot-, chaque phrase surgit de cet instant de silence, instant si bien décrit par Goethe dans des extraits de pièces de théâtre, et que Binswanger aimait bien citer. C’est aussi par l’intermédiaire de Schotte que Maldiney a rencontré Binswanger. J’avais une photo… ah, je ne la trouve pas, où est-elle, ah Marc Ledoux !... j’avais une photo de Maldiney, Binswanger et Kuhn. Je vous la montrerai demain matin. Pour Maldiney, Binswanger a été un des psychiatres qui lui a le plus appris sur ce que c’était l’homme. Et donc ce texte célèbre, L’homme en psychiatrie. La psychiatrie n’est abordable que par l’homme et l’homme n’est abordable que par la psychiatrie. Et dans ce sens-là, on ne risque pas de trouver une science objective avec tous les désastres que cela donne. Donc chaque phrase surgit de cet instant de silence, si bien décrit par Goethe et que Binswanger cite et que Maldiney reprend souvent : Lorsque nous nous heurtons soudain à l’inattendu, lorsque le monstrueux surgit à nos regards, notre esprit se tient pour un instant silencieux. Nous n’avons rien à quoi comparer cela. Son livre L’art, l’éclair de l’être est consacré à la poésie, et les grands poètes qui l’ont inspiré pour dire qu’est ce que c’est écrire, qu’est ce que c’est la parole, qu’est ce que c’est la différence entre un mot, une parole, un discours et compagnie, c’est Hölderlin, un de ces poètes qui l’ont touché, Rilke, André du Bouchet. Surtout ces trois là. Donc, de l’écriture et la parole, il peut dire ce qui résonne avec les vers de Goethe, qu’elles n’ont de ressources que dans les moments critiques où elles ont à être. Et une parole surgit. Un mot surgit dans la poésie dans un moment critique. C’est avoir à être. J’ai à être. Qu’on peut reprendre dans le Szondi dans le Sch. k : avoir p : être. Avoir à être est solidaire de l’exposition de s’exposer à l’impossible. La pathologie de l’obsessionnel nous montre l’échec que c’est possible d’avoir à être et il s’arrête sur le mode névrotique à l’avoir. Il confond l’être avec l’avoir. Combien tu as sur ton compte et je te dirais qui tu es ! Voilà l’obsessionnel. Pour lui, plus rien n’est impossible. C’est un échec. Il paye avec sa pathologie. Et il n’en a jamais assez. Et on sait bien que ceux qui ont beaucoup de sous sont des emmerdeurs, car ils n’en ont jamais assez. Cet avoir à être est solidaire de l’exposition à l’impossible et au risque de s’effondrer en n’étant pas à la mesure, -et la mesure, cela vient de la musique et pas de la morale…- un an avant de nous quitter, il me disait « ah, Marc, tu as enfin compris toute ma thématisation de la mesure, c’est pour échapper à ce qui est là maintenant, par tout ce qui est mesurable et le mesurable comme calcul n’a plus rien d’un système musical et il n’y a plus aucun passage vers la morale, -en n’étant pas à la mesure de ce qui nous appelle démesurément. On est toujours dans la démesure, mais est ce qu’on peut entendre un appel à la mesure ? ça, c’est typiquement une phrase de lui. C’est là que Maldiney va prendre une phrase de Claudel, qui est presque l’épigraphe de Schotte, dans Art poétique, entre connaître et co-naitre. Ça, c’est une phrase clé chez Schotte. La différence entre connaître et co-naître. Dans Penser l’homme et sa folie, L’évènement est de soi surprenant, excédant toute prise, excluant toute emprise …- c’est pour vous dire, moi j’aime bien sa langue, bon, j’aime bien son écriture, elle est un peu lourde au début, mais quand on le travaille, ça m’a beaucoup aidé de le lire… -excédant toute prise, excluant toute emprise, nous co-naissons avec lui. Public : tu peux répéter ? M.L. : Aaaahhh… L’événement est de soi surprenant, excédant toute prise, excluant toute emprise nous co-naissons avec lui. Et plus nettement encore, une rencontre est co-naissance. L’être rencontré surgissant d’un rien comme le rencontrant lui même. Et ça c’est une épreuve. Et c’est à ce moment là qu’il va rencontrer Von Weizsäcker. Lui même Maldiney va plutôt s’inspirer de Gustav Kreis que de Pathosophie. Dans le dernier chapitre de Penser l’homme et la folie, p 323, le chapitre de la transpassibilité, Schotte disait que c’était le chapitre peut-être le plus difficile autour de la psychiatrie. L’évènement nous advient en tant que nous devenons nous-mêmes. Indivises l’épreuve et la transformation. Que nous apprenne t-elle de qui nous sommes ? Ce n’est pas d’être projet du monde qui fait que je suis moi. C’est ma façon d’accueillir, d’endurer l’événement et d’être par lui mis en abîme, mis en demeure de surgir unique dans l’instant éclaté. Tout le reste de ce que je vais raconter est une explication de cela. Dans un autre recueil, L’irréductible, Maldiney dit en prenant la formule de Heidegger Deviens ce que tu es … mais en ajoutant mais tu ne l’es vraiment qu’à le devenir. Qu’Erwin Straus a repris plus tard à partir de Maldiney : on devient ce qu’on est et on est ce qu’on devient. Vous voyez comment les gens travaillaient entre eux. Et Schotte était là… le chauffeur de bus, il allait chez l’un et chez l’autre avec cette phrase superbe, et hop, ça faisait un cocktail. Deviens ce que tu es mais tu ne l’es vraiment qu’à le devenir. C’est à cette dimension de l’épreuve que Maldiney a voué ses interrogations et ses rencontres toute sa vie. Quelles rencontres ? Lesquelles ? Souvent, très souvent, il reprend la plainte mélancolique. Et quand il parle de la mélancolie, il va se concentrer de plus en plus autour de la phrase paradigmatique, canonique, qui vient de Kraepelin : « ah, si je n’avais pas… je n’en serais pas là ». Combien de fois variées, il n’a pas commenté cette plainte mélancolique. Mais ce n’est pas répétitif, c’est une reprise, comme Kierkegaard ! Une re-prise. Combien de fois il n’a pas commenté la Sainte Victoire de Cézanne. Combien de fois il n’a pas commenté la poésie de Francis Ponge. Combien de fois il n’a pas commenté le poème superbe, Le lézard. Combien de fois il n’a pas commenté le poème Les volets de Francis Ponge. Lisez ça simplement. Ne comprend rien. Lisez ça, hop, et bon voyage. Combien de fois il n’a pas commenté les poèmes de André de Bouchet. Combien de fois il n’y a pas eu de visites et de discussions publiées avec François Cheng sur le vide et le plein, sur la philosophie chinoise. François Cheng était son copain. Il a beaucoup commenté aussi l’art chinois. Et François Cheng avait superbement bien parlé lors des journées à Royaumont Autour de Maldiney. Donc, toutes ses rencontres, la plainte mélancolique, la poésie de Francis Ponge, la philosophie chinoise et la philosophie vont se déployer dans la dimension du pathique. Ce n’est pas la peine que je vous parle du pathique parce que ça, on le connaît pas cœur ici, la différence entre le moment gnosique de connaître de ce qui est, de être et le pathique, de ce qui est éprouvé. Et l’éprouvé n’est pas abordable par la connaissance mais par le sentir et le ressentir. Et donc dans ce dialogue avec Erwin Straus dans le livre Regard parole espace, il développe son dialogue autour du pathique, le sentir, le ressentir, dans la dimension de l’esthétique, dans la dimension du style, dans la dimension de ce que c’est le rythme et qu’on va retrouver dans toute la dimension du contact chez Szondi. Dans les deux sens. Ça nous aide beaucoup tous ces commentaires qu’il a donné sur le sentir, le ressentir, pour développer le contact dans la psychopathologie et inversement, lui, Maldiney va utiliser nos conneries sur les facteurs szondiens pour approfondir ses concepts du sentir ressentir. C’est très étonnant. Et vraiment, moi j’aimerais bien, je retrouve un peu les frites, j’aimerais bien écrire quelque chose sur comment ça s’est construit chez lui, cette mise en forme comment ça a pris avant et après qu’il ait connu Szondi… Chez Von Weizsäcker, c’est complètement différent le pathique, ce sont les verbes pathiques, pouvoir, devoir, vouloir etc. etc. vous connaissez. Il y a un chapitre dans Pathosophie qui s’appelle La réalisation de l’impossible. Ce qui se réalise, c’est l’impossible. Tu t’imagines que pour Maldiney ça résonne. Exister, c’est l’impossible, et ce qui se réalise, c’est l’impossible. Donc, c’est quoi se réaliser ? C’est quelque chose qui va s’objectiver ? Donc l’impossible va s’objectiver, c’est ça ? Non ! Donc, à partir de Von Weizsäcker, il va approfondir ce qu’est l’impossible. Cette pensée de l’impossible il va l’aborder. Et là, on va de plus en plus vers le noyau ! Si vous ne suivez plus, vous le dites, hein ? C’est de ma faute. Cette pensée de l’impossible, centrale pour Maldiney, commence par cette phrase : Le réel, - oubliez la triade de Lacan, réel imaginaire et symbolique, oubliez ! il ne faut pas être surdéterminé par quelques mots quand même !- le réel, c’est ce qu’on n’attendait pas qui a lieu, mais il faut partir pour avoir lieu, donc il faut être en mouvement pour que quelque chose ait lieu et c’est ce lieu qu’on n’attendait pas. C’est ça qu’il appelle le réel. Pour mieux circonscrire dans cette formule ce qu’il veut dire, il ne va pas faire la discussion avec Lacan sur le réel, il reste dans la philosophie et il va critiquer la dimension de Bergson. Cette dimension sur l’impossible et la réalisation de l’impossible, c’est une thématique chère à Bergson, dans le livre La pensée et le mouvant, c’est un livre que j’aime beaucoup. En France on ne parle pas beaucoup de Bergson, on fait un truc comme ça avec son nez quand on prononce le mot de Bergson, je ne comprends pas, c’est superbe sur le concept de la durée… donc il va essayer de mieux circonscrire le réel en critiquant Bergson. Maldiney ne reprend pas la critique bergsonienne du possible. Bergson dit « la réalisation - on est dupes de ça dans notre travail en psychiatrie, pour soigner des gens… faites moi des projets, quelle est votre finalité, montrez moi des objectifs… dans des délais comme ça, ça doit être réalisé… même le deuil… dans une clinique d’angoisse, après trois mois vous partez… ça doit être réalisé… quoi ? l’impossible ? tu parles !- Donc, Bergson dit « la réalisation apporte avec elle cette imprévisible rien qui change tout ». Pas mal ! Il y a quelque chose qui est apparemment impossible et ça se réalise parce que dans tout ce qui est apparemment impossible il y a quelque chose d’imprévisible qui fait que quelque chose a lieu. Ce rien étant précisément l’excès de réel, ce sur quoi justement nous nous attendions, dit Bergson. Et bien, non, Maldiney n’y va pas. Il a été formé à l’école de Kierkegaard. Et ça, c’est la rencontre entre Maldiney et Oury. Et Oury a grandi dans l’école de Kierkegaard. Quand il y a quelqu’un que mon papa Oury continue à lire tous les jours, et quand il ne le lit pas, je lui donne des médicaments car je sais que cela ne va pas, c’est Kierkegaard. Comme Maldiney. Jamais il n’a quitté Kierkegaard. Il a été formé à l’école de la possibilité de Kierkegaard. Parce que Kierkegaard dit que le possible est peut-être la catégorie la plus lourde de toute la philosophie. Et c’est à partir de là, pour critiquer Bergson que Maldiney va introduire le concept de transpossible. Il y a un impossible qui en se réalisant descelle la vanité ou le caractère illusoire du possible. Quand l’impossible se réalise cela veut dire que le possible était illusoire. C’est comme la thématique chez Aristote de la matière et de la forme. Quand il y a quelque chose qui se réalise, ça veut dire que la forme était l’illusion qui était déjà présente dans la matière. Donc, arrêtons de parler de la forme. Quand l’impossible se réalise cela veut dire que le possible était illusoire, ça, c’est Bergson. Et, il y a un autre impossible qui ne se réalise pas. En déchirant la trame du possible pour se faire jour, -Maldiney ne dira jamais que l’impossible se réalise-, se montre la force et le sens de cet impossible, c’est de ça dont il s’agit. Possible et pouvoir se disent en bien des sens et corrélativement impossibles. Le point de départ entre le possible et le pouvoir, c’est la thématique de Heidegger pouvoir être. Ce n’est pas un possible que nous avons, ce n’est pas un possible que nous calculons, ce n’est pas un possible que nous nous représentons, c’est un pouvoir être. Que en tant qu’existant, nous sommes un pouvoir être. Nous ne calculons pas nos possibilités et ce pouvoir être ne tend pas vers une réalisation. Et ça c’est une trouvaille géniale de Heidegger, quand il combine le pouvoir être avec le pouvoir mourir. Un truc génial. Pourquoi à ce moment là il va les mettre ensemble ? Pour montrer que le pouvoir être ne peut pas se réaliser, le pouvoir mourir disparaît avec l’événement de la mort. Le pouvoir mourir ne va pas trouver son accomplissement dans la mort. Quand je meurs, je ne peux plus mourir. C’est pour ça qu’on va dire qu’on meure tous les jours à quelque chose… Je ne sais pas, quand j’ai 6 mois, je suis mort au paradis, je ne peux plus bouffer ma mère. Je suis mort. C’est ça le pouvoir mourir. Je peux continuer à mourir. Mais, quand je meurs et qu’il y a la mort, je ne peux plus mourir. Ça va ? Les possibilités que je thématise et que je me représente, c’est tout le temps ça maintenant… tu vas où en vacances ? tu as déjà projeté tes vacances ?.... les possibilités que je thématise et que je me représente se voient retirer leur caractères de possibilités pour devenir quand elles se réalisent des réalités données ou visées. …ah, c’est possible qu’en septembre je vais aller là ou là… c’est foutu. La réalité est visée. Il n’y a plus de possibilité. … Essaye de faire un projet. On va voir si on va t’embaucher. Viens avec ton emploi du temps… le possible de Heidegger n’est pas possible au sens habituel du terme, et là dans Heidegger, le possible dans le pouvoir mourir par exemple est devenu impossible selon le sens du possible qu’implique le pouvoir être. Ça va ça ? Public : non M.L. : bon, il commence avec le pouvoir être. Pour pouvoir expliquer le pouvoir être, il va le combiner avec le pouvoir mourir, quand je meurs, je ne peux plus mourir. Qu’est ce qui est le plus important ? Le rituel de la mort ou la possibilité de pouvoir mourir ? Est-ce qu’on donne la possibilité aux gens de pouvoir mourir ou est-ce qu’on va thématiser la mort ? Et que c’est moi maintenant qui va choisir quand je serais à ma mort. Voilà. Là, il n’y a plus de possible. Ça va ? Donc, il combine le pouvoir être avec le pouvoir mourir. Maldiney reprend ça avec Kierkegaard : le possible est un impossible dans le sens du possible qu’implique le pouvoir être. Cette possibilité de pouvoir mourir est impossible à se réaliser. C’est dans cette dimension, celle de l’instant de quête de notre pouvoir être que Maldiney va travailler. Et par exemple il dit de Tal Coat que c’est une peinture à l’impossible en ce qu’elle nous met en demeure d’être. Dès qu’on va essayer de représenter une peinture, c’est foutu la peinture, c’est foutu l’œuvre ! On la thématise, on la commente, on la met en représentation, c’est foutu ! On va la regarder en spectateur, on va la regarder en face, c’est foutu. Comme je le disais tout à l’heure, il tourne, il circule autour, pour échapper à pouvoir la thématiser, à l’objectiver, etc. Tal Coat est une peinture à l’impossible en ce qu’elle nous met en demeure d’être, elle nous ouvre la demeure de l’être et nous oblige à être notre propre possibilité qui est impossible. Donc, l’impossible, ce n’est pas négatif ! Ce n’est pas un im- privatif. L’impossible est une dynamique du possible. Ou encore dans l’esthétique des rythmes dans Regard, parole, espace, parole autour de l’œuvre d’art en général, la présence de l’œuvre d’art – c’est pour ça qu’il n’y a pas d’histoire de l’art- la présence de la Sainte Sophie qu’il a commenté dix millions de fois, mais allez y vite, car maintenant elle est prise dans l’idéologie politique à İstanbul, allez vite si vous voulez voir les fresques en haut, si vous voulez voir la coupole vide, vite ! avec le coco là-bas… donc, c’est autour de la Sainte Sophie qu’il commente la présence de ce vide quand tu y entres. Maintenant, il n’y a plus les travaux et il n’y a plus d’échafaudages, et quand tu entres tu es vraiment avec et dans le vide. La présence est sa propre possibilité. L’œuvre d’art est pouvoir être. Et ça, c’est une phrase de Maldiney, n’essayez pas de comprendre avec nos têtes névrosées : l’œuvre d’art perdue, jetée, échouée, au milieu de son environnement, elle ne s’y trouve qu’à s’y trouver, s’y découvrir en s’y révélant . De s’y trouver, n’existe pour nous que dans un point. On ne s’y trouve et on ne se trouve que dans un point dans notre vie. Quel point ? Il appelle ça le point critique. Notre vie n’est que passage d’une crise à l’autre. Kuhn et Binswanger lui ont donné plein de phénomènes cliniques pour approfondir sa philosophie à partir de « on ne se trouve que dans un point critique ». Dans la crise. Il n’y a que la crise épileptique et la crise hystérique. C’est là qu’il a appris beaucoup de Szondi. C’est la deuxième et la troisième position qui sont des positions critiques. Il n’y a pas de crise toxicomaniaque. Il n’y a pas de crise dans la toxicomanie. Il n’y a pas de crise dans la psychose. Il n’y a pas de crise dans la mélancolie. Qu’est ce qui remplace la crise dans la mélancolie ? La plainte ! c’est toute sa philosophie là. Il n’y a plus de décision qui est quand même un moment critique dans notre existence, la décision. A partir de laquelle le monde s’ouvre. La décision n’existe pas entre ça et ça et ça. C’est des conneries ça. Le directeur qui arrive dans son bureau, qui dit bonjour à personne, il va dans son bureau, il doit prendre des décisions !... eh bien dis donc… c’est ça la bureaucratie ! Une décision, c’est ce moment critique de notre déchirure qui fait, qu’à partir de là, le monde s’ouvre. Dans la psychose, il n’y a plus de décision. Dans la mélancolie, c’est la plainte et dans la psychose c’est le délire. En nous… et ça c’était la critique de Schotte sur Maldiney, il disait que c’était une vision très pessimiste, très négative de notre travail, que cela ne ferme pas de faire des possibilités de faire des choses quand même et c’est à nous de créer à travers notre travail, et notre merde de faire de la merde pour qu’il y ait des crises et des conflits quand même. On ne va pas résoudre les conflits, c’est la mort ! Tosquelles, superbe, génial. Ça, Maldiney aimait bien quand Tosquelles disait qu’il faut des conflits ! Notre travail, c’est faire des conflits et il faut avoir les institutions et l’analyse institutionnelle pour non pas résoudre les conflits, mais les traiter, pour que ça puisse continuer et que cela ne se transforme pas en destruction. Et souvent quand il y a un conflit, cela devient vite violent. Ah, ça non ! etc. etc. donc à chacun des moments critiques, une présence devient, comme il dit, ce qu’elle est. Ce n’est que dans les moments critiques qu’une vraie présence existe. Et c’est là, et c’est superbe, mais c’est vraiment quand on aime Maldiney, quand on entre dans l’intérieur de son œuvre, c’est là où il critique Heidegger. Il va intégrer dans toute la philosophie de Heidegger le sentir. Et ça, c’est peut-être la dimension la plus fondamentale dans toute l’œuvre de Maldiney, c’est d’intégrer et de donner une place du pathique, du sentir, du ressentir à toute la philosophie. Aussi bien il le fait pour Aristote, pour Platon, dans Regard Parole Espace où il essaye d’intégrer la dimension du pathique dans Hegel. C’est un article superbe. Pour nous cliniquement, qu’est ce que ça veut dire la toxicomanie ? Qu’est ce que ça veut dire l’immédiateté ? Pour Heidegger, ça n’existe pas l’immédiateté. Le sensible c’est quelque chose qui ne peut exister que quand on le met tout de suite dans la dialectique de la négation. Pour moi, grâce à Maldiney, on peut travailler avec l’immédiateté : où ? Dans la toxicomanie ! « tout tout de suite ». ça ne sert à rien de mettre du négatif dans la toxicomanie. Ça ne sert à rien. Je provoque un peu. Hein Michel, j’espère que bientôt tu pourras m’aider à cette thématique de l’immédiateté et du sentir et du négatif. L’impossible de l’œuvre d’art, l’impossible d’exister en appelle à notre pouvoir être sans quoi, -et là il passe du transpossible au transpassible-, sans quoi il n’y aurait ni réponse ni répondant mais une stupeur destructrice. Il lie toujours le transpossible au pouvoir être. C’est la mélancolie qui nous apprend le transpossible, c’est à dire être toujours porté par le pouvoir être. Si on n’est plus porté par le pouvoir être, c’est la destruction. Heureusement, que dans la mélancolie il y a la plainte qui peut-être détruit celui qui l’écoute, mais pas le mélancolique. Il ne peut pas être porté par ce pouvoir être, ça s’est accompli… c’est arrivé… et Maldiney joue sur le néologisme en être arrivé là sans être jamais parti. Si je n’avais pas… je n’en serais pas là. Tout à l’heure Laurence me disait, ah j’ai ouvert ce livre Psychose et présence et… ô là là là, j’espère que tu vas nous donner envie de travailler la mélancolie par exemple. Mais quand tu lis Psychose et Présence, il y a un article plus facile dans Existence et psychose p124, quand est-il de la temporalité mélancolique ? Voilà, si tu veux travailler la plainte mélancolique, tu peux commencer là et après au boulot. L’échec de la transpossibliité c’est dans la mélancolie. Ils ne sont plus portés par le pouvoir être. MB : Je peux dire un truc ? J’avais inventé une petite équation. Je ne sais pas si cela pourrait t’intéresser… ML : Oh, arrête ! Il faut le formuler. MB : elle est facile. pouvoir être = serait se trouve être ML : serait ? le futur hypothétique ? et comment tu arrives à le mettre là ? MB : j’ai écrit ça il y a 20 ans, dans une revue de philosophie, un article sur Lacan où j’avais proposé cette équation. Qu’Oury reprend. ML : AH ! Où ? Je n’ai jamais entendu. MB : Oui, dans le séminaire de Ste Anne, il en parle souvent. ML : ces choses là quand même ! Quel est le sens de cette barre ? MB : le sens de la barre, c’est un rapport. Le rapport entre le pouvoir être et le se trouve être, c’est le serait. Tu viens de le dire avec le mélancolique. Quand le mélancolique ne peut plus faire un rapport entre le pouvoir être et le se trouve être, il n’y a plus de serait. Il ne serait pas.. ML : je n’en serais pas là. MB : voilà, quand il n’y a pas ce rapport… ML : p 129. Serais est un futur hypothétique. Tandis que le futur catégorique, s’ouvre au sortir du présent, le futur hypothétique s’ouvre dans le présent au sortir du passé. Il s’agit d’un présent non clos, mais non pas ouvert pour autant. Mb : d’ailleurs serais n’est pas si ouvert que ça. C’est ce qu’on appelle un conditionnel ML : oui oui oui, c’est un présent non clos, sans tension, purement extensif. Cette extension qui l’apparente à une étendue signifie que le temps n’est plus en expansion. L’identité en lui, dans serait, du présent et du futur, dénonce un état stationnaire du temps qui ne se temporalise plus. C’est pour ça que je ne comprends pas…. Pouvoir être et se trouver être…synonymes ? MB : c’est deux choses qui n’ont pas de rapport. C’est un peu tout ce que tu as raconté… il n’y a pas de rapport entre les deux excepté le serait… ML : oui… tu me fais toujours réfléchir…ça m’amuse… ça m’use…. Ça muse… allez demain on continue sur le transpassible. Samedi 12 avril ML : Bon allez on y va. Laurence a dit qu’on fait un peu sur la transpassibilité, on fait une pause et puis ensuite elle m’a demandé de faire un profil de quelqu’un de La Borde et de montrer comment on travaille. Cet après midi, je présente un profil. Allez, on y va. Je résume hier le transpossible. Le transpossible, c’est la dimension sans coordonnées préalables, c’est à dire ni réelles que ça se réalise, ni idéelles comme des a priori du pouvoir être. Et dans l’article de la transpassibilité le plus difficile, donc vraiment il faut l’étudier, la travailler dans le livre Penser l’homme et la folie, il va beaucoup plus loin cet article, dans le sens qu’il met en question, c’est pour ça que pour moi, c’est rigolo, enfin, pas rigolo, mais passionnant chez Maldiney, c’est qu’il n’a pas arrêté de réfléchir jusqu’à la fin de sa vie. Donc, il va mettre en question la problématique du pouvoir être. Il va transformer le rapport entre le transpossible et le pouvoir être. Il précise davantage les termes de transpossible et transpassible. Il critique Heidegger. Bien sûr, il pense toujours que c’est par l’épreuve qu’on apprend. Le transpassible va se concentrer autour de « qu’est ce que c’est que rencontrer l’autre ? ». Et c’est à partir de cette thématique de la rencontre qu’il va critiquer le pouvoir être. Je cite, P 404 de Penser l’homme et la folie : l’être de l’autre – l’autre avec un petit a, mon prochain, tu te rends compte, il me disait que quand il a trouvé ça, il était presque désespéré- L’être de l’autre est hors de mon pouvoir être. Hors. Il ne m’appartient pas de pouvoir le « possibiliser », l’autre. Ce qui fait signe et ouvre mon appel fait signe vers mon être, en tant que celui-ci est irréductible au possible, y compris à mon propre pouvoir être. Et donc tout l’article de la transpassibilité est construit autour de la notion de l’appel. Michel Balat : on peut dire un truc en passant. Ça veut dire quoi mon pouvoir être ? ML : je répète : mon pouvoir être veut dire ce qui fait signe et ouvre mon appel, c’est l’autre qui provoque mon appel… en tant que mon être est irréductible au possible. Qu’est ce qui m’interpelle. D’où vient cet appel de l’autre. Et c’est ça qui est hors mon pouvoir être. MB : une autre question pour être bien sûr de pouvoir te suivre. Si l’être est irréductible au possible, cela veut dire déjà exister. ML : oui, exister, c’est être hors de soi. Là, il commence avec le transpassible. Il y a quelque chose en l’autre que j’appelle, qui m’appelle et qui m’interpelle qui est hors possible, c’est ça qu’il va essayer de dire. Il précise. Le transpassible consiste à n’être possible de rien qui puisse se faire annoncer comme réel au possible. Elle est une ouverture sans dessein ni dessin. Dessein, le vouloir. Elle est une ouverture à ce dont nous ne sommes pas à priori passible. Il faut savoir que le mot passible vient du mot pâtir. Subir, pâtir. Mais, quel est ce rien ? c’est là qu’il s’appuie beaucoup sur la philosophie chinoise, le rien. Quel est ce rien ? ou ce rien à partir duquel nous sommes requis. Ce rien signifie simplement un arrachement à l’étant, donc à un autre qu’on peut thématiser… Public : étang ? plouf ? ML : étant ! dans le sens philosophique du terme, un autre qu’on peut objectiver, l’être et l’étant Public : le cabestan ML : l’étant de Sartre, l’être et l’étant, qu’on peut objectiver. Donc un arrachement à ce qui est là, et du côté de ce qui advient, et du côté de celui à qui cela arrive, nous sommes dépossédés de nos possibilités si il y a quelque chose qui nous arrive. Et il dit que ce rien est lourd de tous nos possibles. C’est un rien radicalement mobile et non pas une pure absence. Et ce que j’aime beaucoup dans cet article, c’est à partir de la page… son commentaire sur Winnicott dans Jeu et réalité, l’espace potentiel et surtout la préface qu’a fait Pontalis qui va reprendre et dont Winnicott reprend la thématique… le break down Didier Petit : La crainte de l’effondrement Ml : Oui, La crainte de l’effondrement. Toute cette structure profonde dans la crainte de l’effondrement, Maldiney le commente à partir du passage 413 de l’article de la transpassibilité. Pour dire que le rien n’est pas une pure absence. Et pour nous, quand on travaille avec les bébés, avec les petits enfants, c’est extrêmement important que cette carence, de quel ordre elle est ? Est ce que c’est une carence mobile, ou est ce que c’est une carence qui marque une absence ? Quelque chose a lieu qui n’a pas de lieu… c’est une lutte contre la béance… j’aime beaucoup ces 4-5 pages de Jeu et Réalité. On peut le lire à partir de là. Superbe. Ce rien n’est pas hors possibilité. C’est un radicalement mobile. Maldiney va décrire ce rien sous plusieurs axes à travers son œuvre. Ce rien, qu’il va lier à Paul Klee, c’est celui du chaos, ce moment cosmogénétique, ce moment de jaillissement primordial, ce rien est aussi mobile dans la thématique de la crise, selon Von Weizsäcker, ce rien est potentiellement tout dans la crise… un autre axe, celui de la lucidité, -je disais hier dans la voiture, ah j’aimerais bien que quand Michel est bien réveillé, on fasse ensemble un truc sur Gustave Guillaume, comme hier soir, ce sont des moments superbes. Moi, non plus, je ne connais pas bien, alors cela m’aidera pour vraiment l’étudier Gustave Guillaume. Cette approche de la langue, comment ça se rencontre dans la sémiotique… pour moi, c’est un rêve de pouvoir faire ça ensemble. Je vous le dis. Vous faites ce que vous voulez avec mes rêves… et toi… la la la… MB : oui… GP : Bon, on va peut-être vous laisser… Public : rires ML : par exemple, c’est un thème de Gustave Guillaume, le rien, celui de la lucidité puissantielle, ce sont des mots lourds… GP : c’est du lourd ML : de puissance, qui est pour Gustave Guillaume, le temps premier de la causation du langage. MB : quel est le temps premier ? ML : cette lucidité puissantielle. La puissance de la langue. Le temps comme durée, la langue comme tension. Quelles sont les dimensions de tension dans la langue. MB : est ce qu’il dit que pouvoir être est un subjonctif ? ML : non MB : il a tort. ML : c’est un infinif. MB : oui, bien sûr, mais le temps du pouvoir est un subjonctif. Il ne le dit pas ? ML : je ne sais pas. Je pourrais aller chercher. Est ce qu’il y a un moment, dans son commentaire sur Gustave Guillaume, est ce qu’il va inscrire le pouvoir être dans une structure grammaticale du langage, je ne sais pas… je vais chercher. Je vais voir chez Lohmann. Il choisit aussi le rien lourd de possibilités lorsqu’il parle du vide de la pensée et de l’art chinois, quand il commente la peinture aussi bien que la poterie, il parle beaucoup de la combinaison du rien et du vide. Ou bien, encore un autre axe, le thème de l’ouvert dans Hölderlin, que l’on va retrouver dans Regard, parole, espace, cette dialectique entre l’ouvert et le rien que l’on va retrouver dans sa dernière œuvre, Ouvrir le rien, c’est le titre de son testament. La consécration de toute son œuvre. Ouvrir le rien. L’art nu. Donc le titre parle. Celui de l’ouvert de Hölderlin ou de Heidegger. Après le … LFC : quand tu dis Heidegger, c’est bien de Hei-de-gger dont tu parles ? ML : comment vous le dites en français ? LFC : Hei-de-gger GP : Hei ! deux guerres ! ML : ah la la Public : rires LFC : avé l’accent catalan - rires ML : par définition, quand vous prononcez comme ça, c’est un nazi. Heidegger GP : Hei ! deux guerres ! c’est un arc réflexe- rires ML : c’est très sérieux ici ! ah ben alors ! c’est très sérieux … Donc il va lier le rien avec la thématique du dernier Heidegger, dans toute la thématique du hors attente. Et quand mon papa Oury va prendre quelque chose, c’est là. Le narcissisme originaire est hors attente. Oui, oui… Maldiney a parlé de ça, mais c’est surtout chez Blanchot ! Non, j’men fous de Blanchot c’est chez Maldiney… et on se dispute… rires. Ou bien, et là c’est intéressant dans notre travail clinique, c’est existentiel dans Heidegger, le souci et dans le dernier Heidegger, on va plutôt trouver l’insouciance opposée au souci et au schwermut, la pesanteur. Et un mot intraduisible gelassenheit et que dans les dernières traductions on a traduit avec les moyens du bord par sérénité. Ce n’est pas beau mais quand même. On n’en a pas trouvé d’autre. Donc, à travers son œuvre, il va articuler plusieurs axes, Paul Klee, Gustave guillaume, l’art chinois, Hölderlin, et le dernier Heidegger. Malween : est-ce qu’il utilisait Kimura ? ML : ah oui, il utilisait beaucoup Kimura. Beaucoup ! Quand Danielle a écrit son livre, sur les paysages de l’impossible, l’avec schizophrénique, elle combine une lecture de Kimura commentée par Maldiney. Oui ! Mais je ne peux pas tout faire ! GP : Pourquoi ? ML : Parce que d’une part, je ne suis pas capable et qu’ensuite vous vous foutez de ma gueule. Public : rires. ML : alors, je pense que là où on peut aborder le mieux le transpassible, c’est quand il est en échec, en défaut. C’est dans la psychose et en particulier dans la schizophrénie. Et ça, c’est un fil conducteur dans l’œuvre de Maldiney. A chaque page, on va souvent rencontrer ce qu’est un défaut dans la schizophrénie. C’est quoi ? La psychose se ferme peu à peu à ce niveau originaire de l’expérience de vivre qui est celle du sentir et du ressentir par lequel nous pouvons être ouvert à la surprise de l’événement. A quelque chose qui nous excède et qui est dans notre possibilité d’être, notre potentialité. N’importe quel fait qui se passe peut nous confronter à quelque chose qui nous excède, qui nous touche, qui nous plombe. Ça peut être Atlantico Madrid qui gagne le match contre Barcelone. Ça peut être la commémoration du génocide du Rwanda. GP : les français n’y étaient pas- brouhaha- rires ML : Je sais. Quand les français gagnent, ça ne me fait rien. Quand ils perdent, ça me rend joyeux, mais ce n’est pas de l’ordre de l’évènement. Ce qui nous ouvre à l’événement, à ce réel qu’on n’attendait pas, c’est la transpassibilité. Pour le dire simplement. C’est à dire une capacité de subir qui n’est limitée par aucun a priori. Est-ce qu’on peut supporter l’insupportable pendant des années ? car comme l’événement lui même, l’existence qui accueille, ek-sistere, avoir sa tenue hors de soi, c’est là toute sa critique sur le vivant, ek-sistere, mais hors de soi ne veut pas dire ex dehors, car comme l’événement lui même, l’existence qui accueille est hors attente, est infiniment improbable, elle n’a rien à quoi s’attendre, elle n’a rien à attendre de quelqu’un ou de quelque chose, et bien dit-il c’est précisément, comme tu disais hier, quand tu disais un peu vite, mais bien, quand tu parlais de disposition, cette réceptivité accueillante à l’événement, c’est ça qui fait défaut dans la psychose et en particulier dans la schizophrénie. Donc, tout notre travail de l’accueil, mais c’est un mot complètement surdéterminé, tout le monde utilise ce mot, mais il faut bien savoir ce que cela veut dire, l’accueil. Public : il y a des banques d’accueil ML : oh la la, oui, c’est terrible. Pour nous, le mot accueil, on le condamne et on parle de fonction d’accueil. C’est complètement différent. Quel est ton degré de fonction d’accueil dans ton travail ? Tu ne vas pas être réceptif avec un schizophrène qui habite en appartement en ville ou alors à la campagne ou alors qui est à l’hôpital. Ce n’est pas la même fonction d’accueil ! Par exemple, avec notre patient qu’on voit avec Laurence le vendredi, si on n’a pas vu le match de foot, et bien le transpassible ne marche pas. MB : l’histoire des fonctions quand même… les fonctions, c’est précisément ce dont on parlait hier. Le passage de l’accueil à la fonction d’accueil, c’est le passage de l’indicatif au subjonctif. ML : Note le ! Je vais le retenir. Où est ce que je peux apprendre mieux la grammaire ? Une grammaire simple, basale… MB : … LFC : je te passerai le petit Bled, je l’ai à la maison. ML : Comment s’appelle le livre des deux belges qui ont fait la grammaire Public : le … du bon usage. Le Bescherelle… le Bled… Public : c’est trop dur ML : pour moi, c’est trop dur, c’est pour avoir la base. Parce que là, passage du l’indicatif au subjonctif, avec toute la thématique logique là-dedans, … que je puisse me préparer, est ce que l’accueil comme substantif… etc. est ce le passage de l’indicatif au subjonctif… c’est superbe comme question mais… GP : comme réponse ! ML : comme questionnement ! et bien donc cette réceptivité accueillante à l’événement fait défaut dans la psychose. C’est de manière pathique, donc toujours sur le monde contactuel qu’on contacte les gens. Chaque séance psychanalytique ou autre commence dans le contact. Ce n’est pas la peine de donner une main et allonge toi et je n’ai même pas eu le temps d’avoir vu ou d’échanger l’expression de ton visage pour voir s’il y a une tonalité dépressive. Ce ne sont pas les mots qui vont nous dire quand même qu’il est déprimé. GP : c’est quoi ? ML : c’est la tonalité dans le mot ou dans le visage. On n’a jamais vu l’humeur dans un mot. Il y a par exemple dans l’article Contributions Kuhn Maldiney, Kuhn qui commente une phrase d’une patiente qui passe le Rorschach. C’est une phrase apparemment banale. Elle dit : et vous voyez, aujourd’hui, il ne me vient rien à l’idée, je ne sais pourquoi. Aussi à la planche 7 : voyez vous chaque fois que je découvre un côté négatif chez d’autres personnes, je trouve que je l’ai moi même. Pendant des pages, Kuhn va lire ces phrases d’interprétations des taches comme le noyau de la dépression. Mais impossible de le détecter si elle n’avait pas eu à projeter ce qui se passe dans un choix d’interprétation d’une tache. Donc c’est de manière pathique que l’existant est ouvert à l’évènement. Ce n’est pas de manière gnosique. Cela ne se produit pas dans un monde déjà constitué et indépendant de nous mêmes. On ne peut pas être dans le transpassible quand on regarde la télé. Où les montages sont faits. Les infos sont faites pour échapper au transpassible. C’est ça leur succès aussi ! GP : pourquoi tu dis quand tu évoques la phrase « je ne vois partout que des choses négatives et je trouve que je les ai aussi ». Pourquoi tu dis que ce n’est pas dépressif dans les mots ? ça apparaît. ML : tu n’as qu’à lire la suite. Oui, mais c’est à partir de là, qu’il développe tout l’aspect dépressif. C’est de manière pathique que l’existant est ouvert à l’événement. Qu’il ne se produit pas dans un monde déjà constitué. C’est au contraire le monde qui s’ouvre à chaque fois à partir d’un événement. Le monde n’existe pas. Il n’ek-siste, n’est qu’un mouvement à partir de quelque chose de l’ordre de l’événement, de quelque chose qui nous sur-prend, qui nous dé-possède, qu’on subit. Pour montrer en quoi consiste ce bouleversement que produit en nous l’événement, il va s’appuyer sur la distinction qu’il trouve chez Erwin Straus entre Geschehnis qui veut dire un événement qui fait partie de la vie quotidienne, du temps ordinaire, un fait qui devient une anecdote et Erlebnis, l’évènement en tant qu’épreuve de ma vie singulière. Et pour faire cette distinction Erwin Straus rapporte un exemple de ses patients. C’est à propos d’un homme renversé par une voiture, et qui gisant mort dans la rue est entouré des témoins de l’accident parmi lesquels se trouve un médecin et un jeune homme. Le médecin constate professionnellement la mort de l’accidenté sans que cela l’atteigne de manière personnelle. Parce qu’il travaille dans les urgences. Alors que le jeune homme, au contraire, profondément touché par ce spectacle demeure pendant des semaines incapable d’oublier la vue du mort. Pendant des années. Qu’il a enkysté d’une certaine façon. Et Maldiney commente : si l’évènement d’être présent sur le mode perceptif dans cet accident n’a pas eu le même destin, c’est parce que le vécu n’était pas le même au départ. Ce n’est pas la perception d’un mort- et là c’est toute l’œuvre de Maldiney qui parle, c’est la différence entre la perception et le pathique- ce n’est pas la perception d’un mort qui est en soi bouleversante mais le rapport entre un mort et la mort dans lequel le jeune homme est impliqué. Il n’y a donc pas d’événement en soi puisque l’évènement ne prend sens que dans une situation. Donc toute la thématique où on ne parle pas d’un sujet objet mais de quelqu’un en situation. Quelqu’un en situation pour échapper à toute la problématique de l’objectivité. Il n’y a donc pas d’événement en soi puisque l’évènement ne prend sens qu’en situation et qu’il ne peut affecter l’existé qu’en tant qu’évènement de l’existence. Mais inversement, la présence elle-même de quelqu’un dans la vie, la présence elle-même de quelqu’un à soi même, être présent… simplement, j’aimerais bien moi ici calculer le coefficient de présence. Chez nous, on dit dans un coefficient de présence qui va de 0 à 10, si le coefficient est de 2, c’est pas mal. Ça va. Il est déjà un peu présent. Ce n’est pas la liste de présence qui va indiquer notre situation de présence. Cette échelle nous indique la thématique de la pré-sence. Etre en avant de soi. Pré. Donc la présence elle même de quelqu’un n’est que par l’ouverture de la personne à l’événement. Etre ouvert à ce qui se passe, à ce qui à lieu. C’est ce qui conduit Maldiney à dire que cette ouverture à l’événement est ce par où la présence existe et qui lui fait dire, il va rajouter à la liste, que l’événement est existentiel. Pas seulement le souci, le pouvoir pour la mort, mais aussi un existentiel. MB : tu connais la définition de Peirce de l’événement ? ML : Non, pas du tout. MB : un événement est une jonction existentielle de faits incompossibles. ML : oui, c’est bien, c’est la même chose, c’est existentiel. C’est intéressant quand même de faire des ponts ! MB : … Public : rires… MB : chaque fois que je dis ça à Oury, il s’en fout. ML : Ah non ! Ce n’est pas vrai ! Il dit ça parce que ce n’est pas lui qui l’a dit. Mais il ne s’en fout pas. Il entend quand même. Il m’emmerde beaucoup mais là, je le défends. Après, ça fait son chemin. Et après, il nous dit : ah oui, Michel, c’est intéressant… mais au début, oui, ce narcissisme pas possible… mais il est quand même plastique… GP : peut-être qu’il ne comprend pas ce que dit Michel. ML : qui ? GP : ton père- Oury… ML : quand il dit « j’men fous » il a compris. GP : non, parce qu’il est obligé de répéter. ML : non, il le reprend avec ses propres mots. rires GP : quand l’autre répète, c’est qu’il ne le comprend pas. Rires ML : sans doute qu’il le reprend à certains moments… GP : non, sinon Michel nous en aurait parlé ML : je ne sais pas, je ne sais pas… rires Donc, cette ouverture à l’évènement, c’est ça qui fait que, la présence existe, et alors on peut comprendre pourquoi, dans la psychose il n’y a pas d’événement. C’est sa phrase qui revient toujours et c’est cette phrase qui a été très critiquée Sylvia Dias : c’est terrible ML : oui, c’est terrible GP : c’est normal. ML : Le mélancolique dont la temporalité ne consiste qu’en rétention, vous vous rappelez, tout comme le maniaque, - ce sont les pathologies qu’il commente le plus-, tout comme le maniaque qui sans appui dans le passé ne connaît qu’une temporalité sans cesse à venir n’ont pas de présent véritable. Et donc, de là, dans son œuvre, qu’est ce que c’est le présent comme temps grammatical ? C’est quoi le présent ? C’est quoi l’instant ? Donc sa première œuvre Aîtres de la langue et demeures de la pensée est consacrée pour une grande partie à ce qu’est le présent. Ils sont par là exclus de l’événement. Quand au schizophrène, il s’efforce, - et ça ce sont des pages magnifiques- il s’efforce dans son délire de rencontrer l’événement. C’est ça qu’on disait hier dans la voiture. La rencontre ce n’est pas l’autre, c’est l’événement. Rencontrer l’événement car le délire est pour lui le seul moyen de se comprendre lui même. C’est encore un essai d’exister le délire. Ils essayent à travers le délire de rendre compte de cette métamorphose existentielle qu’exige la survenue d’un événement. Ça me fait quelque chose, ça me confronte, ça m’interpelle, c’est un appel. Est-ce que ça me convoque à une métamorphose, à une transformation ? Pourquoi Kafka, il tourne toujours en rond, et pourtant il n’arrête pas, tout le temps, de mettre sur la scène dans ses livres, des métamorphoses, des transformations, des situations absurdes qui interpellent l’autre à se métamorphoser. C’est pour ça que Maldiney dit que Kafka est un grand mélancolique. Tout son enseignement, dès le début, jusqu’au moment où il va rencontrer Szondi, il va commenter Freud et en particulier pendant trois ans Schreber. Il a commenté pendant deux ans l’interprétation de Lacan de Schreber. Le délire de Schreber était toujours une tentative de se métamorphoser pour pouvoir accueillir l’événement. L’événement de Schreber c’était quand même de devenir père. Aussi bien au niveau public, sa nomination, qu’au niveau homme-père. Cette survenue de l’événement, comment ça va me transformer ? Il ne peut pas. Et le délire est une tentative. Mais le délire est en même temps une occultation de cette métamorphose. Et Kafka va trouver plein de personnages, des animaux pour occulter cette impossibilité de la métamorphose. Et Maldiney se réfère aussi bien à Schreber qu’à Suzanne Urban, un cas clinique classique de Binswanger, car -284- la démultiplication des persécuteurs dans le délire de Schreber, la multiplication dans le délire de Suzanne Urban ont pour effet, - et j’aime beaucoup ce passage- de diviser la compacité du terrifiant.. Est-ce une façon d’échapper à la proximité absolue de sa propre étreinte ou est-ce une aggravation de la terreur, comme le pense Binswanger, en ce que le malade est désormais entièrement tombé au monde d’où l’assaillent les persécuteurs ? La question reste posée, mais l’échec est le même. GP : il fabrique des enfants ML : qui ? GP : Schreber. La multiplication ML : oui, les persécuteurs, ça n’arrête pas chez Schreber MB : Georges dit plus que ça ML : il en fabrique beaucoup, il copule avec tout le monde. Le délire est en même temps une occultation de cette métamorphose. GP : une présentification MB : une compacité du père. C’est ça que dit Georges. ML : Maldiney dit de diviser la compacité du terrifiant. C’est terrifiant quand même de ne pas pouvoir accueillir cet événement. Et donc voilà. GP : c’est une manière d’accueillir ML : absolument, c’est une manière d’accueillir MB : catastrophique ML : catastrophique, bien sûr. Malween : il y a quelques années en arrière, j’étais dans une clinique psychiatrique et j’animais un atelier d’écriture et j’avais demandé aux personnes qui étaient rassemblés là de fermer les yeux et qu’ils s’imprègnent dans la contemplation d’un paysage intérieur imaginaire et une fois qu’ils s’en étaient bien imprégnés, je leur ai demandé d’imaginer la survenue dans ce paysage de quelqu’un puis d’écrire. Et ce qui m’a complètement surprise, aucune des personnes qui étaient là autour de la table n’a raconté un décentrement de soi vers l’autre, mais au contraire c’était quelque chose de la refermeture, c’est à dire d’attendre que la personne passe pour retourner à la contemplation. Un impossible d’aller à la rencontre de l’autre. Et cela m’avait vachement interpellée. Constater qu’aucune de ces personnes n’étaient capables de se décentrer pour aller vers l’autre, c’était quelque chose qui… Et je trouve que dans cette lecture là, ça prend sens. Geneviève Feixas : est-ce que cela peut se traduire par une formule comme « je suis le paysage et je suis dans le paysage » ce n’est pas la même chose. ML : je vais donner un exemple GP : dis bonjour à la dame ML : La première fois sans doute il y a longtemps où nous étions en présence Roland Kuhn, Jacques Schotte et moi même... Le schizophrène qui vivait depuis presque dix sept ans dans un état de prostration presque constante mais dont Roland Kuhn avait remarqué la sensibilité apparemment paradoxale aux formes et aux couleurs a été invité à regarder des reproductions de peintures. Je les avais choisies -lui, quand il commente… une fois qu’il avait été dans l’atelier de poésie de Bouchet, on l’invitait souvent à aller dans des ateliers d’art thérapie, dans des ateliers d’animations, essayer de trouver des techniques pour pouvoir rencontrer, il disait ‘restons à l’authenticité de la vie, je vais leur montrer des formes, parce que l’imagination… etc. ça vient de mettre en forme quelque chose’. Je les avais choisies (les peintures) telles que en raison de leur style, leur moment apparitionnel constituait un indivisible moment d’évidence et de surprise. Tout en jouant avec un lacet le malade jetait sur celles qu’on lui présentait un regard furtif comme à la dérobée et lançait quelques mots au sujet de chacune. Des mots à l’arraché. –vous vous rappelez, l’arrachement-. Certaines de ses expressions étaient si expressément ajustées à la plénitude de l’œuvre qu’il eut été difficile au plus aigu des critiques d’en trouver d’autres. Mis en présence d’une des dernières baigneuses de Renoir, dont l’espace ambiant est l’aura radieuse et tourbillonnaire d’une forme en expansion et de flux coloré -ça c’est typiquement Maldiney- il dit simplement : le soleil d’or de la vie. Alors s’est produit un incident. Appelé au dehors, le Dr Kuhn est sorti. Aussitôt la porte refermée, le malade s’est levé en disant à nous qui restions là assis, « à qui le tour, messieurs ? ». Il avait été garçon coiffeur à Lausanne. Pour la première fois depuis 17 ans, quelque chose de son passé émergeait. Peut-être était-ce l’occasion furtive d’un échange. Il lui fallut trouver la parole ou le geste capable de faire de cette lueur le premier tremblement historique d’un passé enfoui devenu absolu. Quelques mois plus tard, le Dr Kuhn a fait une expérience du même ordre. Il montra à un malade schizophrène deux lithographies de Tal Coat dont les taches noires discontinues – vous trouvez cette reproduction dans Ouvrir le rien- dont les taches noires discontinues en tension mutuelle représentent un vol d’oiseaux. Non pas un groupement d’oiseaux volants mais la dynamique rythmique d’un vol dont les taches noires communiquent entre elles dans l’ouvert des énergies blanches. Or à partir de cette vision et de l’échange de paroles qu’elle suscitât entre le patient et son médecin s’établit une conversation tellement normale que le Dr Kuhn en venait à se demander s’il avait encore à faire avec un malade, si celui qui était là était celui qu’il connaissait. MB : ah, purée, il y a de quoi écrire à Danielle. Tu vas dire quelque chose de ma part à Danielle. Je crois qu’en fait, il me semble que ce qui est touché dans le contact ce n’est pas la priméité comme telle, mais la priméité de la tiercéité. ML : C’est vrai. Ça, j’ai compris. MB : tu lui dis pour voir si elle est d’accord. Comme elle connaît très bien Pierce… Geneviève Feixas : on le reprendra lundi, parce que là…du coup… on est un peu… ça vaudrait le coup. MB : rires… oui oui on reprendra ça. On voit bien que la priméité, ça va… mais c’est la priméité de la tiercéité qui ne va plus. ML : oui, tout à fait. C’est ça. On pourrait presque dire, comme dit Maldiney : le délire nie le caractère de première fois de l’événement. MB : ah ! ça, c’est bien ça. C’est l’évènement tel qu’il est dans la priméité de la tiercéité. ML : oui, c’est ça ! MB : Pas n’importe quel événement ! C’est pour ça que la distinction entre les évènements, elle est là dessus. ML : la première fois ! Didier Petit : dans un autre registre, est-ce qu’on pourrait parler des stéréotypies ? ML : explique ! DP : par rapport au premier geste, qui nie l’évènement. Avant théoriquement, la première fois est niée par la stéréotypie ML : oui ! MB : et qui est l’invention d’une forme. ML : oui. Lui, il va souvent commenter le maniérisme. Où le maniérisme, c’est toute cette thématique de la métamorphose qui s’est condensée, immobilisée dans la pause. Il utilise comme paradigme de la pause de quelqu’un qui dans un atelier ou je ne sais pas quoi, va pauser comme modèle. Et bien, dans le maniérisme, on a cette structure du corps. La pause. Le personnage. Mais dans la stéréotypie, c’est la même structure. Le maniérisme et la stéréotypie ! oui oui. il dit : l’expérience psychotique atteste par là que l’événement requière la collaboration de celui auquel il arrive et qu’il est nullement, par rapport à lui, dans une totale passivité. Il sort à nouveau de la psychose là. C’est cette paradoxale capacité d’attente de la surprise avec Merleau Ponty, cette passivité de notre activité, ou avec Husserl, où Mélon, il est courageux quand même, il l’a édité, ce grand pavé, La synthèse passive de Husserl, tout ça c’est le même champ de travail,,, ou cette transpassibilité, c’est la terminologie de Maldiney, que traite pour lui la phénoménologie, l’objet de la phénoménologie, c’est le traitement du transpassible. Donc, sa thématique, c’est toujours le dépassement de l’oppositionnel, le passif et l’actif. Si Maldiney a forgé ce terme de transpassibilité pour retrouver la manière – et là il retrouve Tosquelles- dont l’humain retrouve sa transcendance, ou plus simplement son dépassement, ce n’est pas la transcendance scolastique, en tant qu’elle implique une réceptivité et la première pathologie de la transcendance, c’est l’ambivalence ; quelqu’un qui ne peut pas se dépasser, c’est quelqu’un qui est dans le doute… oui non … oui non… c’est une thématique de ne pas pouvoir se dépasser et qui s’arrête à l’ambivalence. L’échec de la transcendance. … donc en tant qu’elle implique une réceptivité, c’est pour indiquer que la réceptivité doit être comprise comme une passibilité. Et passibilité veut dire simplement une capacité de pâtir et de subir au sens où elle implique une activité immanente à l’épreuve. Qu’est ce qui fait qu’il y a des gens qui s’en sortent d’un événement impossible… perdre un enfant… c’est impossible… et bien, grâce au transpassible, on peut… être réceptif à ce qui nous arrive. Et ça ouvre le champ-même à la réceptivité. C’est cette ouverture et cette capacité d’attente indéterminée qui manque dans la psychose. Et de là, chez nous on fait toujours la différence entre erwartung, et entwartung. Et toi, hier, avec ton patient, quand tu disais que tu en avais marre qu’il ne te parle que du valium, et le valium ceci, et le valium cela et que tu disais, il me réduit à entendre ces conneries sur le valium non, je veux être psychothérapeute, je veux être psychanalyste et je veux aller là où ça se passe ! Non ! Nooooon….. Non ! Est-ce qu’on peut partager l’attente indéterminée ? Et quand nous, dans notre pratique quand même, à La Borde, on voit le malade 5-6 fois par jour quand il faut. Il ne se passe rien… rien ? Ce rien ! Deux minutes, trois minutes… et ce n’est pas la coupure lacanienne… dans le sens où ah ah ah… les séances courtes pour que ça émerge les conneries… non ! C’est partager cette attente indéterminée. Et peut-être comme on dit, un jour, on va s’ennuyer ensemble. Aaah ! Grosse victoire. Et c’est aussi dans ce contexte là qu’il rencontre Pankow. Ils étaient très bien ensemble. Il y a avait un respect absolu entre eux, chacun dans son for intérieur, dans des échanges de lettres, par trop dans la conversation et … c’est Maldiney qui me l’a dit… ils étaient très réceptifs l’un pour l’autre. Et Pankow utilisait la philosophie de Maldiney et lui il utilisait les techniques qu’utilisait Pankow dans ce partage de l’attente pour faire émerger quelque chose au niveau de l’espace… pour approfondir sa propre pensée. Donc, il y avait entre eux quelque chose de très fort. Elle commente elle aussi, dans Structure familiale et psychose, à la fin, dans l’annexe, elle commente des textes de Maldiney. C’est donc bien cette capacité d’être en prise sur les choses qui fait défaut dans la psychose. Et à partir de là, cela se traduit dans une incapacité d’habiter le monde et d’habiter son propre corps. L’événement par excellence est la rencontre. Et c’est la fin de l’article du transpassible. Il n’y a de rencontre que de l’altérité et elle (l’altérité) est toujours imprévisible. Ce qui caractérise en effet l’existence est sa transcendance. Cette capacité de dépassement. Cette capacité de l’imprévisible. Donc, la transpassibilité est plus que la simple passibilité. Elle est ouverture. C’est peut-être le mot qui va le mieux avec le transpassible. L’ouverture avec l’évènement hors attente. Je ne trouve pas de meilleure transcription que celle –là et qu’on retrouve passage 421-422. La transpassibilité consiste à n’être passible de rien qui puisse se faire annoncer comme réel ou possible. Elle est une ouverture sans dessein ni dessin, à ce dont nous ne sommes pas a priori passibles. Elle est le contraire du souci. La rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu’elle fleurit, n’a souci que d’elle même… elle existe pour rien. Pour le rien qui la libère de toute attache préalable à l’étant et qui signifie en elle que son existence est originaire. La transpassibilité sans souci implique l’insouciance qui est le contraire de l’esprit de poids, le contraire de la Schwermut qui tend vers le fond dans un rapport obscur. Amen. La transpassibilité implique une ouverture absolue de tout projet. 30 - 31 octobre 2014
27 - 28 mars 2015
26 - 27 juin 2015
29 - 30 janvier 2016
29 - 30 avril 2016
21 - 22 octobre 2016
03 - 04 fevrier 2017
19 - 20 mai 2017
13 - 14 octobre 2017
02 - 03 février 2018
01 - 02 juin 2019
23 - 24 novembre 2018
15 - 16 fevrier 2019
4 - 5 octobre 2019
31 janvier - 01 FEVRIER 2020
title 1
|